14/06/2022
Le mariage en rouge d'Auda Isarn
Saint-Loup, Nouveaux cathares pour Montségur, II Éclairage rouge, pp. 136-140, Presse de la Cité, 1969

Auda Isarn et Barbaïra regagnèrent Carcassonne avant la chute du jour. L'automne, moins avancé en plaine que dans le haut pays ariégeois, donnait à leur course une saveur âpre et mélancolique. Le Languedoc s'endormait doucement dans toute sa gloire, comme à la veille de la Croisade. Dans un enchaînement d'images brèves s'élevaient les collines fauves et s'abaissaient les garrigues aux euphorbes rougies par la sécheresse... Vendanges éclatantes... Envols de perdreaux rouges dans les genévriers. Pluie de feuilles dorées tombant des figuiers las. Et l'air qu'ils respiraient possédait une saveur nourricière pour l'âme avec le parfum rare du thym et de la lavande subtilement alliés.
Barbaïra dit à sa compagne :
- Je n'ai pas assez de carburant pour t'accompagner jusqu'à Toulouse. Tu prendras le train de vingt-deux heures.
Auda Isarn travaillait dans un hôpital de la cité rose, après avoir servi comme ambulancière pendant la campagne de 1940. Elle suggéra :
- Et si nous faisions le tour de la Cité en attendant l'heure ?
Ils abandonnèrent Matràs « le carreau d'arbalète » devant la porte d'Aude et s'engagèrent, à pied, sur les « lisses hautes ». C'est là que, d'ordinaire, les amoureux viennent rêver. Également contrariés dés qu'ils frôlèrent le premier couple qui leur rappelait brusquement le sens de ces promenades ; Barbaïra par crainte d'y croiser des personnes de sa connaissance ; Auda Isarn par la pensée qu'on pourrait la prendre pour la maîtresse de son camarade ; ils poursuivirent cependant, mais d'un pas rapide qui prétendait détruire tout équivoque.
Ils passèrent devant la tour wisigothe, les tours Ronde et Carrée de l'évêque, Cahuzac, Grand Canissou, Mipadre. L'herbe des lisses, en pleine mutation glissait du vert diurne au bleu crépusculaire que reprenait, au loin, la montagne, mais en plus léger, comme celui d'une aile d'oiseau suspendue entre le ciel et la plaine...
Les jeunes gens firent le tour de la Cité d'un pas olympique. Ils transpiraient en approchant du Château Comtal, leur point de départ, masse à la fois trapue et légère sur laquelle, déjà, pesait la nuit. Auda Isarn s'arrêta brusquement et désigna l'une de ses tours.
- C'est bien là, demanda-t-elle, que Simon de Montfort garda prisonnier Raymond Roger Trencavel après la chute de la cité ?
- Oui. Il mourut dans un cul-de-basse-fosse le 10 novembre 1209 après trois mois d'agonie. Les historiens ne sont pas d'accord sur sa fin... Empoisonnement disent les uns, dysenterie les autres ! C'est une sombre affaire !
Fatigués, ils s'assirent sur une dalle du chemin de ronde. La tête penchée vers le sol, Barbaïra semblait réfléchir et se taisait. Il tressaillit lorsque Auda Isarn lui prit le bras en le serrant avec force. Jamais d'ordinaire elle ne recherchait pareil contact.
- Roger, dit-elle de cette voix rauque q'uil n'entendait jamais sans inquiètude, tu finiras toi aussi prisonnier dans une tour de Carcassonne si tu te mêmes de tout ça ! – Puis : – Je vous écoutais les uns les autres, à l'AJ... Les partisans du maquis... Les partisans de la Milice. Les malheureux ! Ils vont se mettre au service du mal !
Roger Barbaïra ne prêtait aucune attention aux paroles de la fille, tout entier livré au plaisir de sentir l'étreinte de cette main sur son bras. Mais Auda insistait d'une voix angoissée et pressante...
- Roger, je t'assure qu'il faut écouter notre ami Giono qui dit : l'intelligence c'est de se retirer du mal ! Soyons un peu intelligents tous les deux !
Il contemplait la main de lumière posée sur le cuir noir de son armure de motocycliste. Dans la nuit maintenant presque close elle prenait l'aspect évanescent de ces longues mains que la Renaissance italienne prêt aux aristocrates de la sainteté. Il inclina sur elle son visage, précautionneusement, et sa voix la prit à témoin en murmurant :
- Chère Auda, si tu ne veux pas qu'on me jette un jour dans la prison de Trencavel, c'est que tu tiens peut-être un peu à ton vieux copain « ajiste », non ?
Elle sourit – mais la nuit, déjà, effaçait le sourire – et dit :
- C'est la première fois que tu t'en aperçois ?
Il ne bougeait plus, la tête penchée sur la main, les lèvres à quelques centimètres de cette messagère lumineuse, n'osant traduire ses intentions profondes par le baiser qu'elles tenaient en réserve... Il dit d'une voix sourde.
- Mais tu ne tiens pas suffisamment à moi pour devenir comtesse de Miramont, n'est-ce pas ?
Un couple enlacé passa devant eux à petits pas, sans les voir. Barbaïra frissonna, par contraste avec la flambée de son sang brusquement allumée. Son visage se pencha un peu plus sur la main et ses lèvres se posèrent sur elle. Auda Isarn la retira, mais doucement, dans un mouvement mélancolique en soi et non avec la force du réflexe qu'elle opposait jusqu'ici à ce genre d'initiative.
- Je ne veux pas, dit-elle à voix basse, me laisser envoûter par la luxure, même et surtout dans le mariage...
Elle se tut pendant quelques minutes tandis que Barbaïra conservait la position prise pendant que fuyait la main de sa compagne.
- Je veux bien faire ma vie avec toi, Roger, reprit-elle, même en dehors du mariage ; mais à la condition que la luxure n'en soit pas la base. Je serais si herseuse si on pouvait s'associer pour construire une sorte de Panthéon pour deux âmes sauvées de la matière !
Barbaïra releva la tête, surpris par ces paroles qu'il entendait pour la première fois.
- Le mariage, reprit-elle ; le mariage tel que tu l'entends, hélas ! C'est le péché sans honte, l'encouragement officiel à la descente au sein de la matière. Je voudrais au contraire y trouver un affranchissement débouchant sur une vie plus lumineuse et pure...
Barbaïra frissonna. Les tours du Château Comtal prenaient devant lui une redoutable force de présence. Dans l'ombre se mouvaient les hommes d'armes de Simon de Montfort en train d'organiser le siège de la Cité. Il lui semblait apercevoir, derrière les vitraux du château, réfugiées sous la protection de Trencavel le preux, les belles châtelaines cathares qui le regardaient avec angoisse et lui parlaient.
- J'avais espéré te convaincre, reprit Auda, t'amener jusqu'à moi par le moyen d'une vérité qu'on ne découvre pas dans les auberges de la jeunesse ; afin que nous arrivions à vivre l'un près de l'autre sur la base d'une absence de tout désir.
- Mais tu ne m'as jamais parlé du mariage comme tu m'en parles ce soir, Auda ! Je ne suis pas d'accord ! Le mariage, pour moi, c'est la base même de la vie ! Je veux t'épouser pour assurer mon éternité par les enfants que tu me donneras. Car c'est la seule éternité qui ne relève pas de la fumisterie !
La fille se tordit les mains et gémit.
- Ah ! Tu veux des enfants pour en faire des guerriers, les jeter dans des aventures coupables comme celle que nous vivons maintenant, et perpétuer ainsi le mal !!!
Il haussa les épaules.
- L'état guerrier est le plus noble de tous ! Et si mes ancêtres avaient montré des vertus guerrières plus solides, je serais toujours comte de Miramont et le Languedoc libre !
Auda gémit de nouveau.
- Oh ! Mon pauvre Roger, tu parles le langage que le diable a mis dans la bouche des hommes pour les aider à se tromper sur eux-mêmes !
Elle posa de nouveau une main sur le bras du garçon, approcha sa bouche de son visage et Barbaïra se sentit pris de vertige, soulevé par un furieux désir de la saisir, la battre, avant de la posséder. Elle lui souffla au visage, parlant presque bouche à bouche :
- Cher Roger, je tiens suffisamment à toi pour te demander de me jurer que tu ne t'engageras jamais dans cette guerre !
La guerre battait furieusement le pied des murailles de Carcassonne autour d'eux. Simon de Montfort venait de se lancer à l'assaut du bourg au chant de « Veni Sancte Spiritus ». Faiblement protégé le bourg cédait malgré l'héroïsme du vicomte Trencavel et de ses chevaliers. Mais le Castellar, lui, repoussait l'assaut. L'odeur des corps en état de décompositions ajoutait aux effluves pestilentiels des grands marécages entourant la Cité, du côté de l'Aude... Mineurs au travail. Trébuchets en action. Chocs sourds des boulets de pierre. Cris exaltés des assaillants. Défis et injures des assiégés. Les cigales du 8 août produisaient ce bruit de vapeur surchauffée quand elles frottent leurs élytres avec un ensemble parfait...
Les hommes de Simon s'étaient introduits dans le Castellar en fin de journée, puis retirés, laissant derrière eux une faible garnison que Trencavel se hâtait d’anéantir pendant la nuit suivante pour reconquérir la position. Dans leur camp où le lin blanc des tentes, la soie des bannières allongeaient des parterres de fleurs pourpres ou bleues, les grands barons du Nord surveillaient les opérations.
Depuis les lisses hautes dont il dirigeait la défense, Roger Barbaïra, comte de Miramont, apercevait de temps à autre, groupés autour du légat du Pape, le comte de Saint-Pol, Henri IV de Nevers et Eudes de Bourgogne...
Derrière les barons francs, marchant dans la lancée de sept siècles de servitude, apparaissaient maintenant les grands barons germaniques : Von Rundstedt, Von Reichenau, Von Bock, entourés de leurs capitaines, Rommel, Guderian, Sepp Dietrich...
Roger Barbaïra dit à la fille :
- Tu n'as rien à craindre. Je ne m'engagerai pas dans cette guerre tant que l'Allemagne ne prendra pas position sur l'indépendance de notre pays. Mais je ne puis jurer, car je suis prêt à m'allier avec le diable pour reconquérir Carcassonne et Miramont.
Le froid les saisit. Les couples s'étaient dissous dans l'ombre mauve, puis noire. Auda Isarn avait retiré la main qu'elle venait de livrer comme un gage d'amour ineffable.
- Viens, dit Roger. Nous allons dîner à la maison. Tu as le temps. Et mon père sera heureux de te connaître. Car depuis des années que je lui parle de toi sans te présenter il doit penser que je suis amoureux du fantôme d'Esclarmonde !
Ils quittèrent l'assise du chemin de ronde devenue plus froide qu'une pierre de tombe. Barbaïra referma son armure de cuir et enfonça le casque heaume sur son chef.
Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | | |
Imprimer | | |
06/05/2022
La primauté du cœur (Pierre-Yves Lenoble)
Pierre-Yves Lenoble, La Dame Déleste – La tradition secrète des « fidèles d'amour » islamo-chrétiens, Chapitre III – L'Amor, La Mort, L'A-Mor et l'Âme-Or, pp. 37-38, aux éditions Fiat Lux
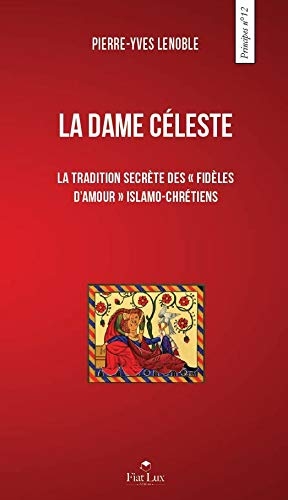
« ...Cette poésie courtoise spécifiquement destinée aux hommes d'action, on l'a dit, comporte une forte teneur initiatique et propose en filigrane les conditions, les moyens et les fins dont dispose le chevalier profane, c'est-à-dire le néophyte, afin de petit à petit transfigurer son être et d'assurer le salut définitif de son âme.
Le premier élément que nous souhaitons aborder concerne l'état d'être et d'esprit dans lequel le novice doit obligatoirement se mettre, soit la condition nécessaire de purification et de probation, pour obtenir la qualification requise et mener à bien son long processus d'initiation.
En clair, il est important de comprendre que la doctrine métaphysique professée par la poésie courtoise ne peut être appréhendée qu'après un nécessaire retour sur soi : c'est un savoir de nature ontologique qui ne doit pas rester extérieur à l'élève et qui suppose une implication plénière de l'être individuel.
Ainsi donc, on peut s'apercevoir que les « Fidèles d'Amour » islamo-chrétiens, en conformité avec tous les enseignements traditionnels, ont à l'unanimité affirmé la primauté du cœur en tant qu'organe subtil où s'opèrent les visions théophaniques, et en ont fait symboliquement le siège intérieur de l'intelligence et de l'amour qui seul permet la réunion harmonieuse entre le Connaître et l'Être. »
Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | | |
Imprimer | | |
03/05/2022
Notes sur l'image de la « Sainte » et l'image de la « Fée »
Laurent Guyénot, La mort féerique – Anthropologie du merveilleux (XIIe-XVe siècle), Chapitre II Sainteté, royauté et chevalerie, Culture cléricale et culture laïque, pp. 56-57, Éditions Gallimard, nrf

« ...Comme l'opposition entre culture populaire et culture des élites, l'opposition entre culture cléricale et culture laïque est donc à juste titre relativisée par quelques historiens comme Carl Watkins ou John Van Engen. Ils critiquent également l'idée que la culture laïque serait plus imprégnée de « survivance païennes » que la culture cléricale. D'un côté, le « paganisme » dénoncé par les clercs rigoristes dans certains jeux ou rites populaires est largement rhétorique ; la plupart du temps, il ne s'agit que de particularismes locaux auxquels se prêtent les prêtres de paroisse. De l'autre côté, la culture cléricale s'est depuis toujours imprégnée de rites et croyances d'origine préchrétienne, où elle a puisé une part immense de ses traits médiévaux.
Un histoire tirée d'un des recueils de Miracles de la Vierge qui fleurissent au XIIe siècle permet d'illustrer cette proximité entre les deux cultures dans le domaine narratif. Un certain chanoine de Pise était dévoué à la Vierge et récitait chaque jour en son honneur les offices connus sous le nom des « Heurs de la Vierge ». Lorsque ses parents moururent en lui laissant un héritage important, ses amis le poussèrent à se marier. Il délaissa peu à peu le service de la Vierge, mais, le jour de son mariage, elle lui apparut pour lui reprocher le déclin de son affection et lui interdire de se marier. Le mariage eut pourtant lieu, mais la nuit même l'homme quitta sa femme et son foyer et jamais plus on ne le revit. Voilà une histoire qui met à mal la frontière entre le miraculeux chrétien et le merveilleux féerique. La Vierge se comporte en effet exactement comme certaines fées (Fadas) que mentionne un peu plus tard Gervais de Tilbury, dont les amants mortels, « quand ils voulurent se marier avec d'autres femmes, (...) moururent avant d'avoir pu s'unir charnellement à elles » (Otia, III, 86). « Est-ce un hasard », doit-on se demander avec Pierre Gallais, « si l'émergence des fées, telles que nous les connaissons, coïncide sans doute avec la grande popularisation du culte de Notre-Dame ? »
Guillaume de Malmesbury (De Gestis regnum Anlorum, II, 205) raconte à la même époque l’histoire d'un jeune marié qui avait passé innocemment son alliance au doigt d'une statue de Vénus et se vit dans l'impossibilité de consommer son mariage, car une créature à « la consistance d'un nuage et la densité d'un corps » s'insinuait toujours entre lui et son épouse. Sur les conseils d'un prêtre orthodoxe, il dut se rendre à un carrefour en pleine nuit pour remettre une lettre au conducteur d'une procession fantomatique dans laquelle Vénus apparaissait telle « une femme attifée comme une prostituée chevauchant une mule (...), presque nue en raison de la minceur de ses vêtements, (qui) se répandait en attitudes impudiques ». La nette ressemblance entre cette troupe et celle des morts errants connue sous le nom de « mesnie Hellequin » laisse soupçonner que Guillaume s'inspire ici d'une de ces histoires de revenante amoureuse dont nous parlerons au chapitre x. Il adopte une convention simultanément chrétienne faisant de Vénus une prostituée mortelle. Ainsi se trouve illustré le caractère mutant des schémas narratifs, qui circulent aisément d'un registre à l'autre. »
Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | | |
Imprimer | | |


