28/01/2023
Saint-Bloy contre les historiens, journalistes et autres puritains ! (Première partie)
Léon Bloy, Le désespéré, Deuxième partie – La Grande Chartreuse, pp.177-, éditions GF Flammarion

Léon Bloy dans le vent - Nabe
[XXXIII]
Marchenoir sentit bientôt la nécessité de travailler. Il n'était pas homme à rester longtemps vautré sur une pensée de douleur, quelque atrocement exquise qu'elle lui parût. Il méprisait les Sardanapales et leurs bûchers et il se serait défendu, avec des moignons pleuvant le sang, jusque sur l'arrête la plus coupante du dernier mur de son palais de cristal. Combinaison surprenante du rêveur et de l'homme d'action, on l'avait toujours vu bondir du fond de ses accablements et se déracinait lui-même, du fumier de ses dégoûts, aussitôt qu'il commençait à se sentir bon à paître.
Les deux seuls livres qu'il eût encore publiés : une Vie de sainte Radegonde et un volume critique intitulé Les impuissants, il les avait écrits sur un pal rougi au feu, en plein milieu de la Méduse, sans espérance de rencontrer un éditeur qui le recueillit, avec la crainte continuelle de devenir enragé.
Le premier et le plus important de ces deux ouvrages avait été, sans comparaison, le plus immense insuccès de l'époque. Pavoisée du catholicisme le plus écarlate, cette éloquente restitution de la société Mérovingiennes s'était vue, dés son apparition, envelopper et emmailloter, avec une attention infinie, par les catholiques eux-mêmes, dans des les bandelettes multipliées du silence le plus égyptien. C'était pourtant une chose réellement grande, ce récit hagiographique, tel qu'il avait été conçu et exécuté ! Un tel livre, si la presse eût daigné seulement l'annoncer , était, – à l'heure favorable où Michelet, le vieil évocateur sans conscience de quelques images du passé, laissait, en mourant, le champ libre aux cultivateurs du chiendent de l'histoire exclusivement documentaire. Car on ne voit plus que cela, depuis la mort de ce sorcier : des idolâtres du document, en histoire aussi bien qu'en littérature et dans tous les genres de spéculation, – même en amour, où le sadisme a entrepris, dernièrement, de documenter le libertinage. C'est la pente moderne attestée par le renflement scientifique de la plus turgescente vanité universelle.
Marchenoir, esprit intuitif et d'aperception lointaine, par conséquent toujours aspiré en deçà ou au delà de son temps, ne pouvait avoir qu'un absolu mépris pour cette sciure d'histoire apportée, chaque jour, par les médiocres ébénistes de l’École des Chartes, au panier de la guillotine historique où sont décapités les grands concepts de la Tradition. Il avait donc entrepris de protester contre cette réduction en poussière de tout le passé par la résurrection intégrale d'une société aussi défunte que les sociétés antiques et dont les débris physiques, transformés mille fois depuis dix siècles, ont pu servir à toutes les vérifications géologiques ou potagères du néant de l'homme.
Dans cette Légende d'or de l'histoire de France qu'il s'imaginait toujours entendre chuchoter à son oreille, comme un grand conte plein de prodiges, et qui lui semblait la plus synthétiquement étrange, la plus centralement mystérieuse de toutes les histoires, – rien ne l'avait autant fasciné que cette énorme, terrible et enfantine épopée des temps Mérovingiens. La France préludait, alors, à l'apostolat des monarchies occidentales. Les évêques étaient des saints, dans la main desquels la Gentilité barbare s'assouplissait lentement, comme une cire vierge, pour former, avec la masse hétérogène du monde gallo-romain, les rayons mystiques de la ruche de Jésus-Christ. Du milieu de ce chaos de peuples vagissants, au-dessus desquels planait l'Esprit du Seigneur, on vit s'élever, à travers le brouillard tragique des prolégomènes du Moyen Age, une candide enragée de cierges humains dont les flammes, dardées au ciel, commencèrent, au sixième siècle, la grande illumination du catholicisme dans l'Occident.
Marchenoir avait choisi sainte Radegonde, un de ces luminaires tranquilles et, peut-être, le plus suave de tous. A la clarté de cette faible lampe non encore éteinte, il avait cherché les âmes des anciens morts dans les cryptes les moins explorées de ces très vieux âges. A force d'amoureuse volonté et à force d'art, il les avait tirées à la lumière et leur avait donné les couleurs d'une recommençante vie.
Le plus difficile effort que puisse tenter un moderne, la transmutation en avenir de tout le passé intermédiaire, il l'avait accompli, autant que de tels miracles soient opérables à l'esprit humain toujours opprimé d'images présentes, et il était arrivé à une sorte de vision hypnotique de son sujet, qui valait presque la vision contemporaine et sensible. Cette œuvre, positivement unique, dégageait une si nette sensation de recul que le houlement océanique de trente génération postérieure devenait une conjecture, un thème d'horoscope, une dubitable rêverie de quelque naïf moine gaulois que la rafale de la conquêt aurait poussé sur une falaise de désespérée vaticination.
Les figures angéliques ou atroces de ce siècle, Chilpéric, le monarque aux finesses de mastodonte, et sa venimeuse femelle Frénégonde, la Jésabel d'abattoir ; le chenil grondant des leudes ; les évêques aux impuissantes mains miraculeuses, Gremain de Paris, Grégoire de Tours, Prétextat e Rouen, Médard de Noyon ; quelques pâles troènes poussés, à la grâce de Dieu, dans les cassures, les Galswinthe, les Agnès, les Ragegonde, types rudimentaires de la toute-puissante dame des temps chevaleresques ; enfin l'ultime chalumeau virgilien, l'aphone poète Venantius Fortunatus ; – tous ces trépassés archiséculaires, Marchenoir les avait évoqués si souverainement qu'on croyait les voir et les entendre, dans l'air sonore d'une cristalline matinée d'hiver.
Et ce n''est pas tout encore. Il y avait la fresque des concomitantes aventures de l'univers, peintes dans l'ombre ou dans la pénombre, mais à leur plan rigoureux, pour l'horizonnement de ce vaste drame : Justinien et Bélisaire et toute la gloire de boue du Bas-Empire ; les Goths et les Lombards piétinant le fumier romain en Italie et en Espagne, et la précaire Papauté de ce monde en ruines ; puis, au loin, du côté de l'Asie, l'immense rumeur fauve du réservoir barbare, que chaque oscillation de la planète faisait couler un peu plus du côté de la malheureuse Europe, sans parvenir à l'épuiser, jusqu'à Gengis-Khan, qui retourna, d'un seul coup, sur la civilisation occidentale, cette cuvette de cinquante peuples !
Pour ce livre de trois cents pages, à peine, qui lui avait coûté trois ans, Marchenoir s'était fait savant. Il s'était documenté jusqu'à la racine des cheveux. Mais il pensait que le document est, comme le vin, et, en général, comme toutes les choses qui soûlent, aussi sot maître qu'intelligent serviteur. Il en avait souvent constaté le mutisme et l'infidélité. En conséquence, il l'avait utilisé avec une hauteur pleine de défiance, le rejetant avec dégoût quand il violait, en bégayant, l'intégrité d'une conception générale de l'expérience lui avait démontrée plus sûre ; – méthode de travail qu'un pète-sec à tête vipérine de la Revue des sciences historiques avait fort blâmée et qui l'eût fait conspuer de toute la critique contemporaine, si cet attelage châtré du tape-cul de M. Renan était idoine à répercuter un chef-d’œuvre.
D'ailleurs, la nature hagiographique de son sujet ne pouvait guère attirer à son livre que des lecteurs catholiques ou des admirations religieuses. Or, le rédacteur en chef de la plus considérable feuille catholique de Paris ayant lui-même autrefois, sur les saintes mérovingiennes, une inerme brochure tombée presque aussitôt dans le plus vertical oubli, il devait à sa propre gloire de ne pas accorder le moindre secours de publicité à ce téméraire nouveau venu qui pouvait devenir un supplantateur. Il est vrai qu'à défaut de cette excellente raison d’État littéraire, le mépris infini des catholiques pour toute œuvre d'art eût abondamment suffi. Bref, ce crevant de misère fut absolument privé de tout moyen d'informer le public de l'existence de son livre et les sages conclurent, comme toujours, du néant de la réclame au néant de l’œuvre.
Le fait est que, pour des haïsseurs aussi résolus de la beauté littéraire, Marchenoir était une occasion peu commune. C'était un lépreux de magnificence. Toutes les maladies dégoûtantes ou monstrueuses qui peuvent justifier, analogiquement, l'horreur des chrétiens actuels pour un malheureux artiste : la gale, la teigne, la syphilis, le lupus, la plique, le pian, l'éléphantiasis, il les accumulait, à leurs yeux, dans sa forme d'écrivain.
Ce fut surtout dans son second livre, les Impuissants, que cette flore éclata. Le scandale fut si grand qu'il lui valut un demi-succès. L'auteur commençait à être connu et l'apparition de ce recueil satirique, déjà publié en articles hebdomadaires, dans un petit journal où ils avaient été fort remarqués, démasqua, d'un coup, le polémiste formidable, caché jusqu'alors, pour beaucoup de gens, sous le contemplatif dédaigné, et qu'une dévorante soif de justice contraignait enfin à sortir. Il y eut une petite clameur de huit jours et tel fut le quartier de gloire que Paris voulut bien jeter à cet artiste qui s'exterminait depuis des années. Mais ce livre fut une révélation pour Marchenoir lui-même, qui ne se connaissait pas cette sonorité de gong quand l'indignation le faisait vibrer.
Par l'effet d'une loi spirituelle bien déconcertante, il se trouva que la forme littéraire de cet enthousiaste était surtout consanguine de celle de Rabelais. Ce style en débâcle et innavigable qui avait toujours l'air de tomber d'une alpe, roulait n'importe quoi dans sa fureur. C'étaient des bondissements d'épithètes, des cris à l’escalade, des imprécations sauvages, des ordures, des sanglots ou des prières. Quand il tombait dans un gouffre, c'était pour ressauter jusqu'au ciel. Le mot, quel qu'il fût, ignoble ou sublime, il s'en emparait comme d'une proie et en faisait à l'instant un projectile, un brûlot, une engin quelconque pour dévaster ou pour massacrer. Puis, tout à coup, il redevenait, un moment, la nappe tranquille que la douce Radegonde avait azurée de ses regards.
Quelques-uns expliquaient cela par un abject charlatanisme, à la façon du Père Duchesne. D'autres, plus venimeux, mais no pas plus bêtes, insinuaient la croyance à une sorte de chantage constipé, furieux de ne jamais aboutir. Personne, parmi les distributeurs de viande pourrie du journalisme, n'avait eut l'équité ou la clairvoyance de discerner l'exceptionnel sincérité d'une âme ardente, comprimée, jusqu'à l'explosion, par toutes les intolérables rengaines de la médiocrité ou de l'injustice.
Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | | |
Imprimer | | |
15/08/2020
Les larmes de Marie (Léon Bloy - Le symbolisme de l'apparition)
Léon Bloy, Le symbolisme de l'apparition, Troisième partie : Les larmes de Marie, pp. 191-193, aux éditions Rivages poche/Petite Bibliothèque
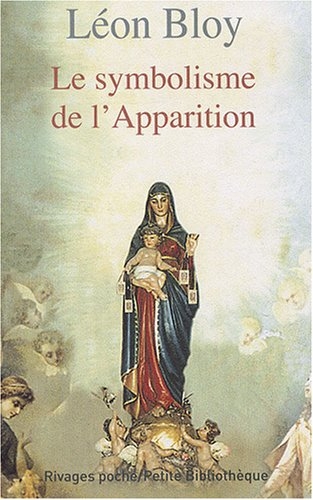
Je reviens à ces larmes de Marie, dont j'ai déjà dit quelque chose, et par lesquelles je dois finir.
Ces larmes précèdent, accompagnent et suivent le Discours. Elles en sont le plus éloquent commentaires et la plus vivante poésie. Les Larmes de la Mère des Douleurs remplissent l’Écriture et débordent sur tous les siècles. Toutes les mères, toutes les veuves, toutes les vierges, qui pleurent n'ajoutent rien à cette effusion surabondante qui suffirait pour laver les cœurs de dix mille mondes désespérés. Tous les blessés, tous les dénués et tous les opprimés, toute cette procession douloureuse qui encombre les atroces chemins de la vie, tiennent à l'aise dans les plis traînants du manteau d'azur de Notre-Dame des Sept Douleurs . Toutes les fois que quelqu'un éclate en pleurs, dans le milieu de la foule ou dans la solitude, c'est elle-même qui pleure, parce que toutes les larmes lui appartiennent en sa qualité d'Impératrice de la Béatitude et de l'Amour. Les Larmes de Marie sont le Sang même de Jésus-Christ, répandu d'une autre manière, comme sa Compassion fut une sorte de crucifiement intérieur pour l'Humanité sainte de Son Fils. Les Larmes de Marie et le Sang de Jésus sont la double effusion d'un même cœur et l'on peut dire que la Compassion de la Sainte Vierge était la Passion sous sa forme la plus terrible. C'est ce qu'expriment ces paroles adressées à Sainte Brigitte : « L'affliction du Christ était mon affliction parce que son cœur était mon cœur ; car comme Adam et Eve ont vendu le monde pour une seule pomme, mon Fils et moi, nous avons racheté le monde avec un seul Cœur. »
(...) Les Larmes de la Sainte Vierge ne sont mentionnées dans l’Évangile qu'une seule fois, lorsqu'elle prononce sa quatrième Parole, après avoir retrouvé Son Fils.
Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | | |
Imprimer | | |
17/11/2015
Le Cœur du Monde (La Grande Touriste)
"La France, ai-je dit ailleurs, est tellement le premier des peuples que tous les autres, quels qu'ils soient, doivent s'estimer honorablement partagés quand ils sont admis à manger le pain de ses chiens. Quand elle est heureuse, le reste du monde est suffisamment heureux, dût-il payer ce bonheur de la servitude et de l'extermination."
Léon Bloy
Pour retrouver la Gaule, il faut ajouter la Belgique à l'Hexagone et en retrancher l'Aquitaine. Une soixantaine de tribus celtes y vit encore, bien cachée sous d'innocents toponymes : Paris pour les Parises, Nantes pour les Namnètes, Bourges pour les Bituriges, Troyes pour les Tricasses, Poitiers pour les Pictons, Périgueux pour les Pétrocores, et cætera. Quoiqu'on en dise, ils conservent jusqu'à nos jours une certaine homogénéité ethnique. Que l'on nous permette d'en étudier ici le caractère.
D'après les auteurs antiques, les Gaulois sont vantards, ingénieux et très propres (ce sont même eux qui ont inventé le savon). Pour savoir le temps qu'il va faire, ils égorgent leurs semblables et lisent dans leurs dernières convulsions. Ils ne respectent pas les traités, s'enflamment volontiers pour qui leur semble victime d'injustice. Ils sont fougueux dans l'attaque mais ils se découragent facilement. Nous dirons qu'ils sont un peu bipolaires. Curieux de l'étranger, ils posent beaucoup de questions aux voyageurs. Dans leurs familles, le père a droit de vie et de mort sur ses enfants.
Les Gaulois vénèrent le ciel, les montagnes, les rivières, les animaux et les vieux chênes. Ils élèvent des autels aux croisements des routes. Des prêtres appelés druides assurent seuls la cohérence de leur territoire : ils se réunissent tous les ans en son centre géométrique, quelque part dans la forêt des Carnutes. Sinon, les Gaulois n'ont ni roi, ni langue, ni état qui les unisse. Quand Vercingétorix entreprend de les fédérer contre César, il est banni par sa propre tribu : c'est dire si l'idée nationale leur pose problème. "Terrifiant par son physique, son armement, son intelligence, son nom même", le chef arverne parvient néanmoins à tenir Rome en respect.
Vers l'an zéro, Vercingétorix commet l'inexplicable erreur de s'enfermer dans l'oppidum d'Alésia, où il est capturé. Avec tous les honneurs qui lui sont dûs, César l'amène à Rome et le fait étrangler sur l'autel de Jupiter. Les Gaulois en déduisent qu'ils sont Romains depuis toujours. Leur pays se hérisse de villes, tandis qu'ils se prosternent devant l'empereur et apprennent le latin. Mais bientôt, ils se laissent trucider par leurs maîtres en leur riant au nez. Ils fondent les statues d'or de l'Auguste pour en faire des reliquaires. De Rome à Rome, les Gaulois deviennent catholiques. Cinq siècles plus tard, Clovis le Franc salien est leur nouveau seigneur. Il demande le baptême et troque le crapaud pour le lys à trois pétales, ce qui persuade les Gaulois qu'il sont Français, à jamais.
L'ombilic du pays se déplace. Des Carnutes, il migre à Paray-le-Monial, puis à Rocamadour. Entre-temps, les Francs s'organisent pour ne pas disloquer le royaume dans les querelles d'héritage. Vers l'an mil, la loi salique est actée : est Roi le fils aîné du Roi quand le Roi meurt, point barre. Mais cela ne suffit pas à faire tenir ensemble les morceaux. Un siècle plus tard, Louis VII répudie Aliénor d'Aquitaine. Vexée, celle-ci s'offre en mariage au Roi d'Angleterre et avec elle, la moitié du pays. Dans le Sud, des Gaulois se catharisent et contestent l'autorité de Louis VIII, ce qui l'oblige à sévir. Survient ensuite une nouvelle catastrophe : Jean Ier meurt à trois jours, sans laisser de fils. Le Royaume est reconduit, moyennant quelques sanglantes transactions. Mais la trêve ne dure guère. Alors qu'il chemine à cheval dans la forêt du Mans, Charles VI est pris de folie. Il tue quatre hommes de sa garde avant d'être maîtrisé. Ses oncles prennent la régence mais ne tardent pas à s'entretuer. Il faudra cent ans de guerre et une bergère analphabète pour reconstituer la France.
La monarchie des Francs ne vaut pas cher. Les Mérovingiens sont faibles, les Carolingiens sont fainéants, les Capétiens sont fourbes. Après quatorze siècles de patience, les Gaulois coupent enfin la tête de Louis XVI, qui fut pourtant le plus Gaulois de tous les souverains de leur Histoire. Ils proclament ingénument que Paris suffit désormais à faire la France et ce faisant, menacent toutes les têtes couronnées d'Europe. Il faudra encore des millions de morts et un général corse et pour maintenir à peu près intactes leurs frontières.
Puis, pendant tout le dix-neuvième siècle, la France se cherche. A court d'arguments, Napoléon III entreprend des fouilles archéologiques à Alésia, devenue Alise-Sainte-Reine. Les Gaulois découvrent hébétés que leurs ancêtres sont Gaulois. Pour marquer le coup, l'empereur commande une statue de Vercingétorix. Le colosse fait près de sept mètres. Il a des cheveux longs et une grosse moustache. Comme il est impossible de le coucher, il est convoyé debout depuis Paris jusqu'en Bourgogne. Sur son passage, les Gauloises s'agenouillent et font le signe de Croix, croyant saluer « Saint Gétorix ». Mais Napoléon III n'en perd pas moins son trône avec l'Alsace et la Lorraine, et la France se décide enfin pour le statut de Chose Publique.
A l'orée du vingtième siècle, un curé soudainement enrichi prétend avoir trouvé un trésor. Le nouveau centre du pays enchanté se situerait dans sa paroisse, à Rennes-le-Château. Une enquête révèle qu'il prospérait sur la crédulité de ses fidèles. Malgré l'avertissement, des Gaulois se précipitent dans la petite bourgade du Roussillon et finissent en hôpital psychiatrique. Les autres, restés sains d'esprit, jurent de reprendre l'Alsace et la Lorraine et se ruent dans une guerre épouvantable dont il ressortent exténués. Hélas ! Quelques années plus tard, une deuxième guerre épouvantable les achève. Leurs patois disparaissent. Leurs familles se décomposent. Leurs campagnes se couvrent de carrefours giratoires et de centres commerciaux. Ils se surprennent alors à broyer du noir en marchant dans les sous-bois. De là à virer Charlie, il n'y a qu'un pas.
Aujourd'hui, la France est un petit pays coincé entre la Bretagne et la Belgique. Ses habitants s'accommodent tant bien que mal des inconvénients de la démocrature. Ils regardent bêtement les Arabes qui les appellent par leur vrai nom. A qui veut l'entendre, ils se vantent de ne pas supporter d'entendre parler de Dieu. Que Ton nom ne soit pas sanctifié, que Ton règne jamais n'arrive, telle est leur litanie secrète. Dans les enclaves royalistes, il se dit que le fils aîné du Comte de Paris ne peut prétendre au trône, car il est handicapé mental. Mais alors, qui est le Roi de France ?
Toute Histoire n'est jamais qu'une devinette. Chez les Gaulois rien n'a changé. Il y a le ciel, les montagnes, les rivières, les chevaux et les vieux chênes. Donc, le jour vient après la nuit et la mort n'existe pas.
Ainsi soit-il.

Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | | |
Imprimer | | |


