07/11/2022
Introduction à la Quatrième théorie politique (Alexandre Douguine)
Alexandre Douguine, La Quatrième théorie politique – La Russie et les idées politiques du XXIème siècle, Chapitre 1 – La Quatrième théorie politique, pp. 17-33, Ars Magna Éditions

La fin du XXème siècle - la fin de l’Époque moderne
Le XXème siècle s’est achevé mais nous commençons seulement maintenant à nous en rendre compte. Le XXème siècle a été le siècle des idéologies. Si, au cours des siècles passés, les religions, les dynasties, les couches sociales, les États-nations ont joué un rôle considérable dans la vie des peuples et des sociétés, au XXème siècle la politique s’est déplacée vers le domaine purement idéologique, recouvrant d’une nouvelle façon la carte du monde, des peuples et des civilisations. Les idéologies partiellement politiques incarnaient des tendances anciennes, profondes et civilisationnelles. Elles étaient également, en partie, particulièrement novatrices.
Toutes les idéologies politiques qui ont atteint leur pic de diffusion et d’influence au XXème siècle étaient une création des Temps modernes et incarnaient de façon diverse, voire sous des signes différents, l’esprit moderne. Aujourd’hui, nous quittons précipitamment cette époque. C’est pourquoi on mentionne de plus en plus souvent une « crise des idéologies », voire « la fin des idéologies » (1) (ainsi, la Constitution de la Fédération de Russie nie clairement l’existence d’une idéologie d’État). Il est donc temps d’examiner cette question plus en détails.
Les Trois principales idéologies et leur destin au XXème siècle
Les idéologies principales du XXème siècle ont été :
- le libéralisme (de droite et de gauche),
- le communisme (y compris le marxisme, ainsi que le socialisme et la social-démocratie),
- le fascisme (y compris le national-socialisme et d’autres variétés de « la troisième voie » - le national-syndicalisme de Franco, le justicialisme de Peron, le régime de Salazar, etc.).
Elles ont lutté entre elles non pas pour la vie mais jusqu’à la mort, formant, de fait, toute la dramatique et sanglante histoire politique du XXème siècle. Il serait logique d’attribuer à ces idéologies (les théories politiques) un numéro d’ordre – tant en vertu de leur importance qu’en fonction de leur ordre d’apparition, comme nous l’avons fait plus haut.
La Première théorie politique est le libéralisme. Il est apparu le premier (dès le XVIIIème siècle) et s’est avéré le plus stable et le plus fructueux, puisqu’il a fini par vaincre ses adversaires dans une épreuve de force historique. Par cette victoire, il a prouvé entre autres choses le bien-fondé de sa prétention à la totalité de l’héritage du siècle des Lumières. Aujourd’hui, il est évident que le libéralisme correspondait le plus exactement à l’Époque moderne. Bien que cela ait été auparavant contesté (notamment de façon dramatique, active et parfois convaincante) par une autre théorie politique - le communisme.
Il est juste de nommer le communisme (de même que le socialisme dans toutes ses variantes) Deuxième théorie politique. Elle est apparue après le libéralisme – en tant que réaction critique à l’établissement du système bourgeois capitaliste, dont le libéralisme était l’expression idéologique.
Et enfin, le fascisme constitue la Troisième théorie politique. En prétendant à sa propre interprétation de l’esprit de l’Époque moderne (de nombreux observateurs, dont Hannah Arendt (2), considèrent justement le totalitarisme comme une des formes politiques de l’Époque moderne), le fascisme s’adressait d’autre part aux idées et aux symboles de la société traditionnelle. Dans un cas cela a engendré l’éclectisme, dans d’autres - l’aspiration des conservateurs à prendre la tête de la révolution au lieu de lui résister et à mener la société dans un sens opposé (Arthur Moeller van den Bruck, D. Merejkovsky, etc.).
Le fascisme est apparu après les autres grandes théories politiques et a disparu avant elles. L’alliance des Première et deuxième théories politiques, ainsi que les erreurs géopolitiques suicidaires d’Hitler l’ont abattu en vol. La Troisième théorie politique a péri de « mort violente », sans connaître ni la vieillesse, ni la décrépitude naturelle (à la différence de l’URSS). C’est pourquoi ce spectre sanglant, ce vampire affublé de l’aura du « mal mondial », apparaît si attirant pour les goûts décadents de l’époque postmoderne et effraie jusqu’à maintenant l’humanité.
Le fascisme, après avoir disparu, a laissé place à un affrontement entre la Première théorie politique et la Deuxième. Il a eu lieu sous la forme de la Guerre froide et a donné naissance à la géométrie stratégique du monde bipolaire qui a perduré presque un demi-siècle. En 1991, la Première théorie politique (le libéralisme) a vaincu la Deuxième (le socialisme). Ce fut le crépuscule du communisme à l’échelle mondiale.
Donc, à la fin du XXème siècle, des trois théories politiques capables de mobiliser des masses de millions d’individus sur toute la surface de la planète, il n’en est resté qu’une, la théorie libérale. Or, alors qu’elle était restée la seule, tous se sont mis à évoquer à l’unisson « la fin des idéologies ». Pourquoi ?
La fin du libéralisme et le post-libéralisme
Il s’avère que la victoire du libéralisme (la Première théorie politique) a coïncidé avec sa fin. Mais ce paradoxe n’est qu’apparent.
Le libéralisme représentait initialement une idéologie pas aussi dogmatique que le marxisme, mais néanmoins philosophique, structurée et élaborée. Le libéralisme s’est opposé d’un point de vue idéologique au marxisme et au fascisme en leur menant une guerre non seulement technologique pour la survie, mais en défendant le monopole du droit à la formation du modèle du futur. Alors que les autres idéologies concurrentes étaient encore vivantes, le libéralisme perdurait et se renforçait précisément en tant qu’idéologie, c’est-à-dire en tant qu’ensemble d’idées, de manières de voir et de projets propres au sujet historique. Chacune des trois théories politiques possédait son sujet. Le sujet du communisme était la classe. Le sujet du fascisme - l’État (dans le fascisme italien de Mussolini) ou la race (dans le national-socialisme d’Hitler). Dans le libéralisme apparaît comme sujet l’individu, libéré de toutes les formes d’identité collective, de toute appartenance.
Alors que la lutte idéologique mettait en scène des adversaires formels, des peuples entiers et des sociétés pouvaient choisir (ne fût-ce que de façon théorique) le sujet sur lequel ils pouvaient se concentrer : la classe, la race, (l’État) ou l’individu. La victoire du libéralisme a résolu ce problème : l’individu est devenu le sujet normatif à l’échelle de toute l’humanité.
Apparaît alors le phénomène de la mondialisation, et le modèle de la société post-industrielle commence à se manifester, l’époque du postmoderne commence. Désormais, le sujet individuel n’apparaît plus comme le résultat d’un choix mais comme une certaine donnée générale obligatoire. La personne est libérée de « l’appartenance », l’idéologie « des droits de l’homme » devient communément acceptée (du moins – en théorie) et, dans les faits, obligatoire.
L’humanité, composée d’individus, tend naturellement vers l’universalité, devient globale et unifiée. Ainsi naît le projet d’« État mondial » et de « gouvernement mondial » (le globalisme).
Un nouveau niveau de développement technologique permet d’atteindre l’indépendance vis-à-vis des classes qui structurent les sociétés industrielles (post-industrialisme).
Les valeurs du rationalisme, de la scientificité et du positivisme sont perçues comme « des formes voilées des stratégies totalitaires répressives » (les grands narratifs) et se voient soumises à la critique tandis que parallèlement, on assiste à une glorification de la liberté totale et de l’indépendance du principe individuel vis-à-vis de tous les facteurs inhibant, y compris la raison, la morale, l’identité (sociale, ethnique, même sexuée), les disciplines, etc., (le postmoderne).
À cette étape, le libéralisme cesse d’être la Première théorie politique mais devient la seule pratique post-politique. La « fin de l’histoire » se profile alors, la politique est remplacée par l’économie (le marché mondial), les États et les nations sont entraînés dans le chaudron de la globalisation à l’échelle planétaire.
Vainqueur, le libéralisme disparaît, en se transformant en quelque chose d’autre, le post-libéralisme. Il ne comporte plus de dimension politique, il n’apparaît pas comme une question de libre choix mais devient une sorte de « destin » (d’où la thèse de la société postindustrielle : « L’économie est le destin »).
Donc, le début du XXIème siècle coïncide avec le moment de la fin des idéologies, qui plus est de toutes les idéologies. Elles ont connu des fins diverses : la Troisième théorie politique a été anéantie durant « sa jeunesse », la deuxième est morte caduque, la première est née une seconde fois sous une autre forme, le post-libéralisme, « la société de marché globale ». Mais dans tous les cas, sous la forme sous laquelle elles existaient au XXème siècle, elles n’apparaissent plus ni utiles, ni efficientes, ni adaptées. Elles n’expliquent rien et ne nous aident pas à comprendre le présent, pas plus qu’à répondre aux défis globaux.
De cette constatation découle le besoin d’une Quatrième théorie politique.
La Quatrième théorie politique comme opposition au statu quo
La Quatrième théorie politique ne peut pas nous être donnée par elle-même. Elle peut aussi bien apparaître que ne pas apparaître. La condition de son apparition est le désaccord. Le désaccord avec le post-libéralisme comme avec la pratique universelle, avec la mondialisation, avec le postmoderne, avec « la fin de l’histoire » ou du statu quo, avec le développement par inertie des principaux processus civilisationnels à l’aube du XXIème siècle.
Le statu quo et l’inertie ne supposent absolument pas de théorie politique. Le monde global doit être dirigé seulement par les lois économiques et la morale universelle des « droits de l’homme ». Toutes les décisions politiques sont remplacées par des techniques. La technique et la technologie remplacent par elles-mêmes tout le reste (le philosophe français Alain de Benoist appelle cela « la gouvernance »). En lieu et place des politiques qui prenaient les décisions historiques, on trouve des managers et des technologues optimisant la logistique de la gouvernance. Les masses d’êtres humains sont assimilées à une masse unique des objets individuels. C’est pourquoi la réalité post-libérale (la virtualité évinçant de plus en plus la réalité), conduit directement à l’abolition complète de la politique.
D’aucuns pourraient objecter ce qui suit : les libéraux « mentent » quand ils évoquent « la fin des idéologies » (ma polémique avec le philosophe A. Zinoviev portait précisément sur ce point), et, qu’en fait, ils restent fidèles à leur idéologie et refusent simplement aux autres le droit à l’existence. Cela n’est pas tout à fait le cas. Quand le libéralisme, position idéologique, devient le seul contenu de l’existant social et technologique présent, il ne s’agit déjà plus d’une « idéologie », il s’agit d’un fait existant, il s’agit de l’ordre des choses « objectif », qu’il n’est pas simplement difficile mais absurde de contester. Le libéralisme à l’époque du postmoderne passe de la sphère du sujet à la sphère de l’objet. Cela conduira à terme au remplacement complet de la réalité par la virtualité.
La Quatrième théorie politique se conçoit donc comme une alternative au post-libéralisme, non pas comme une position par rapport à une autre, mais comme idée opposée à la matière ; comme un possible entrant en conflit avec le réel ; comme un réel n’existant pas mais attaquant déjà le réel.
De plus, la Quatrième théorie politique ne peut pas être la suite ni de la Deuxième théorie politique, ni de la Troisième. La fin du fascisme, comme la fin du communisme, ont été non seulement des malentendus dus au hasard, mais également l’expression de la logique tout à fait claire de l’Histoire. Ils ont lancé un défi à l’Esprit moderne, le fascisme l’ayant fait presque ouvertement, le communisme de façon voilée (voir l’interprétation de la période soviétique comme version « eschatologique » de la société traditionnelle chez Mikhaïl Agoursky (3) ou Sergueï Kara-Mourza - 4), et ils ont perdu.
Ainsi, la lutte contre la métamorphose postmoderniste du libéralisme en postmoderne et en globalisme doit être qualitativement autre, se fonder sur des principes nouveaux et proposer de nouvelles stratégies.
Néanmoins, le point de départ de cette idéologie, possible mais non garantie, non fatale, non prédéterminée, résultant de la volonté libre de la personne, de son esprit, et non des processus historiques impersonnels, est notamment la négation de l’essence du postmoderne.
Cependant, cette essence (de même que la recherche malaisée des dessous de la modernité, qui a réalisé de façon tellement complète son contenu qu’elle a épuisé ses possibilités intérieures et est passée au stade ironique du recyclage des étapes passées), constitue quelque chose de tout à fait nouveau, d’auparavant inconnu et qui n’avait été prévu que de façon intuitive et fragmentaire lors d’anciennes étapes de l’histoire et de la lutte idéologique.
La Quatrième théorie politique apparaît donc comme un projet de « croisade » contre le postmoderne, la société postindustrielle, le projet libéral réalisé dans la pratique, le globalisme et ses fondements logistiques et technologiques.
Si la Troisième théorie politique critiquait le capitalisme à sa droite, et la Deuxième à sa gauche, à cette nouvelle étape, l’ancienne topographie politique n’existe plus : par rapport au post-libéralisme, il est impossible de définir où est la droite et où est la gauche. Il y a seulement deux positions : l’accord (le centre) et le désaccord (la périphérie). Qui plus est, l’un et l’autre sont globaux.
La Quatrième théorie politique constitue donc une concentration dans un projet et un élan communs de tout de ce qui s’est avéré abandonné, rejeté, humilié au cours de la construction de « la société du spectacle » (le postmoderne). « La pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle » (Évangile de Marc, 12:10). Le philosophe Alexandre Sekatsky indique justement l’importance « des marges » pour la formation d’un nouvel éon philosophique en proposant à titre de métaphore l’expression de « métaphysique des ordures ».
La bataille pour le postmoderne
La Quatrième théorie politique a affaire à une nouvelle incarnation de son vieil ennemi. Elle conteste le libéralisme, comme les Deuxième et Troisième théories politiques passées, mais le conteste dans un nouvel état. La nouveauté importante de cet état consiste en ce que seul le libéralisme, parmi les trois grandes idéologies politiques, a défendu son droit à l’héritage de la modernité et a obtenu le droit de former « la fin de l’histoire » sur la base de ses prémisses.
La fin de l’histoire aurait pu théoriquement être différente : « le Reich planétaire » (en cas de victoire des nazis), « le communisme mondial » (si les communistes avaient eu raison). Or, « la fin de l’histoire » s’est avérée précisément libérale (ce qu’avait pressenti le premier le philosophe Alexandre Kojève (5), dont les idées ont été reprises par Francis Fukuyama - 6). Mais puisqu’il en est ainsi, toute invocation de la modernité et de ses prémisses, auxquelles à un degré ou à un autre se référaient les représentants de la Deuxième (en grande partie) et de la Troisième théorie politique, perd sa pertinence. Elles ont perdu la bataille de la modernité moderne (les libéraux l’ont gagnée). C’est pourquoi, le thème de la modernité (comme d’ailleurs celui de la modernisation) peut être retiré de l’ordre du jour. La bataille de la postmodernité commence.
Et c’est précisément ici que s’ouvrent pour la Quatrième théorie politique de nouvelles perspectives. Ce postmoderne, qui se réalise aujourd’hui dans la pratique (le postmoderne post-libéral), annule la sévère logique de la modernité ; après que le but a été atteint, les étapes visant à l’atteindre perdent leur signification. La pression du corpus idéologique s’affaiblit. La dictature des idées se change en une dictature des objets, des codes d’accès (login-password), des codes-barres. De nouveaux trous apparaissent dans le tissu de la réalité postmoderne.
Comme en leur temps la Troisième et la Deuxième théorie politique (comprise comme la version eschatologique du traditionalisme) avaient tenté de « dompter la modernité » dans leur lutte contre le libéralisme (la Première théorie politique), il existe aujourd’hui une chance de réaliser quelque chose d’analogue avec le postmoderne, en utilisant précisément « les nouveaux trous » de ce dernier.
Contre les alternatives idéologiques rectilignes, le libéralisme a élaboré des moyens extraordinairement efficaces sur lesquels est fondée sa victoire. Mais celle-ci porte précisément en elle le plus grand risque pour le libéralisme. Il faut seulement déterminer ces nouveaux éléments dangereux pour le système mondial global, déchiffrer les codes d’accès pour forcer le système. Du moins, pour tenter de le faire. Les événements du 11 septembre à New York suggèrent que cela est possible, notamment d’une façon technologique. La société des réseaux peut offrir quelque chose même à ses adversaires déclarés. Dans tous les cas, il est nécessaire, en premier lieu, de comprendre le postmoderne et cette situation nouvelle d’une façon non moins profonde que celle dont Marx avait compris la structure du capitalisme industriel.
Dans le postmoderne, dans la liquidation du programme des Lumières et d’avènement de la société des simulacres, la Quatrième théorie politique doit puiser son « inspiration noire », en percevant cela comme une motivation pour la lutte, et non comme une donnée fatale. On peut tirer de cette situation certaines conclusions pratiques concernant la structure de la Quatrième théorie politique.
La réinterprétation du passé et les vaincus
Si les Deuxième et Troisième théories politiques sont inacceptables en tant que point de départ de l’opposition au libéralisme, particulièrement en raison de la façon dont elles se comprenaient elles-mêmes, de ce à quoi elles appelaient et de la façon dont elles ont agi, rien n’empêche de modifier l’interprétation du fait même de leur défaite comme quelque chose de positif. Puisque la logique de l’histoire des Temps modernes a amené au postmoderne, ce dernier constituait donc l’essence secrète (qui s’est dévoilée seulement vers sa fin) de ceux-ci.
Les Deuxième et Troisième théories politiques se vivaient elles-mêmes comme des candidates à l’expression de la modernité. Et ces prétentions ont échoué avec fracas. Tout ce qui, dans les anciennes idéologies, est lié à ces intentions non réalisées apparaît pour les créateurs de la Quatrième théorie politique comme le moins intéressant. Toutefois, le fait même qu’elles aient perdu, doit être considéré plutôt comme leur valeur que comme leur défaut. Après qu’elles ont perdu, elles ont prouvé par là-même qu’elles n’appartenaient pas à l’esprit moderne qui, à son tour, a conduit à la matrice post-libérale. Leur valeur réside précisément en cela. De plus, cela signifie que les représentants des Deuxième et Troisième théories politiques, qu’ils en soient conscients ou non, se trouvaient du côté de la Tradition, bien qu’ils n’en aient pas tiré les conclusions nécessaires et ne l’aient aucunement reconnu.
Il est nécessaire de repenser l’interprétation des Deuxième et Troisième théories politiques, après avoir déterminé ce qu’il convient de rejeter et ce qui offre une certaine valeur. En tant qu’idéologies finies ne visant qu’elles-mêmes, elles sont entièrement inappropriées, tant sur le plan théorique que pratique, mais certains de leurs éléments marginaux en général non réalisés et situés à leur périphérie ou dans l’ombre (évoquons à nouveau la « métaphysique des ordures »), peuvent, de façon inattendue, s’avérer extraordinairement précieux, riches de sens et d’intuitions.
Cependant, dans tous les cas, il est nécessaire de modifier l’interprétation des Deuxième et Troisième théories politiques à l’aide de nouvelles clés, depuis de nouvelles positions et seulement après avoir refusé tout crédit à ces structures idéologiques, sur lesquelles reposaient leur « orthodoxie ». Leur orthodoxie constitue le moins intéressant et le plus inutile en elles. Une lecture croisée de ces théories apparaîtra beaucoup plus productive : « Marx à travers un regard positif de droite » ou « Evola à travers un regard positif de gauche ». Mais un tel contenu « national-bolchevique » fascinant (dans l’esprit de N. Oustrialov ou d’E. Niekisch) ne suffit pas à lui seul car la construction mécanique des Deuxième et Troisième théories politiques en elle-même ne nous mènera nulle part. Ce n’est que rétrospectivement que nous pourrons dessiner les contours de leur zone de convergence, fermement opposée au libéralisme. Il s’agit d’une mesure méthodologique aussi utile qu’un échauffement, avant l’élaboration pleine et entière de la Quatrième théorie politique.
Une lecture réellement importante et décisive des Deuxième et Troisième théories politiques apparaît déjà possible seulement à la lumière de la Quatrième théorie politique une fois constituée, où le postmoderne et ses conditions figurent comme objet (bien que niés de façon radicale en tant que valeurs !) : le monde global, la gouvernance, la société de marché, l’universalisme des droits de l’homme, « la domination réelle du capital », etc.
Le retour de la Tradition et de la théologie
La tradition (la religion, la hiérarchie, la famille) et ses valeurs ont été jetées à bas à l’aube de la modernité. Sur le fond, les trois théories politiques étaient pensées comme des structures artificielles idéologiques d’individus interprétant (différemment) « la mort de Dieu » (F. Nietzsche), « le désenchantement du monde » (M. Weber), « la fin du sacré ». Voilà en quoi consistait le nerf de la Nouvelle ère : l’homme avait pris la place de Dieu, la philosophie et la science, celle de la religion, tandis que les structures rationnelles, volontaires et technologiques avaient remplacé la Révélation.
Or, si le moderne s’est épuisé dans le postmoderne, en même temps s’achève la période de lutte ouverte contre le religieux. La religion n’est pas hostile aux hommes du postmoderne, mais leur est indifférente. De plus, certains aspects de la religion ayant trait, en général, aux régions de l’enfer (« la texture des démons » des philosophes-postmodernistes), apparaissent assez attirants. Dans tous les cas, l’époque de la persécution de la Tradition est révolue bien que, selon la logique du post-libéralisme, cela nous amène, probablement, à la création d’une nouvelle pseudo-religion mondiale, fondée sur des bribes dépareillées de cultes syncrétiques, à un œcuménisme impétueux et chaotique, à la « tolérance ». Et bien qu’une telle évolution des événements soit d’une certaine façon quelque chose de plus terrible encore qu’un athéisme direct et irréfléchi et que le matérialisme dogmatique, l’affaiblissement des persécutions de la Foi peut devenir pour la foi une chance, si les porteurs de la Quatrième théorie politique se montrent conséquents et intraitables dans la protection des idéaux et des valeurs de la Tradition.
On peut aujourd’hui défendre au titre de programme politique ce qui était mis hors-la-loi par l’époque du moderne. Et cela n’a pas l’air aussi ridicule et vain que par le passé. Ne serait-ce qu’en raison du fait qu’en général, tout dans le postmoderne apparaît ridicule et vain, y compris ses éléments les plus glamours : ce n’est pas un hasard si les héros du postmoderne sont des freaks et des avortons, des travestis et des dégénérés, c’est la loi du genre. À côté des clowns mondiaux, rien ni personne n’aura l’air « trop archaïque », même les hommes de la Tradition ignorant les impératifs de la Nouvelle ère. Tant les succès notables du fondamentalisme islamique, que la renaissance de l’influence des sectes protestantes particulièrement archaïques (dispensationalistes, mormons, etc.) sur la politique des États-Unis (Bush a commencé la guerre en Irak parce que, d’après lui, « Dieu m’a dit : “Frappe en Irak !” », ce qui se situe tout à fait dans l’esprit de ses mentors méthodistes protestants) illustrent le bien-fondé de cette affirmation.
Ainsi, la Quatrième théorie politique peut de plein droit s’adresser à ce qui a précédé la modernité, et y puiser son inspiration. La reconnaissance de « la mort de Dieu » cesse d’être « une obligation impérieuse » pour ceux qui veulent rester sur la vague de l’actualité. Les individus postmodernes ont déjà tellement intériorisé cet événement qu’ils ne peuvent déjà plus le comprendre : « Qui est mort, dites-vous ? » Mais les concepteurs de la Quatrième théorie politique peuvent eux aussi complètement oublier cet « événement » : « Nous croyons en Dieu mais nous ignorons ceux qui enseignent sa mort, comme nous ignorons les paroles des fous ».
Ainsi, la théologie est de retour. Elle devient l’élément le plus important de la Quatrième théorie politique. Or, quand elle revient, le postmoderne (la mondialisation, le post-libéralisme, la société postindustrielle) s’identifie alors facilement au « règne de l’Antéchrist » (ou à ses analogues dans d’autres religions : « dajjal » chez les musulmans, « érev rav » chez les juifs, le « kali-yuga » chez les hindous, etc.). Et maintenant, il ne s’agit pas d’une simple métaphore mobilisant les masses, il s’agit d’un fait religieux, le fait de l’Apocalypse.
Mythe et tradition dans la Quatrième théorie politique
Si, pour la Quatrième théorie politique, l’athéisme des Temps modernes cesse d’être d’une certaine façon quelque chose d’obligatoire, la théologie des religions monothéistes, qui a évincé en son temps les autres cultures sacrées, ne constituera pas non plus la vérité en dernière instance (plus exactement elle peut l’être et peut ne pas l’être). Théoriquement, rien ne limite la profondeur de l’appel à d’anciennes valeurs archaïques, qui, correctement identifiées et comprises, peuvent parfaitement occuper une place déterminée dans une nouvelle structure idéologique. En se libérant de la nécessité de soumettre la théologie au rationalisme moderne, les porteurs de la Quatrième théorie politique peuvent tout à fait négliger ces éléments théologiques et dogmatiques, qui dans les sociétés monothéistes (particulièrement à leurs étapes tardives) ont été touchés par le rationalisme, ce qui, d’ailleurs, a précisément conduit à l’apparition sur les ruines de la culture chrétienne de l’Europe, dans un premier temps du déisme, puis de l’athéisme et du matérialisme au cours de la réalisation des étapes du programme des Temps modernes.
Non seulement il est possible de prendre comme bouclier les symboles supérieurs de la foi dépassant la raison mais aussi ces éléments irrationnels des cultes, les rites et les légendes, qui ont troublé les théologiens à des époques antérieures. Si nous rejetons le progrès comme idée propre à l’Époque moderne (qui, comme nous le voyons, s’est achevée), tout l’ancien retrouve pour nous sa valeur et sa force de conviction ne serait-ce que parce qu’il est ancien. Ancien signifie bon. Plus l’ancien est ancien, meilleur il est.
La plus ancienne des créations est le paradis. Les porteurs de la Quatrième théorie politique doivent dans le futur aspirer à le recouvrer.
Heidegger et « l’événement »
Et enfin, on peut noter le fondement profond, ontologique !, de la Quatrième théorie politique. Il faut s’adresser ici non aux théologies et aux mythologies, mais à l’expérience philosophique profonde du penseur, qui a réalisé une tentative unique de bâtir une ontologie fondamentale, la doctrine la plus généralisante, paradoxale, profonde et perçante sur l’être. Il s’agit de Martin Heidegger.
En bref, la conception de Heidegger est la suivante. À l’aube de l’idée philosophique, les hommes (les Européens, ou encore plus exactement, les Grecs) placent la question de l’être au centre de leur attention. Mais, en le thématisant, ils risquent de s’égarer dans les nuances de la relation particulièrement complexe entre l’être et la pensée, entre l’être au sens propre (Sein) et son expression dans le réel (Seiende), entre l’être humain (Dasein) et l’être en tant que tel (Sein). Cette inexactitude s’observe déjà dans la doctrine d’Héraclite sur la physis et le logos, ensuite elle apparaît évidemment visible chez Parménide, et enfin, chez Platon, qui pose les idées entre l’homme et le réel et qui a défini la vérité comme leur coïncidence (la théorie référentielle de la connaissance), cette inexactitude atteint son sommet. Apparaît alors ici une aliénation qui conduit graduellement à l’apparition de « la raison raisonnante », puis, au développement de la technique. Peu à peu, l’individu perd de vue son propre être et s’engage sur la voie du nihilisme. L’essence de la technique (fondée sur la relation technique au monde) exprime ce nihilisme qui s’accumule en permanence.
À l’Époque moderne, cette tendance atteint des sommets ; le développement technique (Gestell) évince définitivement l’être et porte sur le trône « le néant ». Heidegger détestait férocement le libéralisme, y compris son expression dans le « principe raisonnant », qui est à la base du « nihilisme occidental ».
Le postmoderne, que Heidegger n’a pas connu, est précisément dans tous les sens un oubli définitif de l’être, le « minuit », où le rien (le nihilisme) commence à apparaître dans toutes les fentes. Mais sa philosophie n’était pas totalement pessimiste. Il croyait que le rien est le verso même de l’être propre, qui, par cette image paradoxale, se rappelle à l’humanité. Et s’il est fondé de déchiffrer la logique du déploiement de l’être, l’humanité pensante peut se sauver, qui plus est instantanément, au moment même, où le risque sera maximum. « Là, où il y a le plus grand risque se trouve le salut », commente Heidegger citant les vers de Hölderlin (7).
Heidegger nomme ce retour soudain de l’être à l’aide d’un terme spécial, das Ereignis, « l’événement ». Il se produit exactement au milieu de la minuit mondiale, au point le plus noir de l’histoire. Heidegger lui-même hésitait constamment concernant la question de savoir si ce point était atteint ou s’il « n’y avait toujours rien ». Cet éternel « il n’y a toujours rien »…
Pour la Quatrième théorie politique, dans la philosophie de Heidegger peut se trouver ce principal axe, sur lequel on place tout le reste : la réinterprétation des Deuxième et Troisième théories politiques avant le retour de la théologie et de la mythologie.
Ainsi, au centre de la Quatrième théorie politique, en son centre magnétique en quelque sorte, se trouve le vecteur de l’approche de l’Ereignis, (« l’événement »), dans lequel s’incarnera le retour triomphal de l’être, précisément au moment où l’humanité l’aura définitivement et irrévocablement oublié, au point que ses dernières traces se seront évaporées.
La Quatrième théorie politique et la Russie
Aujourd’hui, certains conçoivent par intuition que dans « le merveilleux nouveau monde », le globalisme, le postmoderne et le post-libéralisme, la Russie n’ait pas sa place. Non seulement l’État et le gouvernement mondiaux évinceront graduellement tous les États-nations en général, le problème étant aussi que toute l’histoire russe consiste en une discussion dialectique avec l’Occident et la culture occidentale, en une lutte pour la défense de sa réalité russe profonde (parfois comprise seulement de façon intuitive), de son idée messianique, de sa version de « la fin de l’histoire », de quelque façon que cela s’exprimât – à travers l’orthodoxie de Moscou, l’empire laïc de Pierre le Grand ou la révolution communiste mondiale. Les meilleurs esprits russes ont clairement vu que l’Occident avance vers l’abîme et qu’aujourd’hui, en regardant là où l’économie néolibérale et la culture post-moderne ont mené le monde, nous pouvons pleinement nous assurer du fait que cette intuition, qui a poussé les générations de Russes à rechercher une alternative, était tout à fait fondée.
La crise économique mondiale actuelle n’est que le début. Le plus terrible reste à venir. L’inertie des processus post-libéraux est telle qu’un changement de cours est impossible, « la technique déchaînée » (Oswald Spengler) recherchera pour sauver l’Occident des moyens de plus en plus efficaces mais purement techniques et technologiques. Il s’agit de la nouvelle étape de l’arrivée du Gestell, la diffusion sur tout l’espace de la planète de la tache nihiliste du marché mondial. En allant d’une crise à une autre, d’une bulle à une autre (des milliers d’Américains descendent manifester les jours de crise en scandant: « Donnez-nous une nouvelle bulle ! », comment être plus sincère ?), l’économie globalisée et les structures de la société postindustrielle rendent la nuit de l’humanité de plus en plus noire, d’un tel noir que nous oublions graduellement que c’est la nuit. « Qu’est-ce que la lumière ? », se demandent ceux qui ne la voient jamais.
Il est clair que la Russie doit suivre une autre voie. Mais une question se pose alors. Dévier de la logique du Postmoderne dans « un seul pays pris isolément » ne s’avérera pas si simple. Le modèle soviétique s’est écroulé. Après cela, la situation idéologique a changé de façon irréversible, de même que l’équilibre stratégique des forces. Pour que la Russie puisse se sauver et sauver les autres, il ne suffit pas d’inventer un quelconque moyen technique ou une manœuvre destinée à tromper. L’histoire mondiale a une logique. Et « la fin des idéologies » n’est pas due à un dysfonctionnement accidentel mais au début d’une nouvelle étape. Selon toute apparence, la dernière.
Dans une telle situation, le futur de la Russie dépend directement de nos efforts pour produire une Quatrième théorie politique. En choisissant localement les variantes que nous accorde la mondialisation seulement dans un mode de correction superficielle du statu quo, nous n’irons pas loin, nous ne pourrons que faire durer le temps. Le défi du postmoderne s’avère extraordinairement sérieux : il s’enracine dans la logique de l’oubli de l’être, dans le renoncement de l’humanité aux sources (ontologiques) de son être et à ses sources spirituelles (théologiques). Lui répondre par des innovations illusoires ou par des ersatz de communication est impossible. Donc, pour trouver une solution aux problèmes essentiels - la crise économique globale, les résistances au monde unipolaire, la préservation et le renforcement de la souveraineté, etc., il est nécessaire de s’adresser aux principes philosophiques de l’histoire, de faire un effort métaphysique.
On ne saurait dire comment se déploiera le processus d’élaboration de cette théorie. Une chose est claire : ce ne peut être une tâche individuelle pas plus que celle d’un petit cercle d’individus. L’effort doit être synodique, collectif. Les représentants d’autres cultures et d’autres peuples (d’Europe, ainsi que d’Asie), qui se rendent compte également de façon aigüe de la tension eschatologique du moment présent et cherchent aussi avec acharnement la sortie de l’impasse mondiale, nous aideront grandement dans cette tâche.
Cependant, on peut affirmer d’avance que la Quatrième théorie politique, fondée sur le rejet du statu quo actuel dans sa dimension pratique et théorique, dans sa variante russe sera orientée vers « l’Ereignis russe ». Vers « l’événement », unique et exceptionnel, qui a fait vivre et qu’ont attendu plusieurs générations de Russes, depuis les origines de notre peuple jusqu’à l’avènement de cette dernière période.
Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | | |
Imprimer | | |
27/10/2022
Le grand sommeil de Napoléon (Guy Dupré)
Guy Dupré, Le grand coucher, L’Église des Soldats, pp. 28-32, Éditions de La Table Ronde – La petite vermillon

Bivouac de Napoléon sur le champ de bataille de Wagram pendant la nuit du 5 au 6 juillet 1809, par Adolphe Roehn (1780–1867)
(…) Où étaient allées se nicher les dernières reines des abeilles ornant le manteau du Sacre dont ce pauvre noir s'était fait le rucher ? Sans doute sous une plume d'aigle de ces autres mal blanchis que j'avais surpris en train de célébrer le rite du calumet devant le tombeau de Foch. Je m'étais approché, croyant à une mascarade d'étudiants des Beaux-Arts célébrant la cinquantenaire de la bataille de la Somme à leur façon. Le gardien qui n'était plus un « vieux brave » se tapotait le front de l'index. De vrais indiens, m'avait-il appris, arrivés de leur réserve du Montana pour rendre hommage, quarante-cinq après, au maréchal sacré « Chefs des chefs » par leur sachem lors de sa tournée aux États-Unis. Je regardais ces parias, les derniers pour qui la victoire du mois des morts fût restée vivante, vivant celui qui l'avait conduite. L'air liquide de flûte montait sous la voûte, entre la crypte et l'autel, à l'endroit où le maréchal avait prononcé, le 5 mai 1921, le discours du Centenaire, dans un silence troublé par le four rire nerveux de Maginot : « Sire, dormez en paix ; de la tombe même vous travaillez toujours pour la France. » Huit ans plus tard, lui même y revenait, bien couvert, les pieds en avant.
Le soleil des batailles a passé comme une Chandeleur, avec ses crêpes, avec ses veuves. La semence impériale a séché, laissant ces couleuvres, ces filets d'argent qui relient pour nous les pentes de Notre-Dame-de-Lorette et les taillis de la cote 304 aux prairies d'Hougoumont. Plus de Napoléon de l'âme ni de chair à canon amoureuse du canonnier. Au Saint Patron des Julien Sorel et des Raskolnikof s'est substituée la figure du Souteneur corse, du Truand, assimilable par « la simplicité bestiale de son cas » à la pieuvre, au fauve gras. Mais image elle aussi naïve, à quoi l'étrangeté de ses rapports avec le sommeil nous fait préférer la figure du Dormant à la Bloy, du Prodigieux, dont la course immobile se nourrit d'un aller et retour incessant entre l'état de veille et l'état dit de rêve. « Il dormait quand il voulait et comme il voulait. » Là résidait son véritable secret d'alcôve, celui dont l'imagerie populaire s'était le mieux approchée, qui nous le montre, pendant la veillée d'Austerlitz ou la veillée de Wagram, dormant au bivouac sous les yeux de ses hommes. Au jour de Wagram, c'est sous le coup de midi qu'il reprend son sommeil après avoir donné l'ordre à Berthier de poursuivre l'attaque. Pour le protéger du soleil de juillet ses grenadiers ont empilé des tambours autour de la peau de tigre sur laquelle il s'est jeté. Bientôt gronde et déferle autour de l'arche où il flotte entre chair et ciel le flot montant des cuirassiers de Nansoury et de la cavalerie de la Garde découplées contre l'artillerie et les carrés de Kollowrath. A Bautzen, « c'est au son de cette musique d'artillerie et de mousqueterie que l'Empereur se coucha sur un manteau déplié à terre et donna l'ordre qu'on ne le réveillât que das deux heures ; il s'endormit le plus tranquillement du monde devant nous ». Le 15 juin 1815, à Charleroi, il s'endort sur une chaise en regardant passer la Jeune Garde mais cette fois son sommeil le trahit, il laisse s'échapper les Prussiens de Zieten.
Hegel note que le premier souci du général Bonaparte entré à Pavie a été de convoquer la classe d'idéologie de l'Université pour lui poser l' « embarrassante » question de la « différence » entre la veille et le sommeil. En ce Prairial de l'An VI le passage d'un état à l'autre le préoccupait encore, lui dont la parole peut-être la plus troublante paraît gravée sur le marbre du dieu Hypnos : « Je fais mes plans avec les rêves de mes soldats endormis. » Plus son Empire volant avance sous lui, plus la lumière indivise de ses confins intérieurs lui dénature la figure de ce qui passe. « Toute l'Europe a le même climat », dit-il à Caulaincourt qui, un an avant le franchissement du Niémen, l'a averti : « On est résolu, Sire, à vous livrer l'entrée de la Russie, à vous attirer le plus loin possible en vous refusant le combat, après quoi le climat aura raison de la Grande Armée. » A ce péché d'omission des longitudes il succombait déjà en 1806 et quand les Polonais répondaient : « Sire, nous le voudrions bien », il répétait : « La Russie a un climat continental. » A Moscou on l'entend ânonner que « l'automne est plus beau, même plus chaud qu'à Fontainebleau ». Il ajoute : « Voilà un échantillon du terrible hiver de Russie dont M. de Caulaincourt fait peur aux enfants. » Après l'incendie, le 1er novembre, comme la retraite commence, sans qu'il ait songé une seconde à faire ferrer les chevaux à glace, il va répétant que « c'est le temps de la Saint-Hubert à Fontainebleau ».
Après Waterllo, s'il revient à la Malmaison, c'est plus pour retrouver son étoile disparue depuis Smolensk que le fantôme de Joséphine. Prés de la charmille sous laquelle, Premier consul, il jouait aux barres, le platane est toujours là entre les deux grandes branches duquel il l'avait vue à son retour d'Austerlitz. Il la cherche en vain. « Le ciel était-il le même ? » lui fait remarquer le commandant du Bellérophon. Austerlitz eu lieu un 2 décembre, Waterloo un 18 juin. Il n'y avait pas pensé. Pour cet « aborigène d'une région spirituelle inconnue, étranger de naissance et de carrière en quelque pays que ce fût », les saisons et les ciels, les victoires et les défaites, la providence et le destin se conjoignent dans l'étale d'un crépuscule qui tient de l'extrême matin et de la nuit qui tombe, de l'aube étrangement fraîche et du suprême soir (…)
Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | | |
Imprimer | | |
26/10/2022
Le Libéralisme et le postmoderne (Alexandre Douguine)
Alexandre Douguine, La Quatrième théorie politique – La Russie et les idées politiques du XXIème siècle, Chapitre 2 – Le libéralisme et ses métamorphoses, Le Libéralisme et le postmoderne, pp. 49-51, Ars Magna Éditions
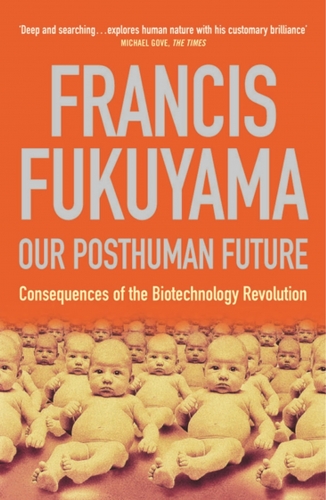
En passant de l'opposition formelle aux idéologies alternatives à une nouvelle phase d’autodiffusion à l'échelle mondiale, l'idéologie libérale change de statut. A l'époque moderne le libéralisme avait toujours coexisté avec le non-libéralisme et faisait donc l'objet d'un choix. Comme dans les technologies informatiques modernes, où on peut théoriquement choisir un ordinateur avec le système d'exploitation Microsoft, Mac Os ou Linux. Après avoir vaincu ses adversaires, le libéralisme a acquis le monopole de la pensée idéologique, il est devenu la seule idéologie et n'en admet aucune autre. On peut dire que du niveau du programme il est passé au niveau du système d'exploitation, il est devenu quelque chose d'allant de soi. Notez qu'en entrant dans un magasin pour choisir un ordinateur, la plupart du temps nous ne précisons pas : « Donnez-moi un ordinateur avec le logiciel de l'entreprise Microsoft ». Nous disons simplement : « Donnez-moi un ordinateur ». Et par défaut on nous vend le vend avec le système d'exploitation de l'entreprise Microsoft. De même avec le libéralisme : il s'introduit en nous de lui-même, comme quelque chose de communément admis, qu'il semble ridicule et stupide de contester.
Le contenu du libéralisme change, en passant du niveau du discours à celui de langue. Le libéralisme devient non pas le libéralisme au sens propre, mais un sous-entendu, un accord tacite, un consensus. Cela correspond au passage de l’Époque moderne au postmoderne. Dans le postmoderne le libéralisme, conservant et même renforçant son influence, apparaît de moins en moins souvent comme une philosophie politique raisonnée et librement acceptée, il devient inconscient, compris, instinctif. Un tel libéralisme instinctif prétendant se transformer en une « matrice » de la période contemporaine dont la majorité serait inconsciente, acquiert peu à peu des traits grotesques. Les figures grotesques de la culture postmoderne naissent des principes classiques du libéralisme devenu une subconscience (« la subconscience de réserve mondiale », par analogie avec le dollar, « devise de réserve mondiale »). Il s'agit d'ores et déjà d'une sorte de post-libéralisme classique, mais le conduisant vers des conclusions extrêmes.
Ainsi se présente le panorama du grotesque post-libéral :
-
l'individu n'apparaît plus comme la mesure des choses, au profit du post-individu, du « dividuum », la combinaison accidentelle ludique et ironique des parties de l'homme (ses organes, ses clones, ses simulacres, voire même ses cyborgs et ses mutants) ;
-
la propriété privée est déifiée, elle se « transcendantalise », et se transforme de ce que la personne possède, en ce qui possède la personne elle-même ;
-
l'égalité des possibilités se transforme en égalité de la contemplation des possibilités (la « société du spectacle » - Guy Debord) ;
-
la foi en le caractère contractuel de toutes les institutions politiques et sociales se transforme en une assimilation du réel au virtuel, le monde devient une maquette technique ;
-
toutes les formes extra-individuelles de l'autorité en général disparaissent, et n'importe quel individu est libre de penser du monde tout ce qu'il jugera bon (la crise de la rationalité généralisante) ;
-
le principe de la division des pouvoirs se transforme en idée de référendum électronique permanent (le parlement électronique), où chaque utilisateur de l'internet vote à chaque instant au sujet de n'importe quelle décision, ce qui amène à la multiplication des pouvoirs jusqu'au nombre de citoyens isolés (chacun est en soi une « branche du pouvoir ») ;
-
la « société civile » remplace entièrement par elle-même l’État et se transforme en un melting pot cosmopolite mondial ; - on passe de la thèse de « l'économie est le destin » à la thèse le « code numérique est le destin », puisque le travail, l'argent, le marché, la production, et la consommation, tout devient virtuel.
Certains libéraux et néoconservateurs eux-mêmes ont été saisis d'effroi à l'idée de cette perspective ouverte au vu des résultats de la victoire idéologique du libéralisme, lors du passage du post-libéralisme et au postmoderne. Ainsi, Fukuyama, l'auteur de la thèse de « la fin de l'histoire » libérale au cours des dernières décennies appellent l'Occident et les États-Unis à « faire marche arrière » et à s'attacher sur la phase précédente du libéralisme « démodé » classique – avec le marché, l’État-nation et l'habituelle rationalité scientifique pour éviter le glissement vers l'abîme post-libéral. Mais en cela il se contredit lui-même : la logique du passage du libéralisme ordinaire au libéralisme du postmoderne n'est ni arbitraire ni volontariste, elle est inscrite dans la structure même de l'idéologie libérale, puisque la libération graduelle de la personne de tout de ce qui n'est pas elle (de tous les idéaux et valeurs extra-individuels et supra-individuels), ne peut tôt ou tard que conduire à la libération de la personne d'elle-même. Et la crise la plus terrible de l'individu commence non pas, quand il lutte contre les idéologies alternatives niant la personne en tant que valeur supérieure, mais quand il remporte une victoire convaincante et irréversible.
Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | | |
Imprimer | | |


