13/12/2021
Préface du « Matin des magiciens » (Louis Pauwels) - ou De l'équilibre dans la Force
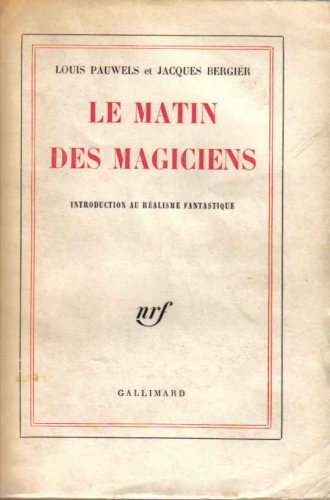
Louis Pauwels, Le matin des magiciens – Introduction au réalisme fantastique, Préface, pp. 9/32, aux éditions Gallimard (collection Folio)
Je suis d’une grande maladresse manuelle et le déplore. Je serais meilleur si mes mains savaient travailler. Des mains qui font quelque chose d’utile, plongent dans les profondeurs de l’être et y débondent une source de bonté et de paix. Mon beau-père (que j’appellerai ici mon père, car c’est lui qui m’a élevé) était ouvrier tailleur. C’était une âme puissante, un esprit réellement messager. Il disait parfois en souriant que la trahison des clercs avait commencé le jour où l’un d’eux représenta pour la première fois un ange avec des ailes : c’est avec les mains que l’on monte au ciel.
En dépit de cette maladresse, j’ai tout de même relié un livre. J’avais seize ans. J’étais élève au cours complémentaire de Juvisy, en banlieue pauvre. Le samedi après-midi, nous avions le choix entre le travail du bois, du fer, le modelage ou la reliure. Je lisais à cette époque les poètes, et surtout Rimbaud. Cependant, je me fis violence pour ne point relier Une Saison en Enfer. Mon père possédait une trentaine de livres, rangés dans l’étroite armoire de son atelier, avec les bobines, les craies, les épaulettes et les patrons. Il y avait aussi, dans cette armoire, des milliers de notes prises d’une petite écriture appliquée, sur un coin de l’établi, pendant les innombrables nuits de labeur.
Parmi ces livres, j’avais lu Le Monde avant la Création de l’Homme, de Flammarion, et j’étais en train de découvrir Où va le Monde ? de Walter Rathenau. C’est l’ouvrage de Rathenau que je me mis à relier, non sans peine. Rathenau avait été la première victime des nazis, et nous étions en 1936. Dans le petit atelier du cours complémentaire, chaque samedi, je faisais du travail manuel pour l’amour de mon père et du monde ouvrier. Le premier mai, j’offris, avec un brin de muguet, le Rathenau cartonné. Dans ce livre, mon père avait souligné au crayon rouge une longue phrase qui est toujours demeurée dans ma mémoire : « Même l’époque accablée est digne de respect, car elle est l’œuvre, non des hommes, mais de l’humanité, donc de la nature créatrice, qui peut être dure, mais n’est jamais absurde. Si l’époque que nous vivons est dure, nous avons d’autant plus le devoir de l’aimer, de la pénétrer de notre amour, jusqu’à ce que nous ayons déplacé les lourdes masses de matière dissimulant la lumière qui luit de l’autre côté. »
« Même l’époque accablée... » Mon père est mort en 1948, sans avoir jamais cessé de croire en la nature créatrice, sans avoir jamais cessé d’aimer et de pénétrer de son amour le monde douloureux dans lequel il vivait, sans avoir jamais cessé d’espérer voir luire la lumière derrière les lourdes masses de matière. Il appartenait à la génération des socialistes romantiques, qui avaient pour idoles Victor Hugo, Romain Rolland, Jean Jaurès, portaient de grands chapeaux, et gardaient une petite fleur bleue dans les plis du drapeau rouge. À la frontière de la mystique pure et de l’action sociale, mon père, attaché plus de quatorze heures par jour à son établi – et nous vivions au bord de la misère – conciliait un ardent syndicalisme et une recherche de libération intérieure. Dans les gestes très courts et humbles de son métier, il avait introduit une méthode de concentration et de purification de l’esprit sur laquelle il a laissé des centaines de pages. En faisant des boutonnières, en repassant des toiles, il avait une présence rayonnante. Le jeudi et le dimanche, mes camarades se réunissaient autour de son établi, pour l’écouter et sentir cette présence forte, et la plupart d’entre eux en eurent leur vie changée. Plein de confiance dans le progrès et la science, croyant à l’avènement du prolétariat, il s’était bâti une puissante philosophie. Il avait eu une sorte d’illumination, à la lecture de l’ouvrage de Flammarion sur la préhistoire. Puis il avait lu, guidé par la passion, des livres de paléontologie, d’astronomie, de physique. Sans préparation, il avait pourtant pénétré au cœur des sujets. Il parlait à peu près comme Teilhard de Chardin, que nous ignorions alors : « Ce que notre siècle va vivre est plus considérable que l’apparition du bouddhisme ! Il ne s’agit plus désormais de l’application faite à telle ou telle divinité, des facultés humaines. C’est la puissance religieuse de la terre qui subit en nous une crise définitive : celle de sa propre découverte. Nous commençons à comprendre, et c’est pour toujours, que la seule religion acceptable pour l’homme est celle qui lui apprendra d’abord à reconnaître, aimer et servir passionnément l’univers dont il est l’élément le plus important. » Il pensait que l’évolution ne se confond pas avec le transformisme, mais qu’elle est intégrale et ascendante, augmentant la densité psychique de notre planète, la préparant à prendre contact avec les intelligences des autres mondes, à se rapprocher de l’âme même du cosmos.
Pour lui, l’espèce humaine n’était pas achevée. Elle progressait vers un état de superconscience, à travers la montée de la vie collective et la lente création d’un psychisme unanime. Il disait que l’homme n’est pas encore achevé et sauvé, mais que les lois de condensation de l’énergie créatrice nous permettent de nourrir, à l’échelle du cosmos, une formidable espérance. Et il ne quittait pas des yeux cette espérance.
C’est de là qu’il jugeait avec une sérénité et un dynamisme religieux les affaires de ce monde, allant chercher très loin, très haut, un optimisme et un courage immédiatement et réellement utilisables. En 1948, la guerre venait de passer, et des menaces de batailles, atomiques cette fois, renaissaient. Pourtant, il considérait les inquiétudes et les douleurs présentes comme des négatifs d’une image magnifique. Il y avait un fil qui le reliait au destin spirituel de la Terre, et il projetait, sur l’époque accablée où il finissait sa vie de travailleur, malgré d’immenses chagrins intimes, beaucoup de confiance et beaucoup d’amour. Il est mort dans mes bras, la nuit du 31 décembre, et il m’a dit, avant de fermer les yeux:
« Il ne faut pas trop compter sur Dieu, mais peut-être que Dieu compte sur nous... »
Où en étais-je, à ce moment ? J’avais vingt-huit ans. J’avais eu vingt ans en 1940, dans la débâcle. J’appartenais à une génération charnière qui avait vu s’écrouler un monde, était coupée du passé et doutait de l’avenir. Que l’époque accablée fût digne de respect et qu’il faille la pénétrer de notre amour, j’étais fort loin d’y croire. Il me semblait plutôt que la lucidité menait à refuser de jouer à un jeu où tout le monde triche. Durant la guerre, je m’étais réfugié dans l’hindouisme. C’était mon maquis. J’y vivais dans la résistance absolue. Ne cherchons pas le point d’appui dans l’histoire et parmi les hommes : il se dérobe sans cesse. Cherchons-le en nous-même. Soyons de ce monde comme si nous n’en étions pas. Rien ne me paraissait plus beau que l’oiseau plongeur de la Bhagavad-Gîtâ, « qui plonge et remonte sans avoir mouillé ses plumes ». Les événements contre lesquels nous ne pouvons rien, me disais-je, faisons en sorte qu’ils ne puissent rien contre nous. Je siégeais au plafond, assis en lotus sur un nuage venu d’Orient. La nuit, mon père lisait en cachette mes livres de chevet pour essayer de comprendre ma singulière maladie qui m’éloignait tant de lui.
Plus tard, au lendemain de la Libération, je me donnai un maître à vivre et à penser. Je devins disciple de Gurdjieff. Je travaillai à me séparer de mes émotions, de mes sentiments, de mes élans, afin de trouver, au-delà, quelque chose d’immobile et de permanent, une présence muette, anonyme, transcendante, qui me consolerait de mon peu de réalité et de l’absurdité du monde. Je jugeais mon père avec commisération. Je croyais posséder les secrets du gouvernement de l’esprit et de toute connaissance. En fait, je ne possédais rien que l’illusion de posséder et un intense mépris pour ceux qui ne partageaient pas cette illusion.
Je désespérais mon père. Je me désespérais moi-même. Je m’asséchais jusqu’à l’os dans une position de refus. Je lisais René Guénon. Je pensais que nous avions la disgrâce de vivre dans un monde radicalement perverti, et voué justement à l’apocalypse. Je faisais mien le discours de Cortès à la Chambre des députés de Madrid en 1849 : « La cause de toutes vos erreurs, messieurs, c’est que vous ignorez la direction de la civilisation et du monde. Vous croyez que la civilisation et le monde progressent, ils rétrogradent ! » Pour moi, l’âge moderne était l’âge noir. Je m’occupais à dénombrer les crimes de l’esprit moderne contre l’esprit. Depuis le XIIe siècle l’Occident, détaché des Principes, courait à sa perte. Nourrir quelque espérance, c’était s’allier au mal. Je dénonçais toute confiance comme une complicité. Il ne me restait d’ardeur que pour le refus, la rupture. Seules, dans ce monde déjà aux trois quarts englouti, où les prêtres, les savants, les politiciens, les sociologues et les organisateurs de toutes sortes m’apparaissaient comme des coprophages, les études traditionnelles et une résistance inconditionnelle au siècle étaient dignes d’estime.
Dans cet état, j’en venais à prendre mon père pour un primaire naïf. Son pouvoir d’adhésion, d’amour, de vision lointaine, m’irritait comme un ridicule. Je l’accusais d’en être resté aux enthousiasmes de l’Exposition de 1900. L’espoir qu’il plaçait dans une collectivisation grandissante, et dirigeait infiniment plus haut que le plan politique, excitait mon mépris. Je ne jurais que par les antiques théocraties.
Einstein fondait un comité de désespoir des savants de l’atome, la menace d’une guerre totale planait sur l’humanité divisée en deux blocs. Mon père mourait sans avoir rien perdu de sa foi en l’avenir, et je ne le comprenais plus. Je n’évoquerai pas, dans cet ouvrage, les problèmes de classe. Ce n’est pas le lieu. Mais je sais bien que ces problèmes existent : ils ont mis en croix l’homme qui m’aimait. Je n’ai pas connu mon père de sang. Il appartenait à la vieille bourgeoisie gantoise. Ma mère comme mon second père étaient ouvriers, venaient d’ouvriers. Ce sont mes ancêtres flamands, jouisseurs, artistes, oisifs et orgueilleux, qui m’ont éloigné de la pensée généreuse, dynamique, qui m’ont fait me replier et méconnaître la vertu de participation. Depuis longtemps déjà, il y avait une herse entre mon père et moi. Lui qui n’avait pas voulu avoir d’autre enfant que ce fils d’un autre sang, par crainte de me léser, s’était sacrifié pour que je devienne un intellectuel. M’ayant tout donné, il avait rêvé mon âme semblable à la sienne. À ses yeux, je devais devenir un phare, un homme capable d’éclairer les autres hommes, de leur apporter du courage et de l’espérance, de leur montrer, comme il disait, la lumière qui brille au bout de nous. Mais je ne voyais aucune sorte de lumière, sinon la lumière noire, en moi et au bout de l’humanité. Je n’étais qu’un clerc pareil à beaucoup d’autres. Je poussais jusqu’à leurs extrêmes conséquences ce sentiment d’exil, ce besoin de radicale révolte, que l’on exprimait dans les revues littéraires, aux environs de 1947, en parlant « d’inquiétude métaphysique », et qui furent le difficile héritage de ma génération. Dans ces conditions, comment être un phare ? Cette idée, ce mot hugolien me faisaient sourire méchamment. Mon père me reprochait d’aller en me décomposant, d’être passé, comme il disait, du côté des privilégiés de la culture, des mandarins, des orgueilleux de leur impuissance.
La bombe atomique, alors qu’elle marquait pour moi le commencement de la fin des temps, était pour lui le signe d’un nouveau matin. La matière allait en se spiritualisant et l’homme découvrirait autour de lui et en lui-même des puissances jusqu’ici insoupçonnées. L’esprit bourgeois, pour qui la Terre est un lieu de séjour confortable dont il faut tirer le maximum, allait être balayé par l’esprit nouveau, l’esprit des ouvriers de la Terre, pour qui le monde est une machine en marche, un organisme en devenir, une unité à faire, une Vérité à faire éclore. L’humanité n’était qu’au début de son évolution. Elle recevait les premiers renseignements sur la mission qui lui était assignée par l’Intelligence de l’Univers. Nous commencions tout juste à savoir ce que c’est que l’amour du monde.
Pour mon père, l’aventure humaine avait une direction. Il jugeait les événements selon qu’ils se situaient ou non dans cette direction. L’histoire avait un sens elle dérivait vers quelque forme d’ultra-humain, elle portait en elle la promesse d’une superconscience. Sa philosophie cosmique ne le séparait pas du siècle. Dans l’immédiat, ses adhésions étaient « progressistes ». Je m’en irritais, sans voir qu’il mettait infiniment plus de spiritualité dans son progressisme que je ne progressais dans ma spiritualité.
Cependant, j’étouffais dans ma pensée close. Devant cet homme, je me sentais parfois un petit intellectuel aride et frileux, et il m’arrivait de désirer penser comme lui, respirer aussi largement que lui. Au coin de son établi, le soir, je poussais à fond la contradiction, je le provoquais, en souhaitant sourdement être confondu et changé. Mais, la fatigue aidant, il s’emportait contre moi, contre la destinée qui lui avait donné une grande pensée sans lui accorder les moyens de la faire passer en ce fils au sang rebelle, et nous nous quittions dans la colère et la peine. J’allais retrouver mes méditations et mes livres désespérés. Il se penchait sur les étoffes et reprenait son aiguille, sous la lampe crue qui lui jaunissait les cheveux. De mon lit-cage, je l’entendais longuement souffler, gronder. Puis soudain, il se mettait à siffler entre ses dents, doucement, les premières mesures de l’Hymne à la Joie, de Beethoven, pour me dire de loin que l’amour retrouve toujours les siens. Je pense à lui presque chaque soir, à l’heure de nos anciennes disputes. J’entends ce souffle, ce grondement qui s’achevaient en chant, ce grand vent sublime évanoui.
Douze ans qu’il est mort ! Et je vais avoir quarante ans. Si je l’avais compris de son vivant, j’aurais conduit plus adroitement mon intelligence et mon cœur. Je n’ai cessé de chercher. Maintenant, je me rallie à lui, après bien des quêtes souvent stérilisantes et de dangereuses errances. J’aurais pu, beaucoup plus tôt, concilier le goût de la vie intérieure et l’amour du monde en mouvement. J’aurais pu jeter plus tôt, et peut-être plus efficacement, quand mes forces étaient intactes, un pont entre la mystique et l’esprit moderne. J’aurais pu me sentir à la fois religieux et solidaire du grand élan de l’histoire. J’aurais pu avoir plus tôt la foi, la charité et l’espérance.
Ce livre résume cinq années de recherches, dans tous les secteurs de la connaissance, aux frontières de la science et de la tradition. Je me suis lancé dans cette entreprise nettement au-dessus de mes moyens, parce que je n’en pouvais plus de refuser ce monde présent et à venir qui est pourtant le mien. Mais toute extrémité est éclairante. J’aurais pu trouver plus vite une voie de communication avec mon époque. Il se peut que je n’aie pas tout à fait perdu mon temps en allant jusqu’au bout de ma propre démarche. Il n’arrive pas aux hommes ce qu’ils méritent, mais ce qui leur ressemble. J’ai longtemps cherché, comme le souhaitait le Rimbaud de mon adolescence, « la Vérité dans une âme et un corps ». Je n’y suis pas parvenu. Dans la poursuite de cette Vérité, j’ai perdu le contact avec des petites vérités qui eussent fait de moi, non certes le surhomme que j’appelais de mes vœux, mais un homme meilleur et plus unifié que je ne suis. Pourtant, j’ai appris, sur le comportement profond de l’esprit, sur les différents états possibles de la conscience, sur la mémoire et l’intuition, des choses précieuses que je n’eusse pas apprises ailleurs et qui devaient me permettre, plus tard, de comprendre ce qu’il y a de grandiose, d’essentiellement révolutionnaire à la pointe de l’esprit moderne : l’interrogation sur la nature de la connaissance et le besoin pressant d’une sorte de transmutation de l’intelligence.
Lorsque je sortis de ma niche de Yogi pour jeter un coup d’œil sur ce monde moderne que je connaissais sans le connaître, j’en perçus d’emblée le merveilleux. Mon étude réactionnaire, qui avait été souvent pleine d’orgueil et de haine, avait été utile en ceci : elle m’avait empêché d’adhérer à ce monde par le mauvais côté : le vieux rationalisme du XIXe siècle, le progressisme démagogique. Elle m’avait aussi empêché d’accepter ce monde comme une chose naturelle et simplement parce que c’était le mien, de l’accepter dans un état de conscience somnolente, ainsi que font la plupart des gens. Les yeux rafraîchis par ce long séjour hors de mon temps, je vis ce monde aussi riche en fantastique réel que le monde de la tradition l’était pour moi en fantastique supposé. Mieux encore : ce que j’apprenais du siècle modifiait en l’approfondissant ma connaissance de l’esprit ancien. Je vis les choses anciennes avec des yeux neufs, et mes yeux étaient neufs aussi pour voir les choses nouvelles.
Je rencontrai Jacques Bergier (je dirai comment tout à l’heure) alors que je finissais d’écrire mon ouvrage sur la famille d’esprits réunie autour de M. Gurdjieff. Cette rencontre, que je n’attribue pas au hasard, fut déterminante. Je venais de consacrer deux années à décrire une école ésotérique et ma propre aventure. Mais une autre aventure commençait à ce moment pour moi. C’est ce que je crus utile de dire en prenant congé de mes lecteurs. On voudra bien me pardonner de me citer moi-même, sachant que je ne suis guère soucieux d’attirer l’attention sur ma littérature : d’autres choses me tiennent au cœur. J’inventai la fable du singe et de la calebasse. Les indigènes, pour capturer la bête vivante, fixent à un cocotier une calebasse contenant des cacahuètes. Le singe accourt, glisse la main, s’empare des cacahuètes, ferme le poing. Alors il ne peut plus retirer sa main. Ce qu’il a saisi le retient prisonnier. Sortant de l’école Gurdjieff, j’écrivis : « Il faut palper, examiner les fruits pièges, puis se retirer en souplesse. Une certaine curiosité satisfaite, il convient de reporter souplement l’attention sur le monde où nous sommes, de regagner notre liberté et notre lucidité, de reprendre notre route sur la terre des hommes à laquelle nous appartenons. Ce qui importe, c’est de voir dans quelle mesure la démarche essentielle de la pensée dite traditionnelle rejoint le mouvement de la pensée contemporaine. La physique, la biologie, les mathématiques, à leur extrême pointe, recoupent aujourd’hui certaines données de l’ésotérisme, rejoignent certaines visions du cosmos, des rapports de l’énergie et de la matière, qui sont des visions ancestrales. Les sciences d’aujourd’hui, si on les aborde sans conformisme scientifique, dialoguent avec les antiques mages, alchimistes, thaumaturges. Une révolution s’opère sous nos yeux, et c’est un remariage inespéré de la raison, au sommet de ses conquêtes, avec l’intuition spirituelle. Pour les observateurs vraiment attentifs, les problèmes qui se posent à l’intelligence contemporaine ne sont plus des problèmes de progrès. Il y a déjà quelques années que la notion de progrès est morte. Ce sont des problèmes de changement d’état, des problèmes de transmutation. En ce sens, les hommes penchés sur les réalités de l’expérience intérieure vont dans le sens de l’avenir et donnent solidement la main aux savants d’avant-garde qui préparent l’avènement d’un monde sans commune mesure avec le monde de lourde transition dans lequel nous vivons encore pour quelques heures. »
C’est exactement le propos qui sera développé dans ce gros livre-ci. Il faut donc, me disais-je avant de l’entreprendre, projeter son intelligence très loin en arrière et très loin en avant pour comprendre le présent. Je m’aperçus que les gens qui sont simplement « modernes », et que je n’aimais pas, naguère, j’avais raison de ne pas les aimer. Seulement, je les condamnais à tort. En réalité, ils sont condamnables parce que leur esprit n’occupe qu’une trop petite fraction du temps. À peine sont-ils, qu’ils sont anachroniques. Ce qu’il faut être, pour être présent, c’est contemporain du futur. Et le lointain passé peut être perçu lui-même comme un ressac du futur. Dès lors, quand je me mis à interroger le présent, j’en reçus des réponses pleines d’étrangetés et de promesses.
James Blish, écrivain américain, dit à la gloire d’Einstein que ce dernier « a avalé Newton vivant ». Admirable formule ! Si notre pensée s’élève vers une plus haute vision de la vie, c’est vivantes qu’elle doit avoir absorbé les vérités du plan inférieur. Telle est la certitude que j’ai acquise au cours de mes recherches. Cela peut paraître banal, mais quand on a vécu sur des pensées qui prétendaient occuper les sommets, comme la sagesse guénonienne et le système Gurdjieff, et qui tenaient en ignorance ou en mépris la plupart des réalités sociales et scientifiques, cette nouvelle façon de juger change la direction et les appétits de l’esprit. « Les choses basses, disait déjà Platon, doivent se retrouver dans les choses hautes, quoique dans un autre état. » J’ai maintenant la conviction que toute philosophie supérieure en laquelle ne continuent pas de vivre les réalités du plan qu’elle prétend dépasser, est une imposture.
C’est pourquoi je suis allé faire un assez long voyage du côté de la physique, de l’anthropologie, des mathématiques, de la biologie, avant de recommencer à essayer de me faire une idée de l’homme, de sa nature, de ses pouvoirs, de son destin. Naguère, je cherchais à connaître et à comprendre le tout de l’homme, et je méprisais la science. Je soupçonnais l’esprit d’être capable d’atteindre de sublimes sommets. Mais que savais-je de sa démarche dans le domaine scientifique ? N’y avait-il pas révélé quelques-uns de ces pouvoirs auxquels j’inclinais à croire ? Je me disais : il faut aller au-delà de la contradiction apparente entre matérialisme et spiritualisme. Mais la démarche scientifique n’y conduisait-elle pas ? Et, dans ce cas, n’était-il pas de mon devoir de m’en informer ? N’était-ce pas, après tout, une action plus raisonnable, pour un Occidental du XXe siècle, que de prendre un bâton de pèlerin et de s’en aller pieds nus en Inde ? N’y avait-il pas autour de moi quantité d’hommes et de livres pour me renseigner ? Ne devais-je pas, d’abord, prospecter à fond mon propre terrain?
Si la réflexion scientifique, à son extrême pointe, aboutissait à une révision des idées admises sur l’homme, alors il fallait que je le sache. Et ensuite, il y avait une autre nécessité. Toute idée que je pourrais me faire, après, sur le destin de l’intelligence, sur le sens de l’aventure humaine, ne pourrait être retenue comme valable que dans la mesure où elle n’irait pas à rebours du mouvement de la connaissance moderne. Je trouvai l’écho de cette méditation dans ces paroles d’Oppenheimer :
« Actuellement, nous vivons dans un monde où poètes, historiens, philosophes, sont fiers de dire qu’ils ne voudraient même pas commencer à envisager la possibilité d’apprendre quoi que ce soit touchant aux sciences : ils voient la science au bout d’un long tunnel, trop long pour qu’un homme averti y glisse la tête. Notre philosophie – pour autant que nous en ayons une –, est donc franchement anachronique, et, j’en suis convaincu, parfaitement inadaptée à notre époque. » Or, pour un intellectuel bien entraîné, il n’est pas plus difficile, s’il le veut vraiment, d’entrer dans le système de pensée qui régit la physique nucléaire que de pénétrer l’économie marxiste ou le thomisme. Il n’est pas plus difficile de saisir la théorie de la cybernétique que d’analyser les causes de la révolution chinoise ou l’expérience poétique chez Mallarmé. En vérité, on se refuse à cet effort, non par crainte de l’effort, mais parce que l’on pressent qu’il entraînerait un changement des modes de pensée et d’expression, une révision des valeurs jusqu’ici admises. « Et cependant, depuis longtemps déjà, poursuit Oppenheimer, une intelligence plus subtile de la nature de la connaissance humaine, des rapports de l’homme avec l’univers, aurait dû être prescrite. »
Je me mis donc à fouiller dans le trésor des sciences et des techniques d’aujourd’hui, de manière inexperte, assurément, avec une ingénuité et un émerveillement peut-être dangereux, mais propices à l’éclosion de comparaisons, de correspondances, de rapprochements éclairants. C’est alors que je retrouvai un certain nombre de convictions que j’avais eues, plus tôt, du côté de l’ésotérisme, de la mystique, sur la grandeur infinie de l’homme. Mais je les retrouvai dans un autre état. C’étaient maintenant des convictions qui avaient absorbé vivantes les formes et les œuvres de l’intelligence humaine de mon temps, appliquée à l’étude des réalités. Elles n’étaient plus « réactionnaires », elles réduisaient les antagonismes au lieu de les exciter. Des conflits très lourds, comme ceux entre matérialisme et spiritualisme, vie individuelle et vie collective, s’y résorbaient sous l’effet d’une haute chaleur. En ce sens, elles n’étaient plus l’expression d’un choix, et donc d’une rupture, mais d’un devenir, d’un dépassement, d’un renouvellement, c’est-à-dire de l’existence.
Les danses, si rapides et incohérentes des abeilles, dessinent paraît-il dans l’espace des figures mathématiques précises et constituent un langage. Je rêve d’écrire un roman où toutes les rencontres que fait un homme dans son existence, fugaces ou marquantes, amenées par ce que nous appelons le hasard, ou par la nécessité, dessineraient elles aussi des figures, exprimeraient des rythmes, seraient ce qu’elles sont peut-être : un discours savamment construit, adressé à une âme pour son accomplissement, et dont celle-ci ne saisit, au long d’une vie, que quelques mots sans suite.
Il me semble, parfois, saisir le sens de ce ballet humain autour de moi, deviner qu’on me parle à travers le mouvement des êtres qui s’approchent, restent ou s’éloignent. Puis je perds le fil, comme tout le monde, jusqu’à la prochaine grosse et pourtant fragmentaire évidence.
Je sortais de Gurdjieff. Une amitié très vive me lia à André Breton. C’est par lui que je connus René Alleau, historien de l’Alchimie. Un jour que je cherchais, pour une collection d’ouvrages d’actualité, un vulgarisateur scientifique, Alleau me présenta Bergier. Il s’agissait de besogne alimentaire, et je faisais peu de cas de la science, vulgarisée ou non. Or, cette rencontre toute fortuite allait ordonner pour un long temps ma vie, rassembler et orienter toutes les grandes influences intellectuelles ou spirituelles qui s’étaient exercées sur moi, de Vivekananda à Guénon, de Guénon à Gurdjieff, de Gurdjieff à Breton, et me ramener dans l’âge mûr au point de départ: mon père.
En cinq années d’études et de réflexions, au cours desquelles nos deux esprits, assez dissemblables, furent constamment heureux d’être ensemble, il me semble que nous avons découvert un point de vue nouveau et riche en possibilités. C’est ce que faisaient, à leur manière, les surréalistes voici trente ans. Mais ce n’est pas, comme eux, du côté du sommeil et de l’infraconscience que nous avons été chercher. C’est à l’autre extrémité : du côté de l’ultraconscience et de la veille supérieure. Nous avons baptisé l’école à laquelle nous nous sommes mis, l’école du réalisme fantastique. Elle ne relève en rien du goût pour l’insolite, l’exotisme intellectuel, le baroque, le pittoresque. « Le voyageur tomba mort, frappé par le pittoresque », dit Max Jacob. On ne cherche pas le dépaysement. On ne prospecte pas les lointains faubourgs de la réalité ; on tente au contraire de s’installer au centre. Nous pensons que c’est au cœur même de la réalité que l’intelligence, pour peu qu’elle soit suractivée, découvre le fantastique. Un fantastique qui n’invite pas à l’évasion, mais bien plutôt à une plus profonde adhésion.
C’est par manque d’imagination que des littérateurs, des artistes, vont chercher le fantastique hors de la réalité, dans des nuées. Ils n’en ramènent qu’un sous-produit. Le fantastique, comme les autres matières précieuses, doit être arraché aux entrailles de la terre, du réel. Et l’imagination véritable est tout autre chose qu’une fuite vers l’irréel. « Aucune faculté de l’esprit ne s’enfonce et ne creuse plus que l’imagination : c’est la grande plongeuse. »
On définit généralement le fantastique comme une violation des lois naturelles, comme l’apparition de l’impossible. Pour nous, ce n’est pas cela du tout. Le fantastique est une manifestation des lois naturelles, un effet du contact avec la réalité quand celle-ci est perçue directement et non pas filtrée par le voile du sommeil intellectuel, par les habitudes, les préjugés, les conformismes.
La science moderne nous apprend qu’il y a derrière du visible simple, de l’invisible compliqué. Une table, une chaise, le ciel étoilé sont en réalité radicalement différents de l’idée que nous nous en faisons : systèmes en rotation, énergies en suspens, etc. C’est en ce sens que Valéry disait que, dans la connaissance moderne, « le merveilleux et le positif ont contracté une étonnante
alliance ». Ce qui nous est apparu clairement, comme on le verra, j’espère, dans ce livre, c’est que ce contrat entre le merveilleux et le positif n’est pas valable seulement dans le domaine des sciences physiques et mathématiques. Ce qui est vrai pour ces sciences est sans doute vrai aussi pour les autres aspects de l’existence : l’anthropologie, par exemple, ou l’histoire contemporaine, ou la psychologie individuelle, ou la sociologie. Ce qui joue dans les sciences physiques, joue probablement aussi dans les sciences humaines. Mais il y a de grandes difficultés à s’en rendre compte. C’est que, dans ces sciences humaines, tous les préjugés se sont réfugiés, y compris ceux que les sciences exactes ont aujourd’hui évacués. Et que, dans un domaine si proche d’eux, et si mouvant, les chercheurs ont sans cesse tenté de tout ramener, pour y voir enfin clair, à un système : Freud explique tout, le Capital explique tout, etc. Quand nous disons préjugés, nous devrions dire : superstitions. Il y en a d’anciennes et il y en a de modernes. Pour certaines gens, aucun phénomène de civilisation n’est compréhensible si l’on n’admet pas, aux origines, l’existence de l’Atlantide. Pour d’autres, le marxisme suffit à expliquer Hitler. Certains voient Dieu dans tout génie, certains n’y voient que le sexe. Toute l’histoire humaine est templière, à moins qu’elle ne soit hégélienne. Notre problème est donc de rendre sensible, à l’état brut, l’alliance entre le
merveilleux et le positif dans l’homme seul ou dans l’homme en société, comme elle l’est en biologie, en physique ou en mathématiques modernes, où l’on parle très ouvertement et, somme toute, très simplement d’« Ailleurs Absolu », de « Lumière Interdite » et de « Nombre Quantique d’Étrangeté ».
« À l’échelle du cosmique (toute la physique moderne nous l’apprend) seul le fantastique a des chances d’être vrai », dit Teilhard de Chardin. Mais, pour nous, le phénomène humain doit aussi se mesurer à l’échelle du cosmique. C’est ce que disent les plus anciens textes de sagesse. C’est aussi ce que dit notre civilisation, qui commence à lancer des fusées vers les planètes et cherche le contact avec d’autres intelligences. Notre position est donc celle d’hommes témoins des réalités de leur temps.
À y regarder de près, notre attitude, qui introduit le réalisme fantastique des hautes sciences dans les
sciences humaines, n’a rien d’original. Nous ne prétendons d’ailleurs pas être des esprits originaux. L’idée d’appliquer les mathématiques aux sciences n’était vraiment pas fracassante : elle a pourtant donné des résultats très neufs et importants. L’idée que l’univers n’est peut-être pas ce que l’on en sait, n’est pas originale : mais voyez comment Einstein bouleverse les choses en l’appliquant.
Il est enfin évident qu’à partir de notre méthode, un ouvrage comme le nôtre, établi avec le maximum d’honnêteté et le minimum de naïveté, doit susciter plus de questions que de solutions. Une méthode de travail n’est pas un système de pensée. Nous ne croyons pas qu’un système, aussi ingénieux qu’il soit, puisse éclairer complètement la totalité du vivant qui nous occupe. On peut malaxer indéfiniment le marxisme sans parvenir à intégrer le fait qu’Hitler eut conscience plusieurs fois, avec terreur, que le Supérieur Inconnu était venu le visiter. Et l’on pouvait tordre dans tous les sens la médecine d’avant Pasteur sans en extraire l’idée que les maladies sont causées par des animaux trop petits pour être vus. Cependant, il est possible qu’il y ait une réponse globale et définitive à toutes les questions que nous soulevons, et que nous ne l’ayons pas entendue. Rien n’est exclu, ni le oui, ni le non.Nous n’avons découvert aucun « gourou » ; nous ne sommes pas devenus les disciples d’un nouveau messie ; nous ne proposons aucune doctrine. Nous nous sommes simplement efforcés d’ouvrir au lecteur le plus grand nombre possible de portes, et comme la plupart d’entre elles s’ouvrent de l’intérieur, nous nous sommes effacés pour le laisser passer.
Je le répète : le fantastique, à nos yeux, n’est pas l’imaginaire. Mais une imagination puissamment appliquée à l’étude de la réalité découvre que la frontière est très mince entre le merveilleux et le positif, ou, si vous préférez, entre l’univers visible et l’univers invisible. Il existe peut-être un ou plusieurs univers parallèles au nôtre. Je pense que nous n’aurions pas entrepris ce travail si, au cours de notre vie, il ne nous était arrivé de nous sentir, réellement, physiquement, en contact avec un autre monde. Cela s’est produit, pour Bergier, à Mauthausen. À un autre degré, cela s’est produit pour moi chez Gurdjieff. Les circonstances sont bien distinctes, mais le fait essentiel
est le même.
L’anthropologue américain Loren Eiseley, dont la pensée est proche de la nôtre, raconte une telle histoire qui exprime bien ce que je veux dire.
« Rencontrer un autre monde, dit-il, n’est pas uniquement un fait imaginaire. Cela peut arriver aux hommes. Aux animaux aussi. Parfois, les frontières glissent ou s’interpénètrent : il suffit d’être là à ce moment. J’ai vu la chose arriver à un corbeau. Ce corbeau-là est mon voisin. Je ne lui ai jamais fait le moindre mal, mais il prend soin de se tenir à la cime des arbres, de voler haut et d’éviter l’humanité. Son monde commence là où ma faible vue s’arrête. Or, un matin, toute notre campagne était plongée dans un brouillard extraordinairement épais, et je marchais à tâtons vers la gare. Brusquement, à la hauteur de mes yeux, apparurent deux ailes noires immenses, précédées d’un bec géant, et le tout passa comme l’éclair en poussant un cri de terreur tel que je souhaite ne plus jamais rien entendre de semblable. Ce cri me hanta tout l’après-midi. Il m’arriva de scruter mon miroir, me demandant ce que j’avais de si révoltant...
« J’ai fini par comprendre. La frontière entre nos deux mondes avait glissé, à cause du brouillard. Ce corbeau, qui croyait voler à son altitude habituelle, avait soudain vu un spectacle bouleversant, contraire pour lui aux lois de la nature. Il avait vu un homme marchant en l’air, au cœur même du monde des corbeaux. Il avait rencontré une manifestation de l’étrangeté la plus absolue qu’un corbeau puisse concevoir : un homme volant...
« Maintenant, quand il m’aperçoit, d’en haut, il pousse des petits cris, et je reconnais dans ces cris l’incertitude d’un esprit dont l’univers a été ébranlé. Il n’est plus, il ne sera jamais plus comme les autres corbeaux... »
Ce livre n’est pas un roman, quoique l’intention en soit romanesque. Il n’appartient pas à la science-fiction, quoiqu’on y côtoie des mythes qui alimentent ce genre. Il n’est pas une collection de faits bizarres, quoique l’Ange du Bizarre s’y trouve à l’aise. Il n’est pas non plus une contribution scientifique, le véhicule d’un enseignement inconnu, un témoignage, un documentaire, ou une affabulation. Il est le récit, parfois légende et parfois exact, d’un premier voyage dans des domaines de la connaissance encore à peine explorés. Comme dans les carnets des navigateurs de la Renaissance, la féerie et le vrai, l’extrapolation hasardeuse et la vision exacte s’y mêlent. C’est que nous n’avons eu ni le temps ni les moyens de pousser à fond l’exploration. Nous ne pouvons que suggérer des hypothèses et établir des esquisses de chemins de communication entre ces divers domaines qui sont encore, pour l’instant, des terres interdites. Sur ces terres interdites, nous n’avons fait que de brefs séjours. Quand on les aura mieux explorées, on s’apercevra sans doute que beaucoup de nos propos étaient délirants, comme les rapports de Marco Polo. C’est une éventualité que nous acceptons de bon cœur. « Il y avait quantité de sottises dans le bouquin de Pauwels et Bergier. » Voilà ce que l’on dira. Mais si c’est ce bouquin qui a donné envie d’aller y voir de plus près, nous aurons atteint notre but.
Nous pourrions écrire, comme Fulcanelli essayant de percer à jour et de dépeindre le mystère des cathédrales : « Nous laissons au lecteur le soin d’établir tous rapprochements utiles, de coordonner les versions, d’isoler la vérité positive combinée à l’allégorie légendaire dans ces fragments énigmatiques. » Cependant, notre documentation ne doit rien à des maîtres cachés, des livres enterrés ou des archives secrètes. Elle est vaste, mais accessible à tous. Pour ne pas alourdir l’excès, nous avons évité de multiplier les références, les notes en bas de page, les indications bibliographiques, etc. Nous avons parfois procédé par images et allégories, par souci d’efficacité et non par ce goût du mystère, si vif chez les ésotéristes qu’il nous fait penser à ce dialogue des Marx Brothers :
« Dis donc, il y a un trésor dans la maison d’à côté.
-
Mais il n’y a pas de maison à côté.
-
Eh bien, nous en construirons une ! »
Ce livre, comme je l’ai dit, doit beaucoup à Jacques Bergier. Non seulement dans sa théorie générale qui est le fruit du mariage de nos pensées, mais aussi dans sa documentation. Tous ceux qui ont approché cet homme à la mémoire surhumaine, à la dévorante curiosité et – ce qui est plus rare encore – à la constante présence d’esprit, me croiront sans peine si je dis qu’en un lustre Bergier m’a fait gagner vingt ans de lecture active. Dans ce puissant cerveau, une formidable bibliothèque est en service ; le choix, le classement, les connexions les plus complexes s’établissent à la vitesse de l’électronique. Le spectacle de cette intelligence en mouvement n’a jamais manqué de produire en moi une exaltation des facultés, sans laquelle la conception et la rédaction de cet ouvrage m’eussent été impossibles.
Dans un bureau de la rue de Berri qu’un grand imprimeur avait généreusement mis à notre disposition, nous avons réuni quantité de livres, de revues, de rapports, de journaux en toutes les langues, et une secrétaire prit en dictée des milliers de pages de notes, de citations, de traductions, de réflexions. Chez moi, au Mesnil-le-Roi, tous les dimanches, nous poursuivions notre conversation, entrecoupée de lectures, et je consignais par écrit, la nuit même, l’essentiel de nos propos, les idées qui en avaient surgi, les nouvelles directions de recherche qu’ils avaient suggérées.
Chaque jour, durant ces cinq ans, je me suis mis à ma table dès l’aube, car ensuite de longues heures de travail extérieur m’attendaient. Les choses étant ce qu’elles sont dans ce monde auquel nous ne voulons pas nous dérober, la question du temps est une question d’énergie. Mais il nous eût fallu encore dix ans, beaucoup de moyens matériels et une nombreuse équipe pour commencer à mener à bien notre entreprise. Ce que nous voudrions, si nous disposons un jour de quelque argent, arraché ici ou là, c’est créer et animer une sorte d’institut où les études, à peine amorcées dans ce livre, seraient poursuivies. Je souhaite que ces pages nous y aident, si elles ont quelque valeur. Comme le dit Chesterton, « l’idée qui ne cherche pas à devenir mot est une mauvaise idée, et le mot qui ne cherche pas à devenir action est un mauvais mot ».
Pour diverses raisons, les activités extérieures de Bergier sont nombreuses. Les miennes aussi, et d’une certaine ampleur. Mais j’ai vu dans mon enfance mourir de travail. « Comment faites-vous tout ce que vous faites ? » Je ne sais, mais je pourrais répondre par la
parole de Zen : « Je vais à pied et cependant je suis assis sur le dos d’un bœuf. »
Quantité de difficultés, sollicitations et gênes de toutes sortes ont surgi par la traverse, jusqu’à me faire désespérer. Je n’aime guère la figure du créateur farouchement indifférent à tout ce qui n’est pas son œuvre. Un amour plus vaste me tient, et l’étroitesse en amour, fût-elle le prix d’une belle œuvre, me semble une indigne contorsion. Mais on comprendra que dans ces dispositions, dans le flot d’une vie largement participante, il arrive qu’on risque la noyade.
Une pensée de Vincent de Paul m’a aidé :
« Les grands desseins sont toujours traversés par diverses rencontres et difficultés. La chair et le sang diront qu’il faut abandonner la mission, gardons-nous bien de les écouter. Dieu ne change jamais dans ce qu’il a une fois résolu, quelque chose de contraire qu’il nous semble qu’il arrive. »
Dans ce cours complémentaire de Juvisy, que j’évoquais au début de cette préface, on nous donna un jour à commenter la phrase de Vigny: « Une vie réussie est un rêve d’adolescent réalisé dans l’âge mûr. » Je rêvais alors d’approfondir et de servir la philosophie de mon père, qui était une philosophie du progrès. C’est, après bien des fuites, oppositions et détours, ce que je tente de faire. Que mon combat donne la paix à ses cendres ! À ses cendres aujourd’hui dispersées, ainsi qu’il le souhaitait, pensant, comme je le pense aussi, que « la matière n’est peut-être qu’un des masques parmi tous les masques portés par le Grand Visage ».
Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | | |
Imprimer | | |
08/11/2021
« Grands Réveils » et « Enfants de Lumière » (Daniele Perra)
Le petit oiseau bleu n'aime pas les articles de Katheon, nous reproduisons donc cet article sur notre blog...

Source : Katheon
Dans un article publié dans le numéro 4/2021 d'Eurasia, l'universitaire Maria G. Buscema affirme que les historiens et les théologiens utilisent les termes de Grand Réveil ou Revivals pour désigner expressément les mouvements de renouveau spirituel caractéristiques du protestantisme. L'expression "Grand Réveil" a récemment été remise au goût du jour comme indicateur d'une révolte "spontanée" non spécifiée des masses (des peuples) contre la Grande Remise à zéro "mondialiste" imposée (aussi) par les mesures visant à contenir la crise pandémique, par la pandémie elle-même ou par le récit qui en est fait (ou préparé) en "Occident".
Ces aspects nécessitent naturellement une étude plus approfondie, que nous tenterons de fournir au cours de ce travail. Cependant, il semble presque un devoir de rappeler que l'"Occident" reste l'espace géographique-idéologique soumis à l'hégémonie culturelle et militaire des États-Unis d'Amérique. Par conséquent, il est assez rare qu'une expression idéologico-religieuse émanant du "centre impérial" vise de quelque manière que ce soit à sa destruction.
L'histoire nous enseigne que toute tentative de renouveau spirituel (qu'elle ait échoué ou non) conçue et guidée par les échelons supérieurs du pouvoir impérial a toujours eu pour objectif le renforcement de l'empire lui-même et non sa dissolution. Prenons l'exemple de la tentative de l'"impératrice philosophe" Julia Domna, tout en distinguant les aspects purement traditionnels de la modernité. Celle-ci, épouse de Septime Sévère et fille d'un prêtre du dieu syriaque El-Gabal, pensait à une uniformisation spirituelle renouvelée de l'Empire romain par l'imposition d'une sorte d'énothéisme solaire capable de surmonter les divisions entre les différentes croyances religieuses en son sein. Et son objectif était de donner vie à un modèle théologique qui légitimerait et sacraliserait à nouveau l'espace impérial après que la coïncidence originelle du droit, de la politique et de la religion se soit lentement estompée [1]. Son objectif, comme celui de Julien après elle, était donc de renforcer et non de détruire.
Pour en revenir à l'actualité, les pages d'Eurasia ont souvent traité de l'incohérence quasi absolue de la dichotomie mondialisme/souverainisme (deux faces d'une même pièce qui évoluent dans le paradigme géopolitique de l'atlantisme). Le discours est différent en ce qui concerne le Grand Réveil susmentionné.
L'observateur non averti de la réalité serait enclin à considérer et à accepter (pour le meilleur et pour le pire) ce "phénomène" comme quelque chose d'absolument original: comme une opposition naturelle au dessein de la "grande restauration" (théorisée au forum de Davos en 2020) selon ses plus ardents adeptes ; comme le résultat de fantasmes conspirationnistes selon ses détracteurs. Ces deux positions sont erronées.
Au tournant des XVIIIe et XXe siècles, comme le rapporte l'étude de Maria G. Buscema, il y a eu au moins trois ou quatre (selon l'interprétation) grands réveils différents (il y en aurait même cinq avec le réveil actuel). Toutes, bien qu'inspirées par des pratiques religieuses nées en Europe, sont originaires des États-Unis. Et toutes ont eu des répercussions dans les sphères religieuses et politiques. Ceux-ci, affirme la chercheuse de Syracuse, "ont en commun le fait de centrer leur enseignement sur la doctrine du péché et de la grâce que l'on trouve dans la Bible, mais lue à la lumière de la Réforme, c'est-à-dire en mettant le Christ au centre de la prédication, en éloignant les fidèles des rituels et des cérémonies et en rendant la religion intensément personnelle pour les fidèles ordinaires" [2].
De là, nous pouvons voir une première différence substantielle non seulement entre la doctrine catholique et protestante, mais aussi entre différents courants au sein même du protestantisme: c'est-à-dire entre les protestants traditionalistes, d'une part, centrés sur l'importance du rituel et, d'autre part, les nouvelles expressions religieuses visant à encourager une plus grande implication émotionnelle et un engagement personnel au nom de la spiritualité.
À cet égard, il convient de rappeler que le prosélytisme religieux, comme la propagande politique, recherche toujours l'implication émotionnelle directe de la personne. Par conséquent, le prosélytisme et la propagande doivent être réglementés en fonction du public auquel ils s'adressent.
Comme l'écrivait Lord Northbourne à l'époque: "De nos jours, les représentants de la religion n'osent rien faire d'autre que de paraître à la page. C'est pourquoi ils s'efforcent toujours de rendre les écritures et les doctrines de la religion intelligibles pour le commun des mortels en essayant de les définir en termes adaptés à ses capacités d'analyse mentale et de déduction [...] rien ne restreint mieux que la manie de la définition, qu'elle soit philosophique ou populaire. Une divinité définie n'est pas divine, mais humaine ; elle n'est pas Dieu, mais une idole" [3]. En fait, en paraphrasant René Guénon, en essayant d'amener Dieu dans les états inférieurs de l'être (une pratique répandue dans le protestantisme anglo-américain) on ne fait que développer un "satanisme inconscient" beaucoup plus pernicieux que le satanisme réel et conscient (un phénomène à peine répandu et plutôt grotesque).
Pour en revenir aux différents "grands réveils", il est utile de rappeler que les racines de ce phénomène peuvent être facilement identifiées dans le piétisme: courant protestant développé en Europe centrale aux 17ème et 18ème siècles en réaction au dogmatisme luthérien classique. Le piétisme s'opposait au rationalisme de la théologie luthérienne en mettant l'accent sur la dévotion intérieure, grâce à laquelle les adeptes étaient élevés au niveau des "éveillés" ou des "régénérés". Sur la base de cette idée de "réveil" ou de "renaissance" en Christ, les grands réveils nord-américains se sont développés à partir du 18ème siècle. Le premier de ceux-ci, dit Maria G. Buscema, remonte au méthodisme, qui a offert une substance et une force nouvelles à l'action des prédicateurs évangéliques, généralement d'origine calviniste et marqués par une forte rigueur morale.
Aux États-Unis, nous avons le prédicateur écossais Thomas Chalmers (1780-1847) [...] ou la prédication charismatique des pasteurs George Whitefield (1714-1770) et Jonathan Edwards (1703-1758) [...] La prédication de ce dernier s'accompagne d'une vague de fanatisme millénariste qui se répand du Connecticut à la Nouvelle-Angleterre. Ses prédications, appelant au "Nouvel Israël" américain et à l'alliance conclue avec Yahvé, suscitaient des foules extatiques à l'écoute des sermons des pasteurs itinérants [...] Il fut suivi du Second Grand Réveil (1800-1858), particulièrement fort dans le Nord-Est et le Midwest, qui impliqua les classes inférieures et moyennes et eut pour centre de prédication revivaliste le district dit "Burned over" dans l'ouest de l'État de New York, appelé ainsi en raison du thème constant des sermons: "la damnation éternelle dans les flammes de l'enfer" [5]. Le troisième Grand Réveil (1859-1900) est généralement associé à l'impulsion donnée à l'action missionnaire et à la naissance des Témoins de Jéhovah. Alors qu'avec le quatrième Grand Réveil (qui a commencé au tournant des années 60 du siècle dernier) on entre dans une dimension plus proprement politique et géopolitique. Elle se distingue par le succès de certains des acronymes les plus conservateurs du panorama religieux nord-américain qui se sont engagés, par exemple, dans des batailles "éthiques", dictées par une lecture littérale du texte biblique, contre l'évolutionnisme et en faveur du "créationnisme".
61VZtbQbr4L.jpgIl est ici nécessaire d'ouvrir une brève parenthèse, étant donné que les théories évolutionnistes et créationnistes ont toutes deux des origines modernes. "L'un et l'autre, dit Lord Northbourne déjà cité, cherchent à tout expliquer en termes d'avantages et d'inconvénients immédiats et tangibles" [6]. Ainsi, les deux courants, tout en étant en antithèse l'un avec l'autre (puisque le "créationnisme" part d'un présupposé religieux), sont régis par une tendance intrinsèquement matérialiste.
Le célèbre pasteur évangélique Bill Graham (1918-2018) est lié au quatrième Grand Réveil. Il a exercé son influence sur de nombreux locataires de la Maison Blanche, et plus généralement sur les dirigeants politiques américains, tout au long du milieu du 20e siècle et du début du 21e siècle, d'Eisenhower à Jimmy Carter et de Bill Clinton au vice-président de Donald J. Trump, Mike Pence.
Avec ce que nous pourrions appeler le cinquième grand réveil (dont la date de début pourrait coïncider avec l'élection de Donald J. Trump en 2016), la dimension géopolitique prend encore plus de valeur. Cependant, la traditionnelle "destinée manifeste" (la mission des États-Unis de construire un ordre mondial à leur image) est masquée par une lutte idéologique-eschatologique entre le bien (l'humanité en général) et le mal (les soi-disant élites libérales transnationales, présentées comme les "alliés" de la menace numéro un pour l'hégémonie mondiale des États-Unis: la Chine).
Cette nouvelle "théologie politico-apocalyptique" a pu surmonter le trumpisme lui-même (la défaite électorale de "l'homme que Dieu a envoyé pour débarrasser le monde du mal" selon les adeptes de QAnon) et les frontières du centre "impérial" pour s'étendre à la périphérie européenne (également grâce à des agitateurs politiques zélés, dont le penseur russe Alexandre Douguine, auteur d'un manifeste du Grand Réveil contre la Grande Restauration dans lequel sont chantées les louanges du trumpisme et de l'Amérique comme lieu du "crépuscule du libéralisme") [7]. Ce court pamphlet mérite qu'on s'y attarde, car il marque le passage définitif d'une perspective géopolitique quasi déterministe (les États-Unis sont poussés à la conquête du monde par leur nature thalassocratique intrinsèque) à une perspective purement politique, dans laquelle un "philosophe" (prétendument "évolien") fait ouvertement un clin d'œil à des éléments anti-traditionnels tels que le messianisme numérisé de la pseudo-religion QAnon susmentionnée [8]. Il importe peu que le trumpisme, en termes géopolitiques, ait évolué dans une continuité absolue avec les administrations précédentes, en appliquant la stratégie américaine habituelle: exacerber les tensions pour assurer des revenus au complexe industriel de guerre nord-américain et construire des blocs d'opposition entre l'Europe et le reste de l'Eurasie.
Or, la "théologie apocalyptique-politique" susmentionnée, profondément inspirée par les thèmes classiques de l'évangélisme et du sionisme chrétien, trouve sa référence théorique dans un tout aussi court pamphlet de 1944 écrit par le théologien réformé Reinhold Niebuhr et intitulé Les enfants de la lumière et les enfants des ténèbres. Le "travail" mérite une nouvelle parenthèse, car il exprime l'idée d'un véritable choc existentiel entre les États-Unis et l'Europe. À vrai dire, l'idée n'est pas particulièrement originale non plus. Déjà au cours du 19ème siècle, des thèses de conspiration ont été propagées aux États-Unis, selon lesquelles les empires européens, de concert avec le pape et les jésuites, tentaient de détruire le gouvernement démocratique de Washington.
En fait, le pamphlet de Niebuhr se concentre sur la "civilisation démocratique moderne". Celle-ci, appuyée sur le "credo libéral", est l'expression des "enfants de la lumière", dont le seul péché est une approche sentimentale naïve des relations internationales. La "civilisation démocratique" est opposée à celle des "enfants des ténèbres", qui sont voués au cynisme moral (une caractéristique qui, selon Niebuhr, distingue aussi bien Mussolini, lié à Mazzini par une ligne directe, qu'Hitler); leur antidémocratisme serait influencé politiquement par Hobbes et religieusement par Luther. Ils sont mauvais mais très intelligents et ne connaissent aucune loi ni aucun droit autre que la simple force. L'ennemi des "enfants de la lumière" ne peut donc être que la "fureur démoniaque" du nazisme et du fascisme, qui ont mis les outils de la technologie moderne au service d'une idéologie antimoderne qui place la communauté avant l'individu [10].
Or, les affirmations de Niebuhr peuvent facilement être réfutées à plusieurs niveaux. Le théologien réformé, en premier lieu, semble être un piètre connaisseur de Hobbes, dont le "seul défaut", au mieux, serait de ne jamais dissimuler le pouvoir, son poids et sa position centrale dans tous les comportements humains, et de ne jamais l'exalter. Deuxièmement, il semble ignorer les multiples crimes du colonialisme libéral et le fait même que la soi-disant "Doctrine Monroe", loin d'être le produit d'une géopolitique isolationniste, était simplement la première expression de l'impérialisme nord-américain.
En outre, il semble ignorer le fait que l'absence de "droit", pour paraphraser Carl Schmitt, a principalement caractérisé les actions nord-américaines sur le continent européen. En diabolisant l'ennemi (qui mérite d'être anéanti), les États-Unis ont ramené la "loi de la jungle" en Europe. Surmontant le traditionnel ius publicum europaeum qui était à la base des relations entre les monarchies chrétiennes du continent, les États-Unis ont imposé une domination sur le continent qui aujourd'hui, à la seule exception de la Russie, est devenue totale.
Il n'est pas surprenant que l'agitateur et théoricien trumpiste Steve Bannon ait souvent fait référence à un "capitalisme éclairé" non spécifié, imprégné de "valeurs judéo-chrétiennes", qui a aidé à vaincre le nazisme et à renvoyer un "empire barbare" (la référence est à l'Union soviétique) à l'Est (11). Et il n'est pas surprenant que les partisans actuels du Grand Réveil aient alternativement recours à des comparaisons avec le communisme et le nazisme pour décrire les conditions restrictives actuelles.
Bannon lui-même a repris le thème (non sans références bibliques) des "enfants de la lumière contre les enfants des ténèbres" dans une interview désormais célèbre de l'ancien nonce apostolique aux États-Unis, Carlo Maria Viganò, connu pour ses positions pro-Trump et anti-Biggerhead [12]. Dans cette interview, il est fait explicitement référence à l'alliance impie entre "l'État profond mondialiste" et le "régime communiste brutal" (la référence est la Chine). Une théorie qui semble plutôt bizarre si l'on considère que l'homme de référence du mondialisme, George Soros, est considéré comme un terroriste en République populaire de Chine, et que l'actuelle administration Biden n'a fait qu'exagérer davantage les positions géopolitiques anti-chinoises de la précédente (on pense à la signature du pacte AUKUS et au renforcement militaire du gouvernement séparatiste de Taïwan, cheval de bataille de Steve Bannon).
À vrai dire, le prétendu État profond s'est désintéressé de la Chine au moment même où Bannon a compris que le grand pays asiatique représentait une menace réelle pour l'hégémonie mondiale nord-américaine. C'était déjà le cas lors du premier mandat présidentiel de Barack Obama. En ce qui concerne les soi-disant élites mondialistes, leur intérêt pour le marché chinois est inextricablement lié au renversement du gouvernement du PCC. Ce n'est pas un hasard si le spéculateur George Soros, déjà cité, a décrit à plusieurs reprises le président chinois Xi Jinping comme le plus grand ennemi de la société ouverte.
La crise pandémique n'a fait qu'exagérer davantage des positions qui restent toujours parfaitement dans le schéma géopolitique atlantiste (qu'elles soient progressistes ou réactionnaires). Il ne s'agit pas ici d'établir l'origine du virus, sujet sur lequel il n'y aura jamais de parole définitive (bien que l'auteur se soit fait sa propre idée sur la base de l'observation empirique que la recherche constante d'un ennemi est un présupposé fondamental pour la réaffirmation continuelle du schéma hégémonique nord-américain). Ce qui compte, ce sont ses effets.
Le premier effet, et le plus évident, de la crise pandémique a été l'accélération de certaines tendances et dynamiques qui se manifestaient en "Occident" depuis plusieurs décennies. L'évolution de la société occidentale vers une forme de "capitalisme de surveillance" ou de "totalitarisme libéral" a été "mal comprise" par les théoriciens du "grand réveil" comme une forme de "chinoisisation de la société". Pour être juste, son antécédent historique le plus immédiat peut facilement être trouvé dans le Patriot Act de l'administration Bush Jr, qui a donné à la NSA le champ libre pour espionner les citoyens américains eux-mêmes. En outre, des systèmes de contrôle et de suivi de la population étaient en place bien avant la crise pandémique grâce aux plateformes sociales et de recherche du réseau.
Les mêmes mesures pour contenir l'épidémie entre la Chine et l'"Occident" étaient complètement différentes. Dans le cas de la Chine, on a opté pour des fermetures localisées, une traçabilité rapide et le renforcement des soins de santé en tant qu'outil de sécurité nationale. Dans le cas de l'Occident (sauf dans de rares cas), en raison également des immenses dégâts générés par des décennies de néolibéralisme exaspéré, l'accent a été mis sur les confinements généralisés et prolongés, la lenteur ou l'absence de suivi, la mise en cause de la population et le cyberterrorisme. En outre, les vaccins (bien sûr, uniquement ceux produits par les multinationales pharmaceutiques occidentales) ont été considérés comme l'unique moyen de surmonter la crise, jusqu'au cas extrême de l'Italie (véritable laboratoire d'expériences politiques, du gouvernement jaune-vert au gouvernement hyper-atlantique du "bankster" [13] Mario Draghi), où une sorte d'obligation vaccinale fictive a été imposée par le biais du "certificat vert" : un outil qui discrimine ouvertement non seulement ceux qui ont choisi de ne pas se faire vacciner, mais aussi ceux qui l'ont fait avec des vaccins non occidentaux. Cette mesure, il faut le souligner, n'existe pas en Chine, où un état semi-normal a déjà été rétabli à l'été 2020 sans aucune obligation de vaccination, fictive ou non. On peut donc parler à juste titre d'une nouvelle "israélisation de la société".
Il n'en va pas différemment si la "chinoisisation de la société" signifie la réduction progressive des droits du travail, puisque nous avons affaire à deux formes de société complètement différentes. Concrètement, il est impossible d'établir des comparaisons entre une forme de socialisme national capable de sortir plus de 700 millions de personnes de la pauvreté et centré sur l'idée de "prospérité commune" et un modèle néolibéral, dont la seule aspiration est d'expérimenter de nouvelles techniques d'oppression (sans rien donner en retour à la population) afin de maintenir intact son système d'exploitation face aux crises structurelles cycliques de l'hypercapitalisme.
Une véritable opposition à l'évolution actuelle du système ne peut se limiter à un simple "non" au vaccin ou au "certificat vert". En laissant de côté le fait que se définir comme "éveillé" pour le simple fait d'avoir refusé une injection ferait rire même un débutant dans le domaine des études traditionnelles, penser que l'on peut créer une opposition au système uniquement et exclusivement sur ces bases, ou aspirer à un retour au passé qui a ouvert la voie à la situation actuelle, sans même gratter un pouce des dogmes atlantistes, c'est être absolument consubstantiel au système lui-même.
NOTES:
[1] Cf. C. Mutti, Introduzione alle Epistole di Apollonio di Tiana, Edizioni di Ar, Padova 2021, pp. 9-41.
[2] M. G. Buscema, Il “Grande Risveglio”. Una teologia politico-apocalittica?, “Eurasia. Rivista di studi geopolitici” 4/2021, P. 122.
[3] Lord Northbourne, Quale progresso?, Cinabro Edizioni, Roma 2021, p. 104.
[4] R. Guénon, Errore dello spiritismo, Luni Editrice, Milano 2014, p. 198.
[5] Il “Grande Risveglio”. Una teologia politico-apocalittica?, ivi cit., p. 124.
[6] Quale progresso?, ivi cit., p. 64.
[7] A. Dugin, Contre le great reset, le manifest du grand réveil, Ars Magna (2021), p. 47. Recension de Claudio Mutti in “Eurasia” 4/2021, pp. 221-222.
[8] Ibidem, p. 38.
[9] Cf. R. Hofstadter, The paranoid style in American politics, www.harpers.org.
[10] Cf. R. Niebuhr, The children of light and the children of darkness, Charles Scribners’s Son (1944).
[11] Cf. A. Braccio, Gli USA contro l’Eurasia: il caso Bannon, www.eurasia-rivista.com.
[12] La citation précédente de Lord Northbourne concernant la tentative de rendre Dieu définissable par tous, même par les esprits les moins préparés, s'applique parfaitement à la condition actuelle de l'Église catholique. Les deux positions, la "moderniste" de Bergoglio et la "conservatrice" de Viganò, sont profondément influencées par l'esprit protestant. Le premier s'est plié au style de propagande évangélique pour rendre l'image de Dieu accessible à tous. Le second a opté pour l'approche apocalyptique typique de l'évangélisme nord-américain. Il faut ajouter à cela que de nombreuses positions de Bergoglio sont souvent et volontairement déformées.
[13) Le terme a été utilisé par Léon Degrelle dans les années 1930 pour désigner les pratiques de gangsters employées par les grandes institutions de la finance pour maintenir leur contrôle sur les peuples.
Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | | |
Imprimer | | |
18/07/2021
Entrons-nous dans une nouvelle ère glaciaire ?

Savez-vous où se trouve le détroit de Makassar ? Il s’agit d’un détroit séparant l’île de Bornéo et l’île de Sulawesi dans l’archipel des Célèbes, la partie est de l’Indonésie. Ce détroit intéresse au plus haut point les climatologues car il y a peu de courants marins bien que ce détroit soit peu profond, moins de 1 000 mètres, et en liaison directe avec l’Océan Pacifique au sud des Philippines. Il est donc relativement facile d’y effectuer des sondages dans les sédiments et de reconstituer les températures océaniques en déterminant le rapport magnesium/calcium du squelette des foraminifères (Hyalina balthica entre autres) se retrouvant dans ces sédiments.
Malgré la localisation équatoriale de ce détroit (3° sud) la température de l’eau à 500 mètres de profondeur est très stable et égale à 7,5 degrés. L’analyse des sédiments permet ainsi de construire avec précision l’évolution des températures à cette profondeur puisque le rapport Mg/Ca est très sensible aux variations de températures. Si l’article paru dans la revue Science en 2013 n’est pas explicite (doi : 10.1126/science.1240837) un traitement des données recueillies par le Docteur Yair Rosenthal et son équipe de la Rutgers University a permis de visualiser une parfaite reconstitution de l’évolution des températures à 500 mètres de profondeur de cette région du globe depuis 7 000 ans avant l’ère commune jusqu’à nos jours.
Les foraminifères sont des variétés d’amibes détritivores vivant au fond des océans et possédant pour certaines un squelette de calcite. L’analyse du rapport magnésium/calcium permet de reconstruire l’évolution des températures à 500 mètres de profondeur. D’aucuns diront que cela ne signifie rien et que de surcroit le détroit de Makassar ne se trouve ni en Europe ni en Amérique du Nord, là où la propagande climatique est la plus active, donc circulez il n’y a rien à voir. Et pourtant c’est n’est pas tout à fait l’avis d’Andy May, un géologue aujourd’hui à la retraite qui a longtemps travaillé pour les compagnies pétrolières. Ce sont aussi à des géologues qu’est confiée l’étude des carottages des sédiments marins et Andy May possède tout le savoir-faire pour interpréter les données recueillies par Rosenthal et c’est ce qu’il a fait ! L’illustration ci-dessous a été annotée par May et elle est disponible en grand format en cliquant sur le lien en fin de billet :
Source : Jacques Henry via Katehon
Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | | |
Imprimer | | |


