18/07/2022
Au sujet des Yezidis
Papini, Le Diable, IX Les amis du Diable, 55 Les adorateurs du Diable, pp. 196-197, Flammarion (1964)

Il y a encore sur terre environ soixante-dix mille adorateurs du Diable. Ce sont les Yezidis, qui vivent sur le mont Sindyar, dans la haute Mésopotamie. Il s'agit d'une secte hérétique musulmane, qui vénère comme son héros le calife Yezid qui fit mettre à mort le neveu de Mohammed Husaya. Mais le Diable qu'ils adorent n'est pas, comme certains l'imaginent, celui que l'on connaît et que l'on craint dans notre Occident. Le Diable musulman, Iblis, selon les théologiens de l'Islam, se damna pour l'amour exclusif qu'il portait à la pure idée de la Divinité.
Selon les livres sacrés des Yezidis – le Livre de la Révélation et le Livre Noir – le Diable est bien un Archange déchu, mais qui reçut ensuite son pardon et auquel Dieu confia le soin de gouverner le monde et de conduire les âmes vers leur transfiguration. Cet ange, que les Yezidis appellent Malak Tawus, c'est-à-dire l'Ange Paon, est donc ministre de la Divinité suprême, un rebelle repenti et pardonné, digne par conséquent de respect et même d'un culte.
Ce Diable pourrait paraître, à première vue, diffèrent du Satan du Judaïsme et du Christianisme, mais toute la différence, en vérité essentielle, tient au fait que Dieu lui a pardonné. Or, certains des anciens Pères chrétiens considèrent aussi, de même que les Yezidis, que le gouvernement du monde matériel a été confié à Satan ; et l'un d'eux, Origène, a soutenu que, à la fin des temps, Satan recevra aussi son pardon.
Il n'est pas sans importance d'ajouter que les Yezidis vénèrent, en même temps que le Diable, le fameux Hallaj qui fut crucifié à Bagdad en l'an 922 de notre ère, pour sa doctrine de la déification de l'homme par le moyen du pur amour de Dieu.
La théorie de la déification de l'homme se rencontre aussi, bien que théologiquement purifiée, dans la philosophie chrétienne, et elle peut trouver facilement sa justification dans l’Écriture. Mais ce n'est que dans la religion des Yezidis trop calomniée, que l'on voit réunis ces deux sommets paradoxaux de la foi : que le Démon redeviendra ange et que l'homme deviendra semblable à Dieu. Ces prétendus « adorateurs du Diable », qui adorent au contraire le pardon de Dieu et la divinité de l'homme représentent un des plus hauts témoignages de la conscience religieuse.
Malgré cela, leur nombre ne cesse de s'affaiblir, et c'est à peine si l'on parle d'eux comme d'une étrange curiosité locale de l'Asie déchue et superstitieuse.
Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | | |
Imprimer | | |
06/05/2022
La primauté du cœur (Pierre-Yves Lenoble)
Pierre-Yves Lenoble, La Dame Déleste – La tradition secrète des « fidèles d'amour » islamo-chrétiens, Chapitre III – L'Amor, La Mort, L'A-Mor et l'Âme-Or, pp. 37-38, aux éditions Fiat Lux
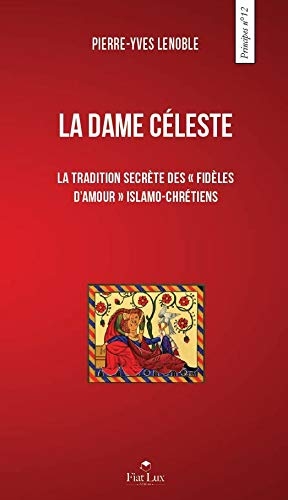
« ...Cette poésie courtoise spécifiquement destinée aux hommes d'action, on l'a dit, comporte une forte teneur initiatique et propose en filigrane les conditions, les moyens et les fins dont dispose le chevalier profane, c'est-à-dire le néophyte, afin de petit à petit transfigurer son être et d'assurer le salut définitif de son âme.
Le premier élément que nous souhaitons aborder concerne l'état d'être et d'esprit dans lequel le novice doit obligatoirement se mettre, soit la condition nécessaire de purification et de probation, pour obtenir la qualification requise et mener à bien son long processus d'initiation.
En clair, il est important de comprendre que la doctrine métaphysique professée par la poésie courtoise ne peut être appréhendée qu'après un nécessaire retour sur soi : c'est un savoir de nature ontologique qui ne doit pas rester extérieur à l'élève et qui suppose une implication plénière de l'être individuel.
Ainsi donc, on peut s'apercevoir que les « Fidèles d'Amour » islamo-chrétiens, en conformité avec tous les enseignements traditionnels, ont à l'unanimité affirmé la primauté du cœur en tant qu'organe subtil où s'opèrent les visions théophaniques, et en ont fait symboliquement le siège intérieur de l'intelligence et de l'amour qui seul permet la réunion harmonieuse entre le Connaître et l'Être. »
Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | | |
Imprimer | | |
03/05/2022
Notes sur l'image de la « Sainte » et l'image de la « Fée »
Laurent Guyénot, La mort féerique – Anthropologie du merveilleux (XIIe-XVe siècle), Chapitre II Sainteté, royauté et chevalerie, Culture cléricale et culture laïque, pp. 56-57, Éditions Gallimard, nrf

« ...Comme l'opposition entre culture populaire et culture des élites, l'opposition entre culture cléricale et culture laïque est donc à juste titre relativisée par quelques historiens comme Carl Watkins ou John Van Engen. Ils critiquent également l'idée que la culture laïque serait plus imprégnée de « survivance païennes » que la culture cléricale. D'un côté, le « paganisme » dénoncé par les clercs rigoristes dans certains jeux ou rites populaires est largement rhétorique ; la plupart du temps, il ne s'agit que de particularismes locaux auxquels se prêtent les prêtres de paroisse. De l'autre côté, la culture cléricale s'est depuis toujours imprégnée de rites et croyances d'origine préchrétienne, où elle a puisé une part immense de ses traits médiévaux.
Un histoire tirée d'un des recueils de Miracles de la Vierge qui fleurissent au XIIe siècle permet d'illustrer cette proximité entre les deux cultures dans le domaine narratif. Un certain chanoine de Pise était dévoué à la Vierge et récitait chaque jour en son honneur les offices connus sous le nom des « Heurs de la Vierge ». Lorsque ses parents moururent en lui laissant un héritage important, ses amis le poussèrent à se marier. Il délaissa peu à peu le service de la Vierge, mais, le jour de son mariage, elle lui apparut pour lui reprocher le déclin de son affection et lui interdire de se marier. Le mariage eut pourtant lieu, mais la nuit même l'homme quitta sa femme et son foyer et jamais plus on ne le revit. Voilà une histoire qui met à mal la frontière entre le miraculeux chrétien et le merveilleux féerique. La Vierge se comporte en effet exactement comme certaines fées (Fadas) que mentionne un peu plus tard Gervais de Tilbury, dont les amants mortels, « quand ils voulurent se marier avec d'autres femmes, (...) moururent avant d'avoir pu s'unir charnellement à elles » (Otia, III, 86). « Est-ce un hasard », doit-on se demander avec Pierre Gallais, « si l'émergence des fées, telles que nous les connaissons, coïncide sans doute avec la grande popularisation du culte de Notre-Dame ? »
Guillaume de Malmesbury (De Gestis regnum Anlorum, II, 205) raconte à la même époque l’histoire d'un jeune marié qui avait passé innocemment son alliance au doigt d'une statue de Vénus et se vit dans l'impossibilité de consommer son mariage, car une créature à « la consistance d'un nuage et la densité d'un corps » s'insinuait toujours entre lui et son épouse. Sur les conseils d'un prêtre orthodoxe, il dut se rendre à un carrefour en pleine nuit pour remettre une lettre au conducteur d'une procession fantomatique dans laquelle Vénus apparaissait telle « une femme attifée comme une prostituée chevauchant une mule (...), presque nue en raison de la minceur de ses vêtements, (qui) se répandait en attitudes impudiques ». La nette ressemblance entre cette troupe et celle des morts errants connue sous le nom de « mesnie Hellequin » laisse soupçonner que Guillaume s'inspire ici d'une de ces histoires de revenante amoureuse dont nous parlerons au chapitre x. Il adopte une convention simultanément chrétienne faisant de Vénus une prostituée mortelle. Ainsi se trouve illustré le caractère mutant des schémas narratifs, qui circulent aisément d'un registre à l'autre. »
Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | | |
Imprimer | | |


