18/03/2023
La parole perdue – Le « cheval blanc » de Swedenborg et le drame des « religions du Livre » (Henry Corbin)
Henry Corbin, L'Homme et son Ange – Initiation et chevalerie spirituelle, 2 L'initiation ismaélienne ou l'ésotérisme et le Verbe, I. La parole perdue, pp.81-88, Fayard

Le drame qui est commun à toutes les « religions du Livre », ou mieux dit, à la communauté que le Qorân désigne comme Ahl al-Kîtab, la communauté du Livre, et qui englobe les trois grands rameaux de la tradition abrahamique (judaïsme, christianisme, Islam), peut être désigné comme le drame de la « Parole perdue ». Et cela, parce que tout le sens de leur vie est axé sur le phénomène du Livre saint révélé, sur le sens vrai de ce Livre. Si le sens vrai de ce Livre est le sens intérieur, caché sous l'apparence littérale, dés l'instant que les hommes méconnaissent ou refusent ce sens intérieur, dés cet instant ils mutilent l'intégralité du Verbe, du Logos, et commence le drame de la « Parole Perdue ».
Ce drame se manifeste sous bien des formes : en philosophie, c'est le nominalisme, avec tous les aspects de l’agnosticisme. En théologie, c'est le littéralisme, tantôt celui des pieux agnostiques, craintifs devant tout ce qui est philosophie ou gnose, tantôt celui d'une théologie s'efforçant de rivaliser avec les ambitions de la sociologie, et qui est tout simplement une théologie ayant perdu son Logos, une théologie agnostique. On pressentira que la tâche de recouvrer la Parole ou le Verbe perdu déborde les moyens de la linguistique à la mode de nos jours. Il ne s'agit pas non plus d'un « progrès de langage », mais de retrouver l'accès au sens intérieur du Verbe, à ce sens ésotérique qui éveille crainte et dédain chez les exégètes « à ras du sol ».
La claire perception visionnaire de cette situation dramatique se trouve, semble-t-il, dans l'opuscule que Swedenborg a écrit en commentaire de l'apparition du « cheval blanc », au chapitre XIX de l'Apocalypse. Le texte Johannite dit ceci : « Puis je vis le Ciel ouvert, et voici : parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu ; sur sa tête étaient plusieurs diadèmes ; il avait un Nom écrit, que personne ne connaît si ce n'est lui-même, et il était revêtu d'un vêtement teinté de sang. Son nom est la Parole de dieu (ό λόγoς τoύ θεoύ, – Verbum Dei). Les armées qui sont dans le Ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues de fin lin, blanc et pur (...). Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit : Roi des rois et Seigneur des seigneurs » (Apocal. XIX, 11-16).
Swedenborg commente le texte en déclarant tout d'abord qu'il est impossible à quiconque d'avoir une claire idée de ce qu'impliquent les détails de la vision, à moins d'en percevoir le sens intérieur, c'est-à-dire ésotérique. Bien entendu, il ne s'agit pas de faire de la vision une allégorie, ni d'en abolir ou détruire les configurations concrètes, puisque c'est précisément la réalité intérieure cachée qui provoque le phénomène visionnaire et soutient la réalité de la vision. Il s'agit de percevoir ce qu'annonce chacune de ses apparentiae reales. Le « Ciel ouvert » représente le fait – et signifie – que le sens intérieur de la Parole, du Verbe, peut être vu dans le Ciel, donc par ceux à qui, en ce monde même, le Ciel intérieur est ouvert. Le « cheval blanc » représente et signifie l'intelligence spirituelle de la Parole, ainsi comprise quant aux réalités intérieures et spirituelles. Le cavalier qui le chevauche est le Seigneur en tant que Verbe, puisque son nom est « Verbe de Dieu ». Qu'il ait un Nom écrit que personne ne connaît hormis lui-même, signifie que lui seul et ceux à qui il le révèle, voient la Parole, le Verbe, dans ses significations intérieures, ésotériques. Qu'il soit vêtu d'un vêtement teinté de sang, signifie la Parole quant à sa réalité littérale qui souffre tant de violences, chaque fois que l'on refuse le sens intérieur. Les armées qui le suivent dans le Ciel sur des chevaux blancs et vêtues de blanc, désignent tous ceux qui sont dans l'intelligence spirituelle de la Parole et en perçoivent les réalités intérieures, le sens ésotériques. La blancheur de leurs vêtements signifie la vérité qui est dans la lumière du Ciel, et eo ipso la vérité intérieure, la vérité d'origine céleste. La vision de cette blanche chevalerie swedenborgienne préparant l'avènement de la Nouvelle Jérusalem, est confirmée par tous les textes que Swedenborg rassemble au cours de l'opuscule ou dans l'appendice, et qu'il a commentés d'autre part dans ses Arcana caelestia. De cette accumulation de textes, il résulte que dans les multiples passages de la Bible où il est fait mention de cheval et de cavalier, le sens intérieur en est toujours l'intellect et l'intelligence spirituelle qui en est la monture. L4ensemble est assez impressionnant pour convaincre que seule l'intelligence spirituelle de ces passages en ouvre le vrai sens.
Si j'ai cité ici longuement ce commentaire d'une vision, dans laquelle Swedenborg voit annoncé qu'au temps final de l’Église le sens spirituel ou intérieur des Écritures sera révélé, c'est, d'une part, que ce commentaire typifie le drame des « religions du Livre » : le Verbe perdu et le Verbe recouvré, ou l'occultation, puis la manifestation, du sens intérieur, ésotérique, qui est le vrai sens, parce qu'il est l'Esprit et la vie du Livre saint révélé. C'est d'autre part, parce que la conception d'ensemble de l'herméneutique, chez Swedenborg, met en œuvre les mêmes principes que l'herméneutique spirituelle pratiquée dans les deux autres rameaux de la tradition abrahamique, et ce que nous venons de lire est particulièrement en résonance avec la perspective eschatologique de la gnose shî'ite en général, tant que celle de la tradition imâmite duodécimaine que celle de tradition ismaélienne. Malheureusement, en guise d'introduction historique, je dois me limiter à rapeller ici que l'ismaélisme est avec l'imâmisme duodécimain l'une des deux principales branches du shî'isme, et que l'ismaélisme, qui doit son nom à l'Imâm Ismâ'il, fils du Vie Imâm Ja'far al-Sâdiq (ob 765), représente par excellence, avec les théosophes de l'imâmisme duodécimain, la tradition de la gnose ésotérique en Islam. Bien entendu, l'Islam sunnite majoritaire des docteurs de la Loi ne put avoir envers cette tradition ésotérique qu'une attitude négative ; sinon, il n'y aurait pas le drame en question. Nous verrons même avec quelle véhémence l'auteur de notre roman initiatique s'exprime à ce sujet.
Sommairement dit, lorsque nous parlons des traits communs s'originant de part et d'autreau phénomène du Livre saint révélé, nous pensons à ceci :
-
Pour la gnose ismaélienne, le sens intérieur, le sens spirituel ésotérique de la Révélation qorânique, est aussi le vrai sens ; c'est cela même qui la différencie du littéralisme de la religion islamique officielle et majoritaire, dont on peut dire qu'à ses yeux il a « perdu la Parole », puisqu'il refuse le sens vrai, le sens caché du Verbe divin dans le Qôran. On pourrait dire qu'aux yeux de l'ésotériste ismaélien aussi, le Verbe divin apparaît d'un vêtement teinté de sang, signe des violences qu'à subies le Verbe divin (Kalimat Allâh) de la part des exotéristes et des docteurs de la Loi qui le mutilent, en refusant ce qui en est l'Esprit et la Vie. Nous verrons que nos ismaéliens se sont exprimés avec un réalisme non moins tragique : de cette Parole divine les docteurs de la Loi ont fait un cadavre.
-
Nous verrons que l'Imâm, au sens shî'ite du mot, est l' « homologue » du blanc chevalier de l'Apocalypse, tel que Swedenborg en comprend l'apparition, puisqu'il est à la fois le dispensateur et le contenu du sens spirituel ésotérique. Il est à la fois l'herméneute et l'herméneutique : il est le « Livre parlant » (Qôran nâtiq). Si Swedenborg identifie le pouvoir du blanc chevalier avec le « pouvoir des clefs » (potestas clavium), c'est parce que, cette fois, il ne s'agit plus d'un magistère juridique de l’Église, mais de l'intelligence spirituelle qui est la clef de la Révélation. De même aussi, nous entendrons parler, au cours de notre roman initiatique, des clefs qui ont le pouvoir d'ouvrir l'accès au monde spirituel invisible.
-
Swedenborg écrit que le Verbe divin est ce qui unit le Ciel et la Terre, et que pour cette raison il est appelé Arche d'alliance. Nous recueillerons également, au cours de notre roman initiatique, une allusion à l'Arche d'alliance. Telle qu'elle y intervient pour signifier la Religion absolue, on peut dire qu'elle est l'image rassemblant l’ésotérisme des trois rameaux abrahamiques.
-
Pour Swedenborg, le situs de l'homme régénéré est d'ores et déjà dans le sens intérieur du Verbe divin, parce que son « homme intérieur » est ouvert au Ciel spirituel. Même s'il ne le sait pas, l'homme intérieur spirituel est déjà dans la société des Anges, tout en vivant dans son corps matériel. La mort, l'exilus physique, c'est le passage, le moment auquel il devient conscient de cette appartenance. Cela signifie que l'homme régénéré par l'intelligence spirituelle du Verbe divin est désormais de ceux dont l'Apocalypse (XX, 6) déclare que la « seconde mort » n'a pas de pouvoir sur eux. De même pour nos théosophes ismaéliens, comme notre roman initiatique va nous le montrer, et comme le philosophe Nasîroddîn Tûsi (XIIIe siècle) l'a fort bien analysé plus tard, le fruit de l'initiation est de préserver l'initié de la « seconde mort ». Autrement dit, le phénomène biologique de la mort, l'exilus, n'implique pas eo ipso que l'on ait quitté ce monde. Car le sens vrai de la mort, c'est la mort spirituelle. Or, ceux qui sont morts spirituellement, ne quittent jamais ce monde, car pour sortir de ce monde, il faut être un vivant, un ressuscité, c'est-à-dire être passé par la nouvelle naissance spirituelle. C'est pourquoi nous entendons le gnostique ismaélien est l'entrée dans le « paradis en puissance » (jinnal fî'l-qowwat).
-
Il faut que l'accès au sens ésotérique demeure ouvert, parce qu'il est la condition de cette nouvelle naissance qui est le salut, et il n'est pas de tradition sans perpétuelle renaissance. Cela implique la présence continue dans le monde de celui que le shî'isme nomme l'Imâm, que celui-ci soit dans l'occultation ou qu'il soit manifesté. Or l'Imâm, comme dispensateur du sens spirituel ésotérique qui ressuscite les morts spirituels, participe au charisme prophétique. Comme nous l'avons rappelé ci-dessus, il est le « Qôran parlant » (Qôran natîq), tandis que sans lui la Qôran n'est qu'un Imâm muet (sâmit). Sans lui, la Parole est perdue et il n'y a plus de résurrection des spirituellement morts. Aux yeux de l'ésotériste ismaélien, c'est tout le drame de l'Islam sunnite. Il faut donc que le charisme prophétique se perpétue dans notre monde, même après la venue du prophète de l'Islam, lequel fut le « Sceau » des prophètes missionnés pour révéler une Loi nouvelle et finalement la dernière. C'est que les humains ne peuvent pas se passer de prophètes.
Nous ne pourrons donc pas éviter la question : comment cela peut-il s'accorder avec le dogme officiel de l'Islam, selon lequel, après le prophète Mohammad, il n'y aura plus de prophètes ? Nous verrons sur ce point justement notre roman ismaélien s'exprimer à découvert avec véhémence, mais aussi en consonance parfaite avec les textes qui, chez les Spirituels chrétiens de notre Moyen Age, affirment que le temps des prophètes n'est point clos. De part et d'autre, la clôture de la prophétie, c'est justement le drame de la Parole perdue, rendant impossibles la résurrection des morts spirituels et la préservation contre la « seconde mort ». C'est le drame que les spirituels et les ésotéristes de l'Islam ont vécu comme se passant au cœur de l'Islam. L'herméneutique swedenborgienne du blanc chevalier de l'Apocalypse vaut donc pour toutes les « religions du Livre révélé ». En parlant la langue des symboles, on peut dire que les ésotéristes, shî-ite et ismaélien, ont été, eux aussi, en quête de lui, sous le nom de l' « Ami de Dieu », c''est-à-dire de l'Imâm. Ils furent à la Quête de l'Imâm, comme les nôtres furent à la Quête du saint Graal. Nous verrons que dans le rituel d'initiation, c'est l'Imâm qui confère à l'initié le Nom qui désormais lui est propre, en ce sens qu'il est désormais lui est propre au service de ce nom ; il en est le « chevalier ». Je ne crois pas qu'aucune étude, complète et approfondie, ait été tentée jusqu'ici, concernant la tension vécue respectivement, en Islam et en Chrétienté, entre les deux pôles : celui de la religion spirituelle ésotérique et celui de la religion exotérique, légalitaire et littérale.
Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | | |
Imprimer | | |
21/02/2023
Nerval et la Tradition primordiale : le culte d'Isis (Troisième partie)
Gérard de Nerval, Les Filles du feu ; Les Chimères, Isis, III., pp. 240-254, Folio Classique

Giacomo Brogi - "Pompeii. Temple of Isis". Around 1870
III.
Peut-être faut-il craindre, en voyage, de gâter par des lectures faites d'avance l'impression première des lieux célèbres. J'avais visité l'Orient avec les seuls souvenirs, déjà vagues, de mon éducation classique. – Au retour de l’Égypte, Naples était pour moi un lieu de repos et d'étude, et les précieux dépôts de ses bibliothèques et de ses musées me servaient à justifier ou à combattre les hypothèses que mon esprit s'était formées à l'aspect de tant de ruines inexpliquées ou muettes. – Peu-être ai-je dû au souvenir éclatant d'Alexandrie, de Thèbes et des Pyramides, l'impression presque religieuse que me causa une seconde fois la vue du temple d'Isis de Pompéi. J'avais laissé mes compagnons de voyage admirer dans tous ses détails la maison de Diomède, et, me dérobant à l'attention des gardiens, je m'étais jeté au hasard dans les rues de la ville antique, évitant çà et là quelque invalide qui me demandait de loin où j'allais, et m’inquiétant peu de savoir le nom que la science avait retrouvé pour tel ou tel édifice, pour un temple, pour une maison, pour une boutique. N'était-ce pas assez que les drogmans et les Arabes m'eussent gâté les pyramides, sans subir encore la tyrannie des ciceroni napolitains ? J'étais entré par la rue des tombeaux ; il était clair qu'en suivant cette voie pavée de lave, où se dessine encore l'ornière profonde des roues antiques, je retrouverais le temple de la déesse égyptienne, situé à l’extrémité de la ville, auprès du théâtre tragique. Je reconnus l'étroite cour jadis fermée d'une grille, les colonnes encore debout, les deux autels à droite et à gauche, dont le dernier est d'une conservation parfaite, et au fond l'antique cella s'élevant sur sept marches autrefois revêtues de marbre de Paros.
Huit colonnes d'ordre dorique, sans base, soutiennent les côtés, et dix autres le fronton ; l'enceinte est découverte, selon le genre d'architecture dit hypœtron, mais un portique couvert régnait alentour. Le sanctuaire a la forme d'un petit temple carré, voûté, couvert de tuiles, et présente trois niches destinées aux images de la Trinité égyptienne ; – deux autels placés au fond du sanctuaire portaient les tables isiaques, dont l'une a été conservée, et sur la base de la principale statue de la déesse, placée au centre de la nef intérieure on a pu lire L. C. Phœbus l'avait érigée dans ce lieu par décret des décurions.
Près de l'autel de gauche, dans la cour, était une petite loge destinée aux purifications ; quelques bas-reliefs en décoraient les murailles. Deux vases contenant l'eau lustrale se trouvaient en outre placés à l'entrée de la porte intérieure, comme le sont nos bénitiers. Des peintures sur stuc décoraient l'intérieur du temple et représentaient des tableaux de la campagne, des plantes et des animaux de l’Égypte, – la terre sacrée.
J'avais admiré au Musée les richesses qu'on a retirées de ce temple, les lampes, les coupes, les encensoirs, les burettes, les goupillons, les mitres et les crosses brillantes des prêtres, les sistres, les clairons et les cymbales, une Vénus dorée, un Bacchus, des Hermès, des sièges d'argent et d'ivoire, des idoles de basalte et des pavés de mosaïques ornés d'inscription et d'emblèmes. La plupart de ces objets, dont la matière et le travail précieux indiquent la richesse du temple, ont été découverts dans le lieu saint le plus retiré, situé derrière le sanctuaire, et où l'on arrive en passant sous cinq arcades. Là, une petite cour oblongue conduit à une chambre qui contenait des ornements sacrés. L'habitation des ministres isiaques, située à gauche du temple, se composait de trois pièces, et l'on trouva dans l'enceinte plusieurs cadavres de ces prêtres à qui l'on suppose que leur religion fit une devoir de pas abandonner le sanctuaire.
Ce temple est la ruine la mieux conservée de Pompéi. Parce qu'à l’époque où la ville fut ensevelie, il en était le monument le plus nouveau. L'ancien temple avait été renversé quelques années auparavant par un tremblement de terre , et nous voyons là celui qu'on avait rebâti à sa place. – J'ignore si quelqu'une des trois statues D'Isis au Musée de Naples aura été retrouvée dans ce lieu même, mais je les avais admirés la veille, et rien ne m’empêchait, en y joignant le souvenir de deux tableaux, de reconstruire dans ma pensée toute la scène de la cérémonie du soir.
Justement le soleil commençait à s'abaisser vers Caprée, et la lune montait lentement du côté du Vésuve, couvert de son léger dais de fumée. – Je m'assis sur une pierre, en contemplant ces deux astres qu'on avait longtemps adorés dans ce temple sous les noms d'Osiris et d'Isis, et sous des attributs mystiques faisant allusion à leurs diverses phases, et je me sentis pris d'une vive émotion. Enfant d'un siècle sceptique plutôt qu'incrédule, flottant entre deux éducations contraires, celle de la révolution, qui niait tout, et celle de la réaction sociale, qui prétend ramener l'ensemble des croyances chrétiennes, me verrais-je entraîné à tout croire, comme nos pères les philosophes l'avaient été à tout nier ? – Je songeais à ce magnifique préambule des Ruines de Volney, qui fait apparaître le Génie du passé sur les ruines de Palmyre, et qui n'emprunte à des inspirations si hautes que la puissance de détruire pièce à pièce tout l'ensemble des traditions religieuses du genre humain ! Ainsi périssait, sous l'effort de la raison moderne, le Christ lui-même, ce dernier des révélateurs, qui, au nom d'une raison plus haute, avait autrefois dépeuplé les cieux. Ô nature ! Ô mère éternelle ! était-ce là vraiment le sort réservé au dernier de tes fils célestes ? Les mortels en sont-ils venus à repousser toute espérance et tout prestige, et, levant ton voile sacré, déesse de Saïs ! Le plus hardi de tes adeptes s'est-il donc trouvé face à face avec l'image de la Mort ?
Si la chute successive des croyances conduisait à ce résultat, ne serait-il pas plus consolant de tomber dans l'excès contraire et d'essayer de se reprendre aux illusions du passé ?
Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | | |
Imprimer | | |
07/02/2023
L'Empire chrétien comme puissance qui retient : kat-echon (Carl Smith)
Carl Smith, Le nomos de la Terre, I Cinq corollaires introductifs, 3. Indications sur le Droit des Gens du Moyen Age Chrétien, b) L'Empire chrétien comme puissance qui retient (kat-echon), pp. 63-66, PUF
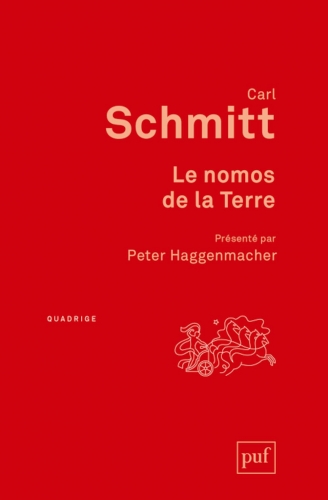
L'unité de cette Respublica Christiana trouvait dans l'empire et le sacerdoce ses hiérarchies adéquates, et dans le pape et l'empereur ses supports visibles. Le rattachement à Rome impliquait la continuation de la localisations antiques reprises par la foi chrétienne. L'histoire du Moyen Age est par conséquent l'histoire d'une lutte pour Rome, et non celle d'une lutte contre Rome. La constitution militaire du voyage romain est la constitution de la royauté allemande. C'est dans l'orientation concrète sur Rome, non dans les normes et des idées générales, que réside la continuité qui relie le droit des gens médiéval à l'Empire romain. Pour cet Empire chrétien, il était essentiel qu'il ne fût pas un Empire éternel, mais qu'il gardât à l'esprit sa propre fin et la fin de l'ère actuelle, tout en étant capable d'une puissance historique. Le concept décisif qui fonde historiquement sa continuité est celui de la puissance qui retient, du kat-echon. Empire signifie ici la puissance historique qui peut retenir l'apparition de l'Antéchrist et la fin de l'ère actuelle, une force qui tenet, selon les mots de l'apôtre Paul dans sa deuxième Épître aux Thessaloniciens, chapitre 2. Cette conception de l'Empire est attestée par de nombreuses citations des Pères de l’Église, des textes de moines germains de l'époque franque et ottonienne – surtout le commentaire de la deuxième Épître aux Thessaloniciens par Haimo de Halberstadt, et la lettre d'Adson à la reine Gerberg – des propos d'Otto de Freising et d'autres documents jusqu'à la fin du Moyen Age. On peut même y voir le signe distinctif d'une période de l'histoire. L'Empire du Moyen Age chrétien dure tant que vit l'idée du kat-echon.
Je ne crois pas qu'une autre représentation de l'histoire que celle du kat-echon soit même possible pour une fois chrétienne originaire. La foi en une force qui retient la fin du monde jette le seul pont ui mène de la paralysie eschatologique de tout devenir humain jusqu'à une puissance historique aussi imposante que celle de l'Empire chrétien des rois germaniques. L'autorité des Pères de l’Église et d'auteurs comme Tertullien, Jérôme et Lactance, et la continuation chrétien de prophéties sibyllines se conjuguent pour affirmer que seul l'Imperium Romanum et sa prolongation chrétienne expliquent la persistance de cet âge du monde, et le protègent contre la puissance écrasante du Mal. Cette vision s'inscrivait, chez les moines germains, dans une lumineuse foi chrétienne, de la plus forte intensité historique ; et qui ne peut faire la distinction entre, d'une part, les textes d'Haimo de Halberstadt ou d'Adson, et d'autres part les troubles oracles du Pseudo-Méthode ou de la Sibylle tiburtine, ne saisira l'Empire du Moyen Age chrétien qu'à travers des généralisations déformantes et des parallèles avec des phénomènes de puissance non chrétiens, plutôt que dans son histoire concrète.
Les constructions politiques ou juridiques relatives à la continuation de l'Imperium Romanum ne sont pas l'essentiel, comparées à la doctrine du kat-echon ; elles représentent déjà un déclin et une dégénérescence, passant de la piété au mythe érudit. Elles peuvent être très différentes : translations, successions, consécrations ou rénovations de toutes sortes. Pourtant, elles aussi ont pour sens de préserver spirituellement l'antique unité entre ordre et localisation, face à la destruction de la piété ancienne par la divinisation hellénistique et orientale des dirigeants politiques et militaires durant l'Antiquité tardive. Du point de vue organisationnel, elles durent s'adapter pendant le Haut Moyen Age à un régime foncier lié à la féodalité terrienne et aux liens personnels d'une vassalité féodale, tandis qu'à partir du XIIIe siècle elles cherchèrent à affirmer une unité en voie de décomposition face à un pluralisme de pays, de couronnes, de maisons princières et de villes autonomes.
L'unité médiévale entre impérium et sacerdotium, en Europe occidentale et centrale, n'a jamais été une accumulation centralisatrice de pouvoir dans la main d'un seul homme. Elle reposait dés l'origine sur la distinction entre le potestas et auctoritas, conçues comme deux hiérarchies différentes au sein de la même unité globale. Les oppositions entre empereur et pape ne sont donc pas des antagonismes absolus, mais seulement diversi ordines dans lesquels vit l'ordre de la Respublica Christiana. Le problème concomitant du rapport entre Église et Empire est fondamentalement diffèrent du problème plus tardif du problème entre Église et État. Car par État il faut entendre essentiellement le dépassement de la guerre civil religieuse, devenu possible seulement à partir du XVIe siècle, et ce par une neutralisation. Au Moyen Age, les situations historiques et politiques changeantes impliquent automatiquement que l'empereur revendique lui aussi l'auctoritas, et le pape la potestas. Mais les malheurs ne commencèrent qu'au moment où – à partir du XIIIe siècle – on utilisa la doctrine aristotélicienne de la societas perfecta pour scinder l’Église et le monde en deux genres de societates perfectae. Un vrai historien, John Neville Figgis, a su reconnaître et exposer cet antagonisme décisif. La lutte médiévale entre pape et empereur n'est pas une lutte entre deux societates, peu importe que l'on rende societas par société ou par communauté ; ce n'est pas non plus un conflit entre Église et État à la manière du Kulturkampf bismarckien ou de la laïcisation française de l’État ; enfin ce n'est pas davantage une guerre civile comme celle entre Rouges et Blancs au sens d'une lutte des classes socialiste. Toutes les analogies tirées du domaine de l’État moderne sont ici inconscients des idées unificatrices associées avec l'idée d'unité depuis la Renaissance, la Réforme et la Contre-Réforme. Qu'un empereur ait fait déposer ou élire un pape à Rome, ou qu'un pape à Rome ait délié de leur serment de fidélité les vassaux d'en empereur ou d'un roi n'a jamais remis en question pour un seul instant l'unité de la Respublica Christiana.
Que non seulement les rois allemands mais aussi d'autres rois chrétiens aient pris le titre d'imperator et nommé leurs royaumes des empires, qu'ils aient reçu du pape des mandats de mission et de croisade, c'est-à-dire des titres juridiques pour l'acquisition de territoires, n'a pas fait disparaître l'unité de la Respublica Christiana fondée sur des localisations et des ordres assurés, mais n'a fait que la confirmer. Pour la conception chrétienne de l'Imperium, il me semble important qu'aux yeux du Moyen Age chrétien la fonction de l'empereur n'ait pas représenté en soi une position de puissance absolue absorbant ou consommant toutes les autres fonctions. Elle fait œuvre de kat-echon, avec des devoirs et des missions déterminés, et s'ajoute à une royauté concrète ou à une couronne, c'est-à-dire à la domination sur un pays chrétien déterminé et son peuple. Elle est l'élévation d'une couronne, non pas verticalement en ligne droite, telle une royauté sur des rois, une couronne des couronnes, non par l'extension d'un pouvoir royal ou même, comme plus tard, un élément d'un pouvoir dynastique, mais une mission qui émane d'une sphère toute différente de celle de la dignité royale. L'Imperium est ici un élément superposé à des formations autochtones, tout comme – dans le même contexte culturel générale – une langue cultuelle sacrée vient d'une autre sphère se superposer aux langues vernaculaires. L'empereur peut donc aussi déposer sa couronne en toute humilité et modestie après l'accomplissement d'une croisade, sans compromettre pour autant son honneur – comme le montre le Ludus de Antichristo dans le fil de la tradition entièrement dominée par Adson. Il quitte alors sa place surélevée d'empereur pour retrouver sa place naturelle, et n'est plus désormais que le roi de son pays.
Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | | |
Imprimer | | |


