02/03/2025
Atlantide (Drieu la Rochelle)
Drieu la Rochelle, Le jeune européen, Écrits de jeunesse, Atlantide, pp. 57/58, éditions Bartillat
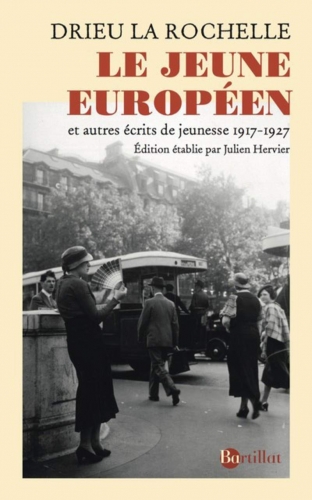
Atlantide, ressuscitée des eaux, ressurgie de ton Océan.
Destinée mystérieuse qui s'engrène dans la machination prodigieuse du fer extraite peu à peu du néant.
Là l'homme, là le plus dur ennemi de la nature.
Il forge hâtivement l'énorme outil de sa rancune.
Contre la matière la matière.
Contre la matière malveillante : broussailles malignes, minerais abstrus, chimie lascive et trouble
la matière fondue, forgée, articulée, disciplinée.
Ce sacré univers où il fait noir comme dans un four, il ne blague plus sous nos marteaux-pilons.
Mais le maître ne s'épuise-t-il pas à nourrir ses esclaves voraces ?
Ils dévorent tous les matériaux.
L'homme arcbouté aux leviers, pressant un bouton ici et là use son temps à servir les brutes fragiles qu'il a dressées à la chasse des atomes.
Cette force qu'il ploie lui échappe.
Les machines lâchées broient tout.
Le pouvoir créateur leur est défendu.
La beauté ne peut sortir de leur étreinte.
Les mains seules du maître.
De ses mains seules l'homme peut former la matière mais il ne peut transmettre son pouvoir aux forces qu'il a domestiquées.
Les forces transfuges qui sont au service de l'homme ne savent que massacrer les forces rebelles.
Jadis les pierres cédaient émues et fraternelles à l'ébranlement de la lyre sous les doigts. Maintenant c'est la guerre.
La concasseuse claque le silex et tord le claclcaire.
Machines, esclaves brutaux, mauvais serviteurs sourdement hostiles, inhumains.
Ils trahissent l'homme.
L'homme est débordé.
Les machines, démiurges vils sont entre le Dieu et son rêve.
Quel rêve ?
Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | | |
Imprimer | | |
01/03/2025
Le complotisme, cet anaconda dont nous écraserons la tête à coups de talon (Laurent James)

(Le Caravage, La Madone des palefreniers)
Le complot, c’est comme le genre (« gender ») : le problème ne réside pas dans l’authenticité de son existence, mais dans le systématisme typiquement moderniste de la théorie qui l’exploite.
Les complots politiques sont une trame de l’histoire depuis quelques centaines d’années. Prétendre qu’attaquer le complotisme revient à nier l’existence de tout complot, c’est aussi stupide que de prétendre qu’attaquer le communisme revient à nier l’existence des inégalités entre les classes sociales. Ce n’est pas parce que nous nous intéressons aux complots et conspirations, que nous nous abaisserons à grossir les rangs des complotistes. Il faut faire comprendre à ces derniers, nos ennemis directs, irréductibles et définitifs, que nous ne leur reprochons pas de parler de complots, objet historique dynamique indéniable, mais d’avoir créé une nouvelle tentative d’étouffer la Révolution Spirituelle et supra-historique en cours en systématisant absurdement la notion de complot, et en enfermant l’esprit dans un immonde cercle de fer absolument contre-productif.
J’ai déjà écrit deux textes sur Parousia contre le complotisme : « Puritanisme et Complotisme, ces plaies de la modernité » (5 octobre 10), puis « Allah Akbar » (1 février 12). J’ai notamment soutenu que le but du complotisme était de générer un espoir démobilisateur (la résignation), alors que les assoiffés de justice avaient besoin du strict opposé : un désespoir mobilisateur (la révolution).
Deux des plus grands écrivains français de ces cinquante dernières années, Dominique de Roux et Jean Parvulesco, connaissaient l’histoire des grandes conspirations, et ils étaient favorables à une révolution grand-continentale : en termes contemporains, ils étaient donc anti-complotistes. Le premier avait décrit dans « L’acier prend le pouvoir » (in « L’Ouverture de la chasse », 1968) la réaction de la CIA, dans les années 50 et 60, à « l’offensive en cours de la révolution mondiale du communisme, ayant son épicentre politico-opérationnel au Kremlin ». La CIA aurait pu logiquement financer des partis frontalement anti-communistes, afin de combattre pied à pied son ennemi russe. Mais la logique politique des Etats-Unis d’Amérique n’a jamais été celle de l’affrontement direct. Karl Haushofer avait déjà décrit la stratégie américaine comme étant celle de l’anaconda : encerclement, enserrement et dissolution. Au lieu de créer et d’encourager des mouvements capitalistes de combat, ils créèrent et encouragèrent des mouvements gauchistes de parodie, des structures politico-culturelles de dédoublement du communisme, ennemi radical – à l’époque – des USA, afin d’en annuler la force en la détournant et la singeant par des opposants tout à fait factices.
Ce mécanisme de la prise en mains des révolutions gauchistes européennes des années 60 par la CIA est décrit ainsi par de Roux :
« Suivant la mentalité protestante du capitalisme outre-atlantique, il est évident, en effet, que la contre-stratégie américaine visait, avant tout, pragmatiquement, à l’efficacité. Or, l’efficacité dans le combat anticommuniste exigeait, en dehors de toute idéologie et selon la dialectique même du marxisme-léninisme historiquement en marche, non pas l’affrontement de l’anticommunisme, mais d’une structure marxiste à une autre structure marxiste. Cette politique dans le monde de la guerre froide – et elle fut la mission primaire de la CIA – cherchait à opposer aux mouvements communistes agissant, démocratiquement ou subversivement en Europe occidentale et ailleurs, au lieu des contreforts traditionnels, une ligne ininterrompue, visible, de mouvements démocratiques et socialistes d’inspiration ou d’influence marxiste-démocratique. […] Paradoxalement, c’est le marxisme, traité par la contre-stratégie souterraine de Washington comme moyen d’action, non comme but absolu – tel qu’il l’était encore, à ce moment-là, pour les tenants ultimes de la révolution mondiale du communisme – qui permit au monde non-marxiste de l’emporter sur le marxisme : c’est le marxisme qui, tourné contre lui-même, devait donc vaincre dialectiquement le marxisme.
Là on touche à l’évidence même : la colonisation américaine de l’Europe occidentale, la mise en chantier de l’Europe atlantique, a été l’œuvre, exclusivement, des partis socialistes et de leurs alliés, démocrates-chrétiens au pouvoir, en France, en Italie, en Allemagne fédérale, en Belgique, en Hollande, voire même en Grande-Bretagne.
Au paroxysme stalinien de la révolution communiste mondiale conçue toujours selon la thèse du stalinisme : « la révolution en un seul pays », le grand capital américain devait opposer ainsi un « mouvement trotskyste », une internationale contre-stratégique utilisant subversivement le socialisme, en tant que vaccin, comme nous venons de le dire ».
Ou, dit autrement : « Mai 68, c’est la fin des espoirs. Les étudiants et les cadres menés par ce goret (rose, déjà !) de Cohn-Bendit ont été chargés de stopper, par leur révolutionnette, tout essor de révolte vraie » (Marc-Edouard Nabe, « La fifille du Pharaon », in « Non », 1998).
Soixante ans après, les acteurs ont changé mais la problématique reste la même. Le communisme représentait à l’époque pour l’Amérique un ennemi géopolitique et non point spirituel, puisque le communisme et le libéralisme sont extraits de la même matrice idéologique. Aujourd’hui c’est le contraire : l’ennemi absolu et radical de l’Amérique est fondamentalement spirituel (il est donc également ennemi d’Israël), et possédera probablement, un jour, une assise géopolitique – c’est là l’objet de tous nos combats et de toute notre détermination. Aujourd’hui, l’ennemi absolu et radical de l’Amérique, c’est la vision du monde en termes d’alliances de civilisation, c’est la vision multipolaire de l’eurasisme que donnait naguère Constantin Leontiev, à savoir « un bloc de Tradition contre le modernisme occidental », comme le rappelle Robert Steuckers dans son texte fondamental sur les relations historiques entre eurasisme, atlantisme et indisme.
Le pouvoir américano-sioniste pourrait très bien attaquer frontalement son adversaire, à savoir cette résurgence de la spiritualité vivante et agissante, en favorisant par exemple des mouvements ouvertement athées qui se battraient pied à pied contre la mise en place d’une spiritualité révolutionnaire supranationale et unificatrice. Mais, comme dans les années soixante, au lieu des contreforts traditionnels, l’Amérique a choisi à nouveau la stratégie de l’anaconda en misant tout sur la singerie de son ennemi le plus radical (la Révolution Spirituelle) ; et cette singerie passe justement par le néo-évhémérisme et le complotisme, derniers coups de boutoir de l’athéisme larvé et viral, tous deux américains jusqu’au bout des ongles, jusqu’au bout du trou du cul.
Pour le dire autrement, et afin que je me fasse bien comprendre : le complotisme est la maladie infantile de l’eurasisme.
Les complotistes d’aujourd’hui sont nos Cohn-Bendit à nous. Et j’espère bien qu’on n’attendra pas soixante ans pour leur crever la panse.
Le complotisme est une colonisation supplémentaire de l’esprit européen par l’Amérique des bas-fonds, l’Amérique des ratés.
Si tant est que nous soyons eurasistes, nous autres hyperboréens, il semble cependant que nous le soyons autrement que l’on ne le serait selon la volonté de puissance de certains. Nous ne sommes pas des complotistes… Nous n’en croyons pas nos oreilles, lorsque nous les entendons parler, tous ces conférenciers internautes. « Voici les modalités du complot ! » C’est avec cette exclamation qu’ils se précipitent tous sur nous, avec une recette à la main, la bouche hiératique pleine de vomi. « Mais qu’importe à nous le complot ? » – répondons-nous avec étonnement. « Voici le complot ! » – reprennent ces sales vociférateurs endiablés : et voici la vertu, le nouveau chemin du bonheur !… Car, en plus de tout le reste, voici qu’ils se piquent de vertu et de puritanisme, nos petits héros… Nous sommes, de par notre nature, beaucoup trop heureux pour ne pas voir qu’il y a une petite séduction dans le fait de devenir eurasiste ; c’est-à-dire immoraliste et aventurier… Nous avons pour le labyrinthe mégalithique de nos ombilics limbesques une curiosité particulière, nous tâchons, pour cela, de faire connaissance de monsieur le Minotaure dont on raconte des choses si dangereuses. Chut ! Ecoutez ! Le Taureau trépigne sur les parois de nos grottes antédiluviennes, il revient à la vie, ses naseaux frémissent et crachent de l’air chaud. Que nous importe votre corde à complots qui, prétendez-vous, nous aiderait à sortir de la caverne ! Vous voulez nous sauver au moyen de votre corde ! Et nous, nous vous supplions instamment de vous pendre avec !
A quoi sert tout cela en fin de compte ! Il n’y a pas d’autre moyen pour remettre l’eurasisme en honneur : il faut d’abord pendre les complotistes.
Le complotisme s’élève contre tout ce qui le dépasse, et son obsession est de rabaisser toute grandeur au niveau de sa propre impuissance atrophiée (les phrases suivantes entre guillemets sont réelles) : les Templiers (« une troupe de talmudistes précurseurs des francs-maçons et tenanciers de réseaux pédophiles »), le Vatican (« le Pape est une créature de Satan – d’ailleurs Bergoglio était trafiquant d’enfants, et c’est une loge maçonnique qui dirige le Vatican »), l’eurasisme (« Douguine est piloté par l’Occident »), la littérature (« chrétiennement parlant, Léon Bloy est sataniste »), les Rois Mérovingiens (« une race d’extra-terrestres »), l’Irak (« Saddam Hussein était un agent américain »), la Russie (« Poutine fait partie du système mondialiste »), le Onze-Septembre (« les avions étaient des hologrammes »), Platon (« le véritable Platon était Gémiste Pléthon, au XVè siècle »), les pyramides d’Egypte (« ce sont les reptiliens Annunakis qui les ont construites »), l’histoire européenne (« le Moyen Age n’a jamais existé, c’est une invention de l’Eglise vers 1600 »),… Lorsque j’entends un de ces crétins m’asséner qu’un complotiste est forcément intelligent puisqu’il doute des réalités officielles, je dégaine ma masse d’armes.
Leur mot d’ordre : tous contre la Sainte-Baume !
Je connais peu de listes aussi déprimantes que celle des dates marquant les défaites successives de l’Eurasie : – 37000 (extinction des Néandertaliens), – 10800 (engloutissement de l’Atlantide), – 2750 (troisième tiers de l’Ere du Taureau : césure du bloc indo-européen initial), – 175 (Saces chassés des Terres du Milieu par les Xiongnu), 843 (Traité de Verdun), 1274 (tentative avortée de Grégoire X d’unifier les Mongols, les Byzantins et l’Europe), 1314 (chute des Templiers), 1825 (dissolution de la Sainte-Alliance), 1945 (américanisation de l’Europe occidentale),… et 2014, où les adversaires les plus fervents et les plus retors du Saint Empire Eurasien sont les complotistes. Mais là, en revanche, il n’est pas sûr qu’ils remportent la victoire. Pas sûr du tout.
En 1942, le révolutionnaire Lucien Rebatet écrivait dans Les Décombres : « Je n’admire pas l’Allemagne d’être l’Allemagne, mais d’avoir permis Hitler. Je la loue d’avoir su, mieux qu’aucune autre nation, se donner l’ordre politique dans lequel j’ai reconnu tous mes désirs. Je crois que Hitler a conçu pour notre continent un magnifique avenir, et je voudrais passionnément qu’il se réalisât ». En 2014, les complotistes écrivent dans leurs torchons collaborationnistes que le nazisme était entièrement financé par les Juifs, et qu’Hitler, en plus d’être le petit-fils de Rotschild, était sataniste de par sa prétendue appartenance à la Société de Thulé.
La guerre totale a lieu entre la conspiration mondialiste de la super-puissance planétaire des Etats-Unis et « l’intégration grand-continentale eurasiatique de la fin » comme l’a écrit Parvulesco : la réunification du continent après quarante mille ans de tragédies historiques déflagrationnelles ; soit, d’une part, l’alliance sanctifiée entre le catholicisme et l’orthodoxie, et d’autre part, la nouvelle émergence des anciens dieux de notre continent ainsi que de tout le petit peuple de nos forêts, de nos landes et de nos lacs, sous l’égide hautement lumineuse et déchirante du Christ-Pantocrator et de la Vierge Marie.
Or, tout raisonnement qui s’élabore en termes de civilisation ou de bloc continental ne peut qu’être systématiquement condamné par le complotisme, qui y verra – ou plutôt, qui feindra d’y voir (car, pour beaucoup d’entre eux, tout n’est que jeu de dupes) – la mainmise de grands groupes financiers internationaux et une variante du nouvel ordre mondial au bénéfice intégral des banques de Wall Street. Alors que la nation est une fabrication complètement anti-traditionnelle (la nation française trouve principalement ses racines dans la cupidité et l’acharnement tout kshatriyen de Philippe le Bel dans la destruction de l’Ordre du Temple, et les autres nations européennes sont majoritairement des productions artificielles élaborées par les bourgeoisies entrepreneuriales pour faire fructifier leurs commerces et industries), elle est aujourd’hui ardemment défendue becs et ongles par les complotistes face au seul mouvement véritablement anti-américain et antisioniste qui tienne, celui de l’intégration supra-nationale grand-continentale et spirituellement unificatrice défendue par les nôtres. Mais, pour le complotiste, tout ce qui s’élève au-dessus de la nation ne peut qu’être une marionnette du Malin.
Lorsque le complotiste se trouvera en face du Paraclet, il L’attaquera en disant que c’est un hologramme envoyé par le Mossad pour tromper les esprits, tout comme son ancêtre avait jadis accusé Jésus d’être un mercenaire romain chargé de défaire les rebelles zélotes en semant le trouble. D’autres complotistes voient dans l’islam une manipulation des Arabes, leur mise au pas judaïque par le rabbin ébionite Waraqa Bin Nawfal, précepteur caché de Mahomet.
Pour le dire encore plus clairement : quels que soient les détours empruntés par les aléas de l’actualité quotidienne, le complotisme se trouve entièrement aux côtés de la conspiration mondialiste, parce que la seule manière de lutter contre la conspiration mondialiste, c’est la grandeur, le lyrisme, la beauté, la grâce, la foi, l’amour et le fanatisme, toutes choses qui passeront toujours pour suspectes aux yeux ultra-rationalistes des complotistes.
Dans chaque réunion publique de type politique ou spirituel, aujourd’hui, se trouvent dix pour cent de complotistes et/ou néo-évhéméristes qui pourrissent l’ambiance avec leurs sales gueules de traviole. Notons en passant que les complotistes sont tous d’une laideur à couper le souffle. Le 18 janvier dernier, à Rennes-le-Château, quelques-uns d’entre eux tentèrent de nous persuader que c’était la Rome chrétienne qui avait envoyé les Huns ravager la Gaule, et que le pic de Bugarach était un parking cosmique pour OVNIs. Les complotistes ésotéristes sont tous frontalement opposés au Vatican, car toute autorité politico-spirituelle ne peut que leur être insoutenable : ce sont des anarchistes honteux, une résurgence de l’éternelle lie de l’humanité, gueularde, atrophiée et vantarde, sous des oripeaux modernes de webmaster urbain. La croyance en l’origine extra-terrestre de la population humaine (ou d’une fraction d’entre elle) relève de cet ultime tour de passe-passe de l’athéisme, consistant à éviter à tout prix de s’en référer à Dieu.
Le 12 octobre 2013, lors de laconférence londonienne avec Alain de Benoist et Alexandre Douguine, quelques-uns d’entre eux affirmèrent que si l’on se trouvait dans cette salle d’hôtel du Bloomsbury pour évoquer « the end of the present world », c’était parce que le Mossad nous l’avait permis. Par ailleurs, ils nous affirmèrent que nos conférences ne servaient à rien si nous ne parlions pas du pouvoir absolu des Illuminati. Douguine perdit du temps à leur rétorquer que, contrairement au capitalisme industriel, le capitalisme financier était un flux principiel, et pas une construction statique. Pas de pyramide (ou d’anti-pyramide) qui tienne dans le monde de la dissolution : c’est précisément la définition de la post-modernité. Que se passerait-il si l’on éventrait tous les hommes au pouvoir, et qu’on les remplaçait par d’autres ? Absolument rien. Les complotistes ont cent ans de retard. Par ailleurs, c’est l’essence du capitalisme qui est proprement sataniste, beaucoup plus que les hommes qui le propagent. Voici une différence essentielle entre le conspirationnisme résistant et intelligent, et le complotisme traître, collaborationniste et imbécile : le premier sait que les forces obscures dirigent les hommes de manière disparate mais convergente, et que les hommes mauvais sont essentiellement le jouet du Mal, les esclaves des forces obscures ; le second croit que ce sont les hommes mauvais qui dirigent tout, et qu’ils possèdent par eux-mêmes un pouvoir énorme : le pouvoir de téléguider des avions sur des tours new-yorkaises, ou d’organiser des complots ultra-rationnels sur des dizaines ou des centaines d’années de distance. L’entité supérieure, pour eux, c’est l’élite. Et pas le Démon. Cette nuance peut sembler insignifiante, mais elle est énorme, et tout le problème est là. C’est encore une manière de croire en l’homme, de croire que certains hommes possèdent des super-pouvoirs comme dans les comics américains. Epuisé d’avoir à affronter autant de connerie orgueilleuse, Douguine se tourna vers moi en me soufflant, l’air désespéré : « C’est incapacitant ». Oui, en effet, tous les complotismes sont incapacitants, parce que c’est justement leur fonction : enrayer et stopper la Révolution Spirituelle, par tous les moyens.
Et ils le savent parfaitement.
Jusqu’à l’avènement d’internet, le complotisme restait cantonné dans des fanzines américains pour débiles légers, à l’instar du bulletin « Conspiracy Theory » de Mel Gibson dans le film éponyme de Richard Donner. La plupart de ces théories étaient alors plutôt amusantes, tant qu’elles ne relevaient que de la sous-culture paranoïde : le fluor est utilisé par les dentistes pour troubler le système nerveux des patients, des hélicoptères noirs en mode silencieux nous surveillent en permanence, le Grateful Dead était une troupe d’espions de la CIA, Oliver Stone est le porte-parole caché de Bush, les reptiles dominent le monde, etc. Mais le film date de 1996, et depuis lors, l’arme de destruction massive américaine dénommée internet a émergé dans le public, offrant un support idéalement symbiotique à la théorie arachnéenne du complot. Jamais on n’aura vu un médium aussi bien adapté à son message. En vingt ans, les tarés plutôt sympathiques sont devenus des leaders vaniteux, complètement intégrés aux modalités du système qu’ils se plaisaient naguère à décortiquer. Il n’y a aucune différence entre Alex Jones et Ronald Reagan. La technique MK Ultra était censée parvenir à transformer un homme moyen en assassin ? Depuis, comme il est dit dans le film de Donner, « la technique auto-suggestion et hypnose » est tombée dans le domaine privé : les webmasters complotistes l’ont entièrement récupérée, usant de l’insulte permanente, la vocifération abjecte et l’avilissement verbal pour hypnotiser l’internaute dubitatif, et le transformer en militant de la démobilisation et en assassin permanent de la Révolution. Chaque complotiste est un sous-produit direct de la CIA : il ne pense et n’agit que par elle, volontairement ou non.
En gagnant en vingt ans un certain pouvoir doctrinal favorisé et propagé par cette arme de guerre américaine qu’est internet, le discours complotiste s’est à la fois asséché et ridiculisé, mais il a surtout gagné en nuisance. Les théories débiles sont passées des revues ronéotypées en cinquante exemplaires aux sites internet à plus de 50000 visites par jours ; c’est exactement comme si un adolescent semi-attardé devenait père de famille du jour au lendemain. Ce dernier serait le père le plus autoritaire, insultant et haineux de tous les temps envers ses propres enfants. C’est ainsi que tout acte de résistance authentique est activement nié par le complotisme (l’anti-Système reconnu comme tel par le Système), tandis que cet acte de résistance est en même temps combattu par le Système officiel. J’affirme que le Système mène la lutte sur deux fronts en même temps : diffusion d’une propagande officielle sur les médias télévisuels de masse, et diffusion concomitante d’une propagande complotiste, opposée binairement à l’officielle, sur les médias internautes. A chaque fois, la vérité se trouve prise en sandwich entre les mensonges du Système et de l’anti-Système. L’anti-messe est dite.
Il ne peut pas exister de poésie ou de littérature complotiste, puisque le complotisme n’enrichit pas le réel mais il l’appauvrit : il l’assèche, l’encercle et le dissout. Le complotiste, c’est le Grand Inquisiteur évoqué par Dostoïevski (dans Les Frères Karamazov) : homme mauvais déguisé en dignitaire de l’Eglise, il refuse toute légitimité à la grâce (incontrôlable par nature) pour promouvoir la société de l’efficacité, une société soumise aux faux initiés comme lui. Le complotiste est un berger manipulateur : c’est un démocrate furieux, motivé par la haine du mystère. Ce qu’il déteste dans la vie, au fond, ce n’est pas que le Mal s’étende un peu partout, mais qu’il se passe des choses dont il ne soit pas au courant. Même si ce sont des forces du Bien qui tentent à couvert d’accroître leur pouvoir (Templiers, Jésuites, MMM), il les haïra avec détermination et les accusera de tous les maux, pour la simple raison qu’il veut connaître dans le détail absolument tout ce qu’il se passe.
Lorsque le Grand Inquisiteur rencontre Jésus, Celui qui fut le point de départ de sa vocation première, il réalise à quel point il a pu trahir cette dernière en l’érigeant en système de pensée aussi stérile que massificateur. Alors, à la fin, le Grand Inquisiteur fait périr Jésus dans les flammes. Le secret de Jésus, c’est qu’il n’y a pas de secret.
Croire que les hommes du Mal contrôlent tout, c’est démobilisant et anti-révolutionnaire, et conséquemment profitable au Mal. Le complotisme n’est pas une variante de la pensée radicale avec laquelle il pourrait être permis de composer en attendant la victoire. Bien au contraire. Le complotisme est un outil de la conspiration mondialiste pour étouffer la Révolution Spirituelle en usant de la stratégie de l’anaconda. A paranoïaque, paranoïaque et demi. Debout au sein de la cellule rayonnante de notre chevalerie spirituelle, nous autres hyperboréens, tenants de l’Europe mystérieuse et du Saint Empire des Temps de la Fin, saurons écraser la tête du complotisme à coups de talon, ainsi qu’il doit être fait.
Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | | |
Imprimer | | |
15/09/2024
Le Mystère des mystères (Ferdynand Ossendowski)
Ferdynand Ossendowski, Bêtes, hommes et dieux, Cinquième Partie – Le Mystère des mystères : Le Roi du Monde, XLVI Le Royaume souterrain, pp. 293/299, Éditions Phébus, Libretto
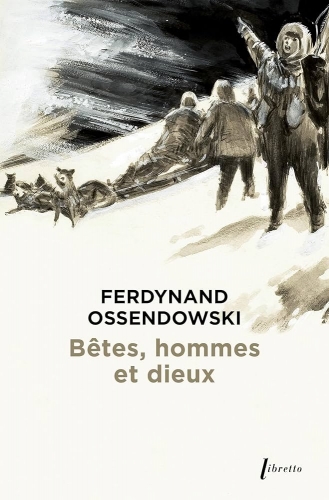
- Arrêtez ! Murmura mon guide mongol un jour que nous traversions la plaine près de Tzagan Luk. Arrêtez !
Il se laissa glisser du haut de son chameau, qui s'était couché sans qu'il n’eût besoin de lui en donner l'ordre.
Le Mongol éleva ses mains devant son visage en un geste de prière et commença à psalmodier la phrase sacrée : Om ! Mani Padme Hung ! Les autres mongoles avaient eux aussi arrêté leurs chameaux et s'étaient mis à prier.
« Qu'est-il arrivé ? » me demandais-je tout en contemplant autour de moi l'immensité de la plaine , couverte d'une belle herbe grasse et tendre, sous un ciel sans nuage dans lequel s'attardaient, rêveurs, les derniers rayons du soleil vespéral.
Les Mongols prièrent ainsi pendant un bon moment puis, après s'être murmuré quelques paroles les uns aux autres, ils refirent les sangles de leurs chameaux, prêts à repartir.
- Avez-vous vu, me demanda le guide, comme nos chameaux remuaient les oreilles de frayeur, comme le troupeau de chevaux sur la plaine restait immobile et attentif, comme les moutons et le bétail se couchaient sur le sol ? Avez-vous remarqué que les oiseaux avaient cessé de voler, les marmottes de courir et les chiens d'aboyer ? L'air s'est mis à vibrer doucement, apportant de très loin la musique d'un chant qui pénètre dans le cœur des hommes, des bêtes et des oiseaux. La terre et le ciel ont retenu leur haleine ; le vent s'est arrêté de souffler ; le soleil a interrompu sa course. En un moment comme celui-ci, le loup qui s'approche des moutons à la dérobée fait halte dans sa marche sournoise ; le troupeau d'antilopes apeurées retient son élan éperdu ; le couteau du berger prêt à trancher la gorge lui tombe des mains ; l'hermine rapace laisse aller le perdrix salga. Tous les êtres vivants sont saisi par la peur. Une force qui les dépasse les pousse à la prière. Ils attendent leur destin. Cela vient de se produire : c'est le Roi du Monde, en son palais souterrain, qui prie et sonde la destinée des peuples de la terre.
Ainsi parla le vieux Mongol, simple berger et homme sans culture.
La Mongolie, avec ses montagnes dénudées et terribles, ses plaines infinies où reposent, épars, les ossements des ancêtres, a donné naissance au mystère. Un mystère dont le peuple, qu'il soit pris dans le tumulte des orages qui secouent la nature ou plongé dans la léthargie d'un monde immobile sur lequel plane l'ombre de la mort, ressent à tout moment la profondeur, un mystère que les lamas rouges et jaunes conservent, poétisent. A Lhassa et à Ourga, il est en la possession des pontifes qui en gardent jalousement le secret.
C'est en Asie centrale que j'entendis pour la première fois parler du mystère des mystères, que je ne puis appeler autrement. Je n'y attachais d'abord qu'une très faible attentions, mais je fus amené par la suite, après avoir médité les témoignages sporadiques et contradictoires qui m'avaient été donnés, à reconnaître toute son importance et toute sa valeur.
Les vieillards des rives de l'Amyl me racontèrent une ancienne légende selon laquelle une tribu mongole, qui cherchait à échapper aux exigences de Gengis Khan, se cacha dans une contrée souterraine. Près du lac de Nogan Kul, un Soyote me montra plus tard une excavation d'où se dégageait un nuage de fumée : c'était l'entrée du royaume d'Agharti. C'est par cet orifice qu'un chasseur pénétra autrefois dans le royaume ; après son retour, il commença à raconter ce qu'il avait vu. Alors les lamas lui coupèrent la langue pour l'empêcher de parler du mystère des mystères. Dans sa vieillesse, il revint à l'entrée de la caverne, et disparut dans le royaume souterrain dont le souvenir avait ornée et réjoui son cœur de nomade.
J'obtins des renseignements plus détaillés de la bouche de Jelyb Djamsrap, houtouktou de Narabanchi Koure. Il me conta l'histoire du puissant Roi du Monde, sorti du royaume souterrain ; comment il était apparu, quels furent ses miracles et ses prophéties. Je compris alors que derrière cette légende, cette chimère, cette vision collective, quels que soient le nom et le sens qu'on lui prêtait, se cachait non seulement un mystère, mais une force réelle et souveraine, capable d'influer sur le cour des événements politiques en Asie. Je voulus donc en savoir plus.
Le gelong favori du prince Choultoun Beyli et le prince lui-même me livrèrent la description du royaume souterrain :
- Dans le monde, me dit le gelong, tout est constamment en état de transition et de changement : les peuples, les religions, les lois et les coutumes. Combien de grands empires et de brillantes cultures ont péri ! Cela seul qui reste inchangé, c'est le mal, instruments des mauvais esprits. Il y a plus de six mille ans, un saint homme disparut avec toute une tribu dans les profondeurs de la terre. Depuis, jamais il n'a reparu à la surface du monde, mais plusieurs personnages ont pu visiter son royaume : Cakya-Mouni, Undur Gheghen, Paspa, Baber et d'autres encore. Nul ne sait véritablement où il se trouve. L'un dit en Afghanistan , d'autres aux Indes. Dans cette région, tous les hommes sont protégés contre le mal ; le crime n'existe pas à l'intérieur de ses frontières. La science s'y développée dans la paix, rien n'y est menacé de destruction. Le peuple souterrain a atteint le plus haut degré du savoir. A présent, c'est un grand royaume qui compte des millions de sujets sur lesquels règne le Roi du Monde. Ce dernier connaît toutes les forces de la nature, lit dans toutes les âmes humaines et dans le grand livre de la destinée. Invisible, il règne sur huit cents millions d'hommes, prêts à exécuter ses ordres.
Le prince Choutoun Beyli ajouta :
- Ce royaume est Agharti. Il s'étend à travers les passages souterrain du monde entier. J'ai entendu un savant lama chinois dire au Bogdo Khan que toutes les cavernes souterraines de l'Amérique sont habitées par le peuple ancien qui disparut jadis sous la terre ; quelques traces de son existence subsistent encore à la surface du pays. Tous les habitants de ce monde souterrain sont gouvernés par des chefs qui reconnaissent la souveraineté du Roi du Monde. Rien de cela n'est explicable : vous n'ignorez pas qu'au milieu des deux plus grands océans de l'Est et de l'Ouest se trouvaient autrefois deux continents. Ils furent engloutis sous les eaux, mais leurs habitants passèrent dans le royaume souterrain. Les cavernes profondes où ils vivent sont éclairées par une lumière particulière qui permet la croissance des céréales et des végétaux et protège les êtres de la maladie.
» Il y a là-dessous de nombreux peuples qui vivent en tribus. Un vieux brahmane bouddhiste du Népal, qui accomplissait la volonté des dieux et se rendait en pèlerinage dans l'ancien royaume de Gengis, le Siam, rencontra un jour un pêcheur qui lui ordonna de prendre place dans sa barque et de voguer avec lui sur la mer. Le troisième jour ils atteignirent une île où vivaient une race d'hommes ayant deux langues avec lesquelles ils parlaient deux langages différents. Ces hommes montrèrent au brahmane des animaux bizarres, des tortues cyclopes à seize pattes, de monstrueux serpents à la chair extrêmement savoureuse, des oiseaux dotés de dents qui attrapaient du poisson pour leurs maîtres. Ils lui dirent qu'ils étaient venus du royaume souterrain et lui en décrivirent certaines régions.
Le lama Turgut qui fit le voyage d'Ourga à Pékin avec moi me donna d'autres détails :
- La capitale d'Aghartiest entourée de villes où habitent des grands prêtres et des savants. Elle rappelle Lhassa, la ville où le palais du Dalaï-Lama, le Potala, se dresse au sommet d'une montagne recouverte de temples et de monastères. Le trône du Roi du Monde est entouré de deux millions de dieux incarnés. Ce sont les saints panditas. Le palais lui-même est entourés des palais des goros qui maîtrisent toutes les forces visibles et invisibles de la terre, de l'enfer et du ciel, et qui ont tout pouvoir sur la vie et la mort des hommes. Si notre humanité dans sa folie osait leur faire la guerre, ils seraient transformer en déserts. A leur commandement, les arbres, les herbes et les buissons se mettent à pousser ; des hommes ressuscitent. Dans d'étranges chariots, inconnus de nous, ils sillonnent à toute vitesse les étroits corridors qui déroulent leurs méandres à l'intérieur de notre planète. Quelques brahmanes indiens et des dalaï-lamas du Thibet ont réussi à gravir des pics montagneux où nul autre pied humain ne s'était jamais posé ; ils y ont trouvé des inscriptions taillées dans le roc, des traces de pas dans la neige et des marques laissées par les roues d'engins mystérieux. Le bienheureux Cakya-Mouni trouva au sommet d'une de ces montagnes des tablettes de pierre sur lesquelles se trouvaient gravés des mots qu'il ne réussit à déchiffrer qu'à un âge avancé de sa vie. Il pénétra alors dans le royaume d'Agharti, d'où il rapporta les miettes de savoir sacré que sa mémoire avait conservées. C'est là, dans de féeriques palais de cristal, qu'habitent les chefs invisibles des fidèles, le Roi du Monde, Brahytma, qui peut parler à Dieu comme je vous parle, et ses deux assistants, Mahytma, qui connaît les événements de l'avenir, et Mahynga, qui règne sur les causes de ces événements.
» Les saints panditas étudient le monde et ses forces. Parfois les plus savants d'entre eux se rassemblent et envoient des délégués vers les endroits qu'aucun œil humain n'a jamais contemplés. Ceci nous a été décrit par le Tashi Lama qui vivait il y a huit cent cinquante ans. Les plus hauts panditas, une main sur les yeux et l'autre à la base du cerveau de prêtres plus jeunes, les endorment profondément, lavent leurs corps avec une infusion de plantes, les immunisent contre la douleur, gardent les yeux ouverts ; ils voient tout, entendent tout et n'oublient rien de ce qu'ils ont observé. Un goro s'approche d'eux et les fixe longuement du regard. Lentement leurs corps se soulèvent et disparaissent progressivement dans les airs. Le goro reste assis, les yeux fixés sur l'endroit où il les a envoyés ; des fils invisibles les retiennent à sa volonté. Quelques-uns d'entre eux voyagent parmi les étoiles, observent ce qui s'y passe * les peuples, inconnus des terriens, la vie, les lois. Ils épient les conversations, lisent les livres, connaissent la fortune et la misère, la sainteté et les péchés, la piété et le vice... Quelques-uns se mêlent à la flamme, voient la créature de feu, vive et féroce, combattant sans trêve, fondant et martelant des métaux dans les profondeurs des planètes, faisant bouillir l'eau des geysers et des sources thermales, faisant fondre les rochers et déversant par les orifices des montagnes des flots en fusion sur la surface de la terre. D'autres se mêlent aux créatures de l'air, infiniment petites, évanescents et transparents, et pénètrent les mystères et le but de leur existence. D'autres encore glissent dans les profondeurs de la mer et observent le royaume des sages créatures de l'eau, qui transportent et répandent leur bénéfique chaleur sur otue la terre, gouvernent les vents, les vagues et les tempêtes. Au monastère d'Erdeni Dzou vivait autrefois Pandita Houtouktou qui était venu d'Agharti. En mourant, il parla du temps où il avait vécu, selon la volonté du goro, sur une étoile rouge à l'est du firmament, puis sur l'océan couvert de glace, enfin parmi les feux orageux qui brûlent les entrailles de la terre.
Telles sont les histoires que j'entendis raconter dans les yourtas des princes et dans les monastères lamaïstes. Le ton des récitants interdisait qu'on fît planer sur ces récits le moindre doute.
Mystère...
Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | | |
Imprimer | | |


