16/01/2023
Rouffignac et l'essence de l'Eurasie (Claude Bourrinet)
Claude Bourrinet, L'Empire au cœur, Rouffignac et l'essence de l'Eurasie, pp. 327-331, éditions Ars Magna

Connaissez-vous Rouffignac ? La grotte offre aux regards, ajoutés aux bouquetins, chevaux, rhinocéros et bisons, cent cinquante mammouths, soit 40% des gravures ou dessins répertoriés dans des grottes préhistoriques de ce patriarche antédiluvien. Ce qui est encore plus étonnant est qu'il n'existe pas d'ossements datant de la période d'occupation de la grotte dans les vallées périgourdines. Ceux qui les ont représentés sur les parois ne les avaient pas sous les yeux, et n'en avaient que le souvenir, peut-être celui de périples épisodiques dans le Nord de l'Europe, où ces pachydermes, menacés par le réchauffement planétaire, avaient trouvé refuge.
Nous n'en savons pas plus. Mais les figures, probablement tracées par deux ou trois individus en un temps relativement court (au maximum cinquante ans, si l'on s'appuie sur l'hypothèse de trois générations – ce qui n'est pas certain, car ils ont pu tout aussi bien avoir le même âge), possèdent tous les signes d'une essentialisation de l'animal, qui en font plus un concept, une image mentale, qu'une simple mimesis de la réalité. Nous n'avons donc pas affaire à du naturalisme, mais à quelque chose qui se rapproche de l'Idée. Je rappelle que ces créations, qui connaissent une sorte d'apothéose, au fond des boyaux, dans une prolifération couvrant un plafond surplombant un puits abrupte de douze mètres où sont figurés deux visages humains, datent de la fin du paléolithique, du magdalénien, c'est-à-dire de plus de treize mille ans, et qu'il y a autant de durée entre elles et celles de Lascaux qu'avec notre époque.
Le plus impressionnant est la marque évidente, fulgurante, d'un intellectualisme des plus raffinés. Ainsi découvrons-nous une frise de mammouths affrontés étonnamment pensée, avec une symétrie, une occupation de la superficie pariétale, un travail des intervalles, et un tempo qui n'ont rien à envier au Parthénon. Elle manifeste d'une manière spectaculaire le degré de rationalité, d'abstraction, d'anticipation et de projection géométrique dans l'espace dont étaient capables les premiers Européens. Et que dire de leur capacité à tracer au noir de manganèse de grands animaux sans en voir le résultat ! En effet, dans le grand sanctuaire où se trouve le puits, l'écart entre le sol et le plafond était trop réduit pour que les auteurs des figures, couchés sur le dos, pussent les distinguer dans leur intégralité.
Et pourtant, nous, qui bénéficions des travaux de déblaiement des préhistoriens qui ont, il y a cinquante ans, mis en valeur le site, nous apprécions l'harmonie, la grâce, la perfection de la plupart de ces dessins.
Mieux même ! En observant attentivement, nous en constatons la légèreté, une sorte de puissance aérienne, comme si les animaux figurés étaient en lévitation ! Les pattes des mammouths par exemple ne semblent pas subir la pression de leur poids corporel. Nous sommes bien en présence d'idées, d'images mentales, dans la mesure où, par ailleurs, nul ciel, nulle terre, nulle reproduction végétale ne viennent détourner l'attention de l'observateur, dont le regard est attiré par l’éclat et l'énergie des œuvres, et parce que les tracés obéissent à des types, et non à des nécessités de restituer des singularités puisées dans l’observation.
N'est-on pas face à l'Esprit européen dans ce qu'il a de plus pur et de plus lumineux ?
L'icône ne vient-elle pas de l'âme, et l'âme de l'Esprit du Cosmos ?
L'art n'est-il pas une rencontre avec le cœur du Monde ? L'art n'est-il pas au cœur de son être présence de l'être ? Ne vise-t-il pas à nous rendre le réel encore plus proche que ne l'est notre cœur ?
Un cœur qui ne nie pourtant pas la matière. Car la sensation prégnante d'une osmose avec la pâte des parois s'impose, non seulement parce que ceux qui ont gravé ou dessiné se sont servis avec la maîtrise des accidents minuscules de surfaces pour donner relief et vie à leurs œuvres, telle représentation d'un patriarche en majesté gravitant autour d'un petit nodule de silex figurant l’œil, telle oreille de cheval trouvant son ombre dans la convexité d'une bosse, mais aussi parce que les traces de doigts laissées en serpentins alignés sur l'argile nue, ou couvrant certains dessins, comme pour saisir sensuellement la consistance du matériau de support, soulignent un rapport charnel avec la corporéité du monde environnant, avec sa peau, qui est sa plus grande profondeur. Il me plaît d'en faire la comparaison avec les griffades laissées par les ours des cavernes, qui,après une longue hibernation, échauffaient leurs muscles, bien avant que l'Homme de Cro-Magnon ne se glissât dans les ténèbres caverneuses. De l'homme à la bête, il y a cette expérience de la force animale qui s'essaie, et la jouissance de l'existence, que consacre la résistance des choses. Sans conteste, on ne saurait interpréter la raison d'être de ces lignes hermétiques dont des attestations bien plus savantes s'observent dans d'autres grottes. Mais pour celles qui rayent les parois de Rouffignac, je me mets à penser à ces peintres et ces sculpteurs qui touchent, tâtent et essaient la substance qui prendra forme, qu'elle soit pierre, peinture ou bois, comme des amoureux caressant le corps de leur amie, comme un rituel érotique avant la belle et divine fécondation de la matière par l'Esprit.
D'aucuns songeraient à l'art zen du japon, ou à la peinture chinoise. Pourquoi pas ? Pourquoi d'ailleurs ne pas penser que ces derniers arts aient connu l'influence d'une antique civilisation eurasiatique ?
Certes, il est aventureux, dans le cas des dessins et gravures préhistoriques, d'évoquer l'art, qui est une notion relativement récente.
Cependant, la délectation que l'on éprouve en contemplant les créations de nos ancêtres ne laisse aucun doute. Ce n'est pas là une extrapolation abusive, mais une évidence empirique, existentielle : les premiers Européens étaient sensibles à la beauté. Celle-ci éclatait dans les plongées fuligineuses des grottes, à la lueur vacillante de leurs lampes à huile.
N'est-ce pas construire un pont entre et nous, par le Kalos des Grecs ?
Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | | |
Imprimer | | |
20/10/2022
Courtoisie et fin'amor

Michel Zink, Introduction à la littérature française du Moyen Age, Chapitre IV Troubadours et trouvères, pp. 45-60, Le livre de poche
Un surgissement paradoxal
Depuis bien longtemps, dés avant la formation des langues romanes, des témoignages indirects signalaient que des chansons circulaient dans le peuple, en particulier des chansons d'amour chantées par des femmes et dont l’Église s’inquiétait. Mais elle-même ne s'inspirait-elle pas de ces rythmes populaires en accueillant une poésie liturgiques dont la métrique abandonnant l'alternance des syllabes longues et brèves qui fonde la versification du latin classique, reposait sur le nombre des pieds et sur la rime ?
Pourtant, les premiers poèmes lyriques en langue romane – en l’occurrence en langue d'oc – qui nous ont été intégralement conservés n'ont rien de populaire, quel que soit le sens que l'on donne à ce mot. Ils sont complexes, raffinés, volontiers hermétiques. Ils sont éperdument aristocratiques et élitistes, affichant avec une arrogance provocante leur mépris des rustres incapables de les goûter et insensibles à l'élégance des manières et de l'esprit. Et le premier poète dont l'oeuvre nous soit parvenue était l'un des princes les plus puissants d'alors, Guillaume IX, comte de Poitiers et duc d'Aquitaine (1071-1126). En quelques années, ses successeurs et ses émules en poésie, les troubadours , se multiplient dans toutes les cours méridionales, en attendant d'être imités en France du Nord, dans la seconde moitié du XIIe siècle, par les trouvères. Une poésie de cour : tel est à l'origine ce lyrisme que l'on dit pour cette raison courtois et qui célèbre une conception de l'amour aussi nouvelle et aussi provocante que son brusque surgissement.
Courtoisie et fin'amor
La courtoisie et l'amour courtois ne constituent nullement une doctrine autonome, conçue et énoncée de façon cohérente et définitive. Ils ont bien eu une sorte de théoricien en la personne d'André le Chapelain, auteur d'un Tractatus de Amore écrit vers 1184, peut-être à la cour de Champagne, peut-être à Paris. Mais son ouvrage, codification tardive d'une pratique vieille alors de près d'un siècle, est d’interprétation douteuse. Tout ce que l'on peut faire, en réalité, est de dégager empiriquement de l’œuvre des troubadours une sensibilité et une éthique amoureuse et mondaine communes, tout en sachant qu'elles ne connaissent pas d'expression en dehors de la poésie qui en est le véhicule. C'est pourquoi commencer par en faire l'exposé, comme on y est contraint ici pour des raisons de clarté, ne peut être qu'un artifice qui conduit fatalement à durcir le trait et à gommer des nuances.
La courtoisie est une conception à la fois de la vie et de l'amour. Elle exige la noblesse du cœur, sinon de la naissance, le désintéressement, la libéralité, la bonne éducation sous toutes ses formes. Être courtois suppose de connaître les usages, de se conduire avec aisance et distinction dans le monde, d'être habile à l'exercice de la chasse et de la guerre, d'avoir l'esprit assez agile pour les raffinements de la conversation et de la poésie. Être courtois suppose le goût du luxe en même temps que la familiarité détachée à son égard, l'horreur et le mépris de tout ce qui ressemble à la cupidité, à l'avarice, à l'esprit de lucre. Qui n'est pas courtois est vilain, mot qui désigne le paysan, mais qui prend très tôt une signification morale. Le vilain est âpre, avide, grossier. Il ne pense qu'à amasser et à retenir. Il est jaloux de ce qu'il possède ou croit posséder : de son avoir, de sa femme.
Mais nul ne peut être parfaitement courtois s'il n'aime, car l'amour multiplie les bonnes qualités de celui qui l'éprouve et lui donne même celles qu'il n'a pas. L'originalité de la courtoisie est de faire à la femme et à l'amour une place essentielle. C'est une originalité au regard des positions de l’Église comme au regard des mœurs du temps. L'amant courtois fait de celle qu'il aime sa dame, sa domna (domina). C'est-à-dire sa suzeraine au sens féodal. Il se plie à tous ses caprices et son seul but est des mériter des faveurs qu'elle est toujours en droit d'accorder ou de refuser librement.
L'amour courtois, ou fin'amor, « amour parfait », repose sur l'idée que l'amour se confond avec le désir. Le désir, par définition, est désir d'être assouvi, mais il sait aussi que l'assouvissement consacrera sa disparition comme désir. C'est pourquoi l'amour tend vers son assouvissement et en même temps le redoute, car il consacrera sa disparition en tant que désir. Et c'est ainsi qu'il y a perpétuellement dans l'amour un conflit insoluble entre le désir et le désir du désir, entre l'amour et l'amour de l'amour. Ainsi s'explique le sentiment complexe qui est propre à l'amour, mélange de souffrance et de plaisir, d'angoisse et d'exaltation. Pour désigner ce sentiment, les troubadours ont un mot, le joi, diffèrent du mot joie (joya, fém.) par lequel on le traduit généralement faute de mieux. Jaufré Rudel écrit par exemple :
D'aquest amor suy cossiros
Vellan e pueys somphnan dormen,
Quar lai ay joy meravelhos.
Cet amour me tourmente
quand je veille et quand endormi, je songe :
c'est alors que mon joi est extrême.
Cette intuition fondamentale a pour conséquence que l'amour ne doit être assouvi ni rapidement ni facilement, qu'il doit auparavant mériter de l'être, et qu'il faut multiplier les obstacles qui exacerberont le désir avant de le satisfaire. D'où un certain nombre d'exigences qui découlent toutes du principe que la femme doit être, non pas inaccessible, car l'amour courtois n'est pas platonique, mais difficilement accessible. C'est ainsi qu'il ne peut théoriquement y avoir d'amour dans le mariage, où le désir, pouvant à tout moment s'assouvir, s'affadit et où le droit de l'homme au corps de la femme lui interdit de voir en elle au sens propre une maîtresse dont il faut mériter les faveurs librement consenties. On doit donc en principe aimer la femme d'un autre, et il n'est pas étonnant que la première qualité de l'amant soit la discrétion et que ses pires ennemis soient les jaloux médisants qui l'épient pour le dénoncer au mari, les lauzengiers. D'autre part la dame doit être d'un rang social supérieur à son soupirant de manière à calquer les rapports amoureux sur les rapports féodaux et à éviter que les deux partenaires soient tentés, elle d'accorder ses faveurs par intérêt, lui d'user de son autorité sur elle pour la contraindre à lui céder.
Mais il ne faut exagérer l'importance de ces règles, qui sont au demeurant moins présentes chez les poètes eux-mêmes que chez les glossateurs, ou qui ne le sont, cum grano salis, que dans un genre spécialisé dans la casuistique amoureuse comme le jeu-parti. Elles sont la conséquence la plus visible mais non la conséquence essentielle, de la confusion de l'amour et du désir. L'essentiel est le tour très particulier que cette confusion donne à l'érotisme des troubadours. Il y a chez eux un mélange d'effroi respectueux et de sensualité audacieuse devant la femme aimée, qui donne à leur amour les traits d'un amour adolescent : une propension – revendiquée – au voyeurisme, un goût pour les rêves érotiques, qui épuisent le désir sans l'assouvir, une imagination fiévreuse et précise du corps féminin et des caresses auxquelles il invite en même temps qu'un refus d'imaginer la partie la plus intime de ce corps et une répugnance à envisager la consommation même de l'acte sexuel. Ce corps, que le poète « mourra de ne pouvoir toucher nu », ce corps « blanc comme la neige de Noël », « blanc comme la neige après le gel » (toutes ces formules sont de Bernard de Ventadour), ce corps est, comme la neige, brûlant et glacial, ou glaçant.
La poésie des troubadours
En attendant d'être célébrées, dans un esprit un peu diffèrent, par les romans, courtoisie et fin'amor trouvent leur expression unique dans la poésie lyrique des troubadours de langue d'oc, et plus tard des trouvères de langue d'oïl, c'est-à-dire de ceux qui « trouvent » (trobar en langue d'oc), qui inventent des poèmes. C'est une poésie lyrique au sens exact du terme, c'est-à-dire une poésie chantée, monodique, dont chaque poète compose, comme le dit l'un d'eux, los moz e'l so, les paroles et la musique.
Le genre essentiel en est la chanson (canso, terme bientôt préféré à celui de vers employé par les premiers troubadours), expression de ce qu'on a appelé le « grand chant courtois ». La canso est un poème de quarante à soixante vers environ, répartis en strophes de six à dix vers, et terminé généralement par un envoi (tornada) qui répète par les rimes et la mélodie la fin de la dernière strophe.
(…)
De façon générale, de même que l'amour doit tendre vers une perfection idéale sans être affecté par les circonstances et les contingences, de même la chanson qui l'exprime et le reflète doit tendre vers une perfection abstraite qui ne laisse aucune place à l'anecdote. C'est ainsi que l'usage de commencer toute chanson par une évocation de la nature printanière – usage remontant sans doute aux racines mêmes du lyrisme roman et qui était l'occasion de brèves descriptions charmantes à nos yeux –, cet usage passe de mode et est raillé au XIIIe siècle, parce que, comme l'expliquent abondamment les trouvères, le véritable amoureux aime en toute saison, et non pas seulement au printemps.
Les origines
Comme celle des chansons de geste, bien que pour des raisons différentes, la naissance du lyrisme courtois a retenu, parfois de façon excessive, l'attention des érudits. Les caractères de la courtoisie et de la fin'amor, la sophistication de cette poésie, interdisent, on l'a dit, d'y voir l'émergence pure et simple d'une poésie populaire antérieure. Le point de vue fondamentalement masculin sur l'amour qui est celui de la courtoisie, la soumission de l'amant à sa dame l’excluent presque à eux seuls. Dans la plupart des civilisations, et en tout cas tout autour du bassin méditerranéen, le lyrisme amoureux le plus ancien est en effet attribué aux femmes et jette sur l'amour un regard féminin. On verra plus loin que ce que l'on peut savoir du premier lyrisme roman est conforme à cette situation générale.
Certains ont à l'inverse nié toute solution de continuité entre la poésie latine et le lyrisme courtois. Celui-ci ne serait que la transposition de la langue vulgaire de la poésie latine de cour qui est pratiquée dés le Vie siècle par l'évêque de Poitiers Venance Fortunat, lorsqu'il célèbre les nobles épouses des princes, qui est au Xie siècle celle de Strabon, d'Hildeber de Lavardin, de Baudri de Bourgueil, qui, vers la même époque, est cultivée par les clercs es écoles de Chartres, à la louange parfois des dames de la ville. Ce qui, chez les troubadours, échappe à cette exaltation platonique des dames, et en particulier les chansons grivoises du premier troubadour, Guillaume IX, serait à mettre au compte de l'inspiration ovidienne des clercs vagants ou goliards. Il est bien vrai qu'une certaine influence de la rhétorique médio-latine et que des réminiscences ovidiennes sont sensibles chez les troubadours. Mais il suffit de les lire pour mesurer combien leur ton diffère de celui de la poésie latine, où l'on ne trouve guère cette gravité passionnée qui fait de l'amour le tout de la vie morale et de la vie tout court. En outre, les centres de Chartres et d'Angers sont bien septentrionaux pour avoir joué un rôle déterminant dans la naissance d'une poésie en langue d'oc. En dehors de celle des goliards, la poésie latine était lue, et non chantée. Enfin, à de rares exceptions près, les troubadours étaient loin de posséder une culture latine suffisante pour mener à bien une telle entreprise d'adaptation.
On a souvent soutenu, depuis longtemps et non sans arguments, que la poésie courtoise et la fin'amor avaient une origine hispano-arabe. Dés le début du XIe siècle, les poètes arabes d'Espagne comme Ibn Hazm, qui écrit vers 1020 son Collier de la Colombe, – et un siècle avant eux déjà Ibn Dawud avec son Livre de la Fleur – célèbrent un amour idéalisé, dit amour odhrite, qui n'est pas sans analogie avec ce que sera la fin'amor. Belles capricieuses et tyranniques, amants dont les souffrances revêtent la forme d'un véritable mal physique pouvant conduire à la mort, confidents, messagers, menaces du gardien ou du jaloux, discrétion et secret, une atmosphère printanière : tout l'univers amoureux et poétique des troubadours est là, bien que les différences entre les deux civilisations fassent sentir leurs effets de façon non négligeable. Mais l'argument le plus fort peut-être repose sur la similitude des formes strophiques dans les deux poésies. Une influence de l'une sur l'autre n'est pas historiquement impossible. En Espagne, les deux civilisations étaient au contact l'une de l'autre. La guerre même de reconquista favorisait les rencontres, et l'on sait très précisément que dans les deux camps on avait du goût pour les captives chanteuses.
Mais alors pourquoi la poésie des troubadours a-t-elle fleuri au nord et non au sud des Pyrénées ? Quant à le strophe du muwwashah et du zadjal andalous, utilisée plus tard par les troubadours, elle est ignorée des Arabes jusqu'à leur arrivée en Espagne. De là à conclure qu'elle a été empruntée par eux aux chrétiens mozarabes et que c'est elle qui imite une forme ancienne du lyrisme roman, reprise ensuite indépendamment par les troubadours, il y a un pas qui a été franchi d'autant plus facilement par certains savants qu'ils disposaient de deux arguments en faveur de cette hypothèse. D'une part, la pointe finale (khardja) qui termine le muwwashah est parfois en langue romane – et c'est ainsi, nous y reviendrons, par le détour de la poésie arabe que nous sont connus les plus anciens fragments du lyrisme roman. Si les Arabes empruntent des citations à la poésie indigène, ils peuvent aussi lui avoir emprunté des formes strophiques. D'autre part, dés avant les troubadours, ce type strophique se trouve dans la poésie liturgique latine, qui n'avait guère de raison de s'inspirer de la poésie érotique arabe, par exemple dans les tropes de Saint-Martial de Limoges.
En réalité, aucune de ces hypothèses n'est démontrable. Aucune d'ailleurs n'est exclusive des autres : le jeu des influences a certainement été complexe. Il convient aussi, bien entendu, de tenir compte d'autres facteurs, par exemple des conditions socio-historiques : cadre particulier de la vie castrale dans lequel les jeunes nobles faisaient leur apprentissage militaire et mondain ; aspirations et revendications de cette catégorie des « jeunes », exclus longtemps et parfois définitivement des responsabilités et du mariage (George Duby) – et l'on peut remarquer l'emploi insistant et particulier du mot « jeunesse » dans la poésie des troubadours ; conséquences dans le domaine culturel des attitudes de rivalité et de mimétisme de la petite et de la grande noblesse (Erich Köhler, dont les analyses s'appliquent mieux au roman courtois qu'à la poésie lyrique). Tous ces éléments doivent être pris en considération, à condition de ne pas y chercher de déterminismes simplificateurs.
Des troubadours aux trouvères
Qui étaient les troubadours ? Certains étaient de grands seigneurs, comme Guillaume IX, Dauphin d'Auvergne, Raimbaud d'orange ou même Jaufré Rudel, « prince de Blaye ». D'autres étaient des hobereaux, comme Certrand de Born, Guillaume de Saint-Didier, Raymond de Miraval, les quatre châtelains d'Ussel. D'autres de pauvres hères, comme Cercamon, le plus ancien après Guillaume IX, dont le sobriquet signifie « celui qui court le monde », ou son disciple Marcabu, un enfant trouvé surnommé d'abord « Pain perdu », ou encore les enfants de la domesticité d'un château commer Bernard de Ventadour. D'autres, des clercs, certains défroqués, comme Peire Cardenal ; qui parvenu à l'âge d'homme quitta pour se faire troubadour la « chanoinie » où on l'avait fait entrer petit enfant, mais d'autres pas, comme le Moine de Montaudon, qui faisait vivre son couvent de cadeaux qu'il recevait pour prix de ses chansons. D'autres étaient des marchands, comme Folquet de Marseille, qui, par repentir d'avoir chanté l'amour, se fit moine, devint abbé du Thoronet, puis évêque de Toulouse. D'autres, comme Gaucelm Faiditz, étaient d'anciens jongleurs, tandis qu'inversement des nobles déclassés se faisaient jongleurs, comme, paraît-il, Arnaud Daniel. De château en château, à telle cour, auprès de telle dame ou de tel mécène, tout ce monde se rencontrait, échangeait des chansons, se citait et se répondait de l'une à l'autre, disputait des questions d'amour ou de poétique, dans les poèmes dialogués que sont les jeux partis ou s’invectivait dans les sirventès polémiques.
Comment connaissons-nous la personnalité et la vie des troubadours ? En partie par les manuscrits qui nous ont conservé leurs chansons – les chansonniers. Ce sont des anthologies dans lesquelles les œuvres de chaque troubadour sont souvent précédées d'un récit de sa vie (vida), commentaire (razo) qui prétend en éclairer les allusions en relatant les circonstances de leur composition. Certaines vidas sont à peu près véridiques. D'autres sont presque inventées de toutes pièces à partir des chansons elles-mêmes. Ce ne sont pas les moins intéressantes. Elles nous montrent dans quel esprit on lisait les troubadours à l'époque où elles ont été copiés, c'est-à-dire dans le courant ou vers la fin XIIIe siècle. Cet esprit, celui de l'anecdote autobiographique, paraît bien éloigné de l'idéalisation généralisatrice à laquelle aspire la poésie des troubadours.
C'est que les temps avaient changé. Le courtoisie elle-même avait changé en passant en France du Nord et, au début du XIIIe siècle, lors de la croisade albigeoise, la France du Nord devait imposer rudement le changement aux cours méridionales.
Le lyrisme courtois s'acclimate en France du Nord vers le milieu du XIIe siècle. Le symbole, sinon la cause, de cette expansion est le mariage en 1137 d'Aliénor d'Aquitaine, la petite fille du premier troubadour, avec le roi de France Louis VII le Jeune, puis, après sa répudiation en 1152, avec le roi d'Angleterre Henri II Plantagenêt. L'une des deux filles nées de son premier mariage, Marie, devenue comtesse de Champagne, sera peut-être la protectrice d'André le Chapelain et surtout celle de Chrétien de Troyes. L'esprit courtois atteint ainsi toutes les grandes cours francophones.
Emules des troubadours, les trouvères se distinguent cependant par plusieurs traits de leurs modèles. Dans le cadre du grand chant courtois, ils se montrent généralement plus réservés, plus pudibonds même. Usant avec une habileté très délibérée de toutes les ressources de la versification et de la rhétorique (Roger Dragonetti, La Technique poétique des trouvères dans la chanson courtoise, Bruges, 1960), ils gomment plus leurs effets que les troubadours et ne recourent guère au style âpre, flamboyant, paradoxal et tendu cher aux méridionaux. Le trobar clus, qui même dans le Sud n'a été en fait qu'une mode passagère, leur est inconnu. En revanche, leurs mélodies nous sont plus souvent parvenues que celles des troubadours, et les derniers d'entre eux, comme Adam de la Halle dans les années 1280, feront faire des progrès décisifs, à la polyphonie, entraînant d'ailleurs du même coup l'éclatement inéluctable de la synthèse du texte et de la musique sur laquelle reposait le lyrisme courtois.
Il faut ajouter que les conditions mêmes de la vie littéraire sont diffèrentes. Certes, on trouve parmi les trouvères le même éventail social que chez les troubadours. Il y a parmi eux des princes, comme le comte Thibaud IV de Champagne, roi de Navarre, poète fécond et subtil, ou Richard Cœur-de-lion, qui n'a laissé à vrai dire qu'une chanson, et d'assez grands seigneurs, ou au moins des personnages de premier plan, comme Conon de Béthume ou Gace Brulé. Mais la proportion des nobles dilettantes, auteurs chacun de quelques chansons parce que cela fait partie du jeu social, est plus faible que dans le Sud ; un signe en est que, pour une production globale à peu près égale, nous ne connaissons les noms que de deux cents trouvères environ contre quatre cent cinquante troubadours. Surtout, quelle que soit l'importance des grandes cours lettrées comme celle de Champagne, la plupart des trouvères, à partir de la fin du XIIe siècle, appartiennent au milieu littéraire des riches villes commerçantes du Nord de la France, en particulier d'Arras.
Dans plusieurs de ces villes apparaissent au XIIIe siècle des sociétés littéraires qui organisent des concours de poésie. La plus illustre est le Puy d'Arras, lié à une confrérie nommée de façon significative Confrérie des jongleurs et bourgeois d'Arras et dominé par les grandes familles commerçantes de la ville. Ces poètes urbains, qui peuvent être aussi bien des bourgeois que des clercs, des jongleurs ou des nobles, continuent bien entendu à pratiquer le grand chant courtois. Mais sans retomber dans l'erreur ancienne qui serait de vouloir définir une littérature « bourgeoise » au XIIIe siècle, il faut bien reconnaître qu'ils ont un goût marqué, et presque inconnu des troubadours, pour des genres lyriques qui constituent une sorte de contrepoint parfois comique et grivois de la courtoisie ou qui paraissaient hériter d'une tradition antérieure à elle.
C'est pourquoi nous avons attendu d'en venir aux trouvères pour aborder les genres lyriques non courtois, bien que certains paraissent descendre des formes primitives de la poésie romane...
Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | | |
Imprimer | | |
29/08/2022
L'écriture de Charles de Gaulle et le destin de la France (Dominique de Roux)
Dominique de Roux, L'écriture de Charles de Gaulle, Au-delà du déclin, pp. 32-37, Éditions du Rocher
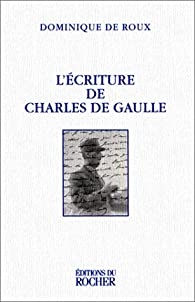
Quel mensonge ? Le mensonge qui jusqu'à la fin permettra à la parole de l'emporter sur l'être, que la lettre n'en finisse plus de l'emporter sur l'esprit, ni la honte sur la désespérance. A la limite, et en attendant que l'heure finale vienne, l'action n'est que le combat désespéré de celui qui se bat non pour vaincre mais pour continuer. A la limite, l'être c'est le courage de l'être. On songe pour une dernière fois aux Antimémoires d'André Malraux, au passage où il revient à la parole sacrée du Bhagavad Gîta : « Arjuna regarde ceux qui vont mourir, et Krishana lui rappelle que si la grandeur de l'homme est de se délivrer du destin, la grandeur du guerrier n'est pas de se délivrer du courage. »
Personnage symbolique, mémoires, avant de mourir, revoir une jeunesse française, phrase suspendue, avant les Grandes Invasions, l'heure est passée, le mensonge, se délivrer du destin ne pas se délivrer du courage : ce sont là, entre autres, entre des milliers d'autres, vivants et morts agonisants entre la vie et la mort, les signes, la liturgie de cette prédestination dont Charles de Gaulle n'en finit plus d'écrire le Livre de l'Absence, l'immortalité de la mort en attendant la mort de l'immortalité.
En dernière analyse, le problème de l'écriture de Charles de Gaulle apparaît non pas comme celui des rapports tragiques entre la parole et l'action, mais comme le cheminement prophétique de cette écriture à travers les mots qui la constituent et qu'elle dévaste, qui la font être et qu'elle illumine jusqu'au paroxysme avant qu'il ne la lui faille chaque fois rendre au néant, au rien de leur subordination infinie. Saisir, dans sa marche même, la dialectique opposant, dans cette écriture, cette écriture elle-même, en tant que signification immédiatement saisissable, aux mots dont elle se saisit et se dessaisit, c'est approcher le secret de de cette prédestination qui en fait l'horizon de sa rencontre avec l'histoire, y établit le champ clos de sa dévotion tragique envers le néant nécessaire des choses qui ne sont qu'en tant que dépassement, et, si comme le dit Hegel « ce que nous sommes, nous le sommes historiquement », parvient, ou parviendra, à l'heure voulue, au pouvoir d'être, elle-même, de par elle-même, le destin. L'écriture de Charles de Gaulle c'est l'écriture du destin.
Quel destin ? Une intelligence prophétique de l'Histoire, prenant à son compte les armes de la liberté la plus grande, assumant le devoir et la tragédie de la Grande Politique, ne saurait s'interroger ni ne peut s'accomplir que par une vision de le fin du monde, en tant que vision finale et action finale d'un monde. Une certaine idée de la France, qu'elle concerne une écriture, une certaine action, une certaine destinée, une certaine mission, mettra toujours en cause une certaine idée de l'Histoire universelle. Si la France a un destin, une vocation, une mission essentielle, l'histoire doit s'en trouver concernée et, plus encore, déterminée, à la fois dans sa marche vers la fin et dans l'accomplissement visible ou invisible de cette marche. Si l'histoire est l'histoire à sa fin, si la France a une destinée historique absolue, elle ne saurait concerner que la fin de l'histoire. Aussi peut-on dire : si dans sa démarche la plus profonde, l'écriture de Charles de Gaulle concerne une vision de la France, celle-ci se trouve posée secrètement en termes d'Apocalypse, et sa Grande Politique, et qui vise à lui donner ses armes, se pose alors en volonté de puissance.
Mais entre la vision d'une politique et les armes de sa puissance, il y a toujours l'ombre dont l'écriture rend compte sans trêve, l'ombre qui à la fois porte cette vision vers les armes de sa projection historique et ne cesse de les séparer, cette ombre, dont le nom est successivement le possible et l'impossible, « ... toute la vertu du monde ne prévaut point contre le feu » (La France et son armée). Aussi, la tragédie historique de l'aventure gaulliste est-elle peut-être tout entière dans l'inadéquation régnant entre le grand dessein d'un homme prédestinée et la substance même de son œuvre. Que celui-ci se fasse une certaine idée de la France n'implique pas, fatalement, qu'une certaine France historique en vienne à se faire une même idée d'elle-même ni du destin de Charles de Gaulle, et encore moins de sa prédestination. Mais qu'est-ce qu'une écriture sans l'ombre qu'elle porte en elle ? Et qu'est-ce que l'ombre intérieure de cette écriture sans l'ombre de cette ombre sur le front de l'écriture à travers laquelle se fait l'histoire dont toute écriture n'est que l'ombre ?
Car tout est dans le dédoublement.
Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | | |
Imprimer | | |


