06/02/2023
Nerval et la Tradition primordiale : le culte d'Isis (Deuxième partie)
Gérard de Nerval, Les Filles du feu ; Les Chimères, Isis, II., pp. 240-254, Folio Classique

II.
Cela se faisait dans l'après-midi, au moment de la fermeture solennelle du temple, vers quatre heures, selon la division moderne du temps, ou, selon la division antique, après la huitième heure du jour. – C'était ce que l'on pourrait proprement appeler le petit coucher de la déesse. De tous temps, les dieux durent se conformer aux us et coutumes des hommes. – Sur son Olympe, le Zeus d'Homère mène l'existence patriarcale, avec ses femmes, ses fils et ses filles, et vit absolument comme Priam et Arsinoüs aux pays troyen et phéacien. Il fallut également que les deux grandes divinités du Nil, Isis et Sérapis, du moment qu'elles s'établirent à Rome et sur les rivages d'Italie, s’accommodassent à la manière de vivre des Romains. – Même du temps des derniers empereurs, on se levait de bon matin à Rome, et, vers la première ou la deuxième heure du jour, tout était en mouvement sur les places, dans les cours de justice et sur les marchés. – Mais ensuite, vers la huitième heure de la journée ou la quatrième de l'après-midi, toute activité avait cessé. Plus tard Isis était encore glorifiée dans un office solennel du soir.
Les autres parties de la liturgie étaient la plupart de celles qui s'exécutaient aux matines, avec cette différence toutefois que les litanies et les hymnes étaient entonnés et chantés, au bruit des sistres, des flûtes et des trompettes, par un psalmiste ou préchantre qui, dans l'ordre des prêtres, remplissait les fonctions d'hymnode. – Au moment le plus solennel, le grand prêtre, debout sur le dernier degré, devant le tabernacle, accosté à droite et à gauche de deux diacres ou pastophores, élevait le principal élément du culte, le symbole du Nil fertilisateur, l'eau bénite, et la présentait à la fervente adoration des fidèles. La cérémonie se terminait par la formule de congé ordinaire.
Les idées superstitieuses attachées à de certains jours, les ablutions, les jeûnes, les expiations, les macérations et les mortifications de la chair étaient le prélude de la consécration à la plus sainte des déesses de mille qualités et vertus, auxquelles hommes et femmes, après maintes épreuves et mille sacrifices, s'élevaient par trois degrés. Toutefois l'introduction de ces mystères ouvrit la porte à quelques déportements. – A la faveur des préparations et des épreuves qui, souvent, duraient un grand nombre de jours et qu'aucun époux n'osait refuser à sa femme, aucun amant à sa maîtresse, dans la crainte du fouet d'Osiris ou des vipères d'Isis, se donnaient dans les sanctuaires des rendez-vous équivoques, recouverts par les voiles impénétrables de l'initiation. – Mais ce sont là des excès communs à tous les cultes dans leurs époques de décadence. Les mêmes accusations furent adressés aux pratiques mystérieuses et aux agapes des premiers chrétiens. – L'idée d'une terre sainte où devait se rattacher pour tous les peuples le souvenir des traditions premières et une sorte d'adoration filiale, – d'une eau sainte propre aux consécrations et purifications des fidèles, – présente des rapports plus nobles à étudier entre ces deux cultes, dont l'un a pour ainsi dire servi de transition vers l'autre.
Toute eau était douce pour l’Égyptien, mais surtout celle qui avait été puisée au fleuve, émanation d'Osiris. – A la fête annuelle d'Osiris retrouvé, où, après de longues lamentations, on criait : Nous l'avons trouvé et nous nous réjouissons tous ! tout le monde se jetait par terre devant la cruche remplie d'eau du Nil nouvellement puisée que portait le grand-prêtre ; on levait les mains vers le ciel, exaltant le miracle de la miséricorde divine.
La sainte eau du Nil, conservé dans la cruche sacrée, était aussi à la fête d'Isis le plus vivant symbole du père des vivants et des morts. Isis ne pouvait être honoré sans Osiris. – Le fidèle croyait même à la présence réelle d'Osiris dans l'eau du Nil, et, à chaque bénédiction du soir et du matin, le grand-prêtre montrait au peuple d'Hydria, la sainte cruche, et l'offrait à son adoration. – On ne négligeait rien pour pénétrer profondément l'esprit des spectateurs du caractère de cette divine transsubstantiation. – Le prophète lui-même, quelque grande que fût la sainteté de ce personnage, ne pouvait saisir avec ses mains nues le vase dans lequel s’opérait le divin mystère. – Il portait sur son étole, de la plus fine toile, une sorte de pèlerine (piviale) également de lin ou de mousseline, qui lui couvrait les épaules et les bras, et dans laquelle il enveloppait son bras et sa main. – Ainsi ajusté, il prenait le saint vase, qu'il portait ensuite, au rapport de saint Clément d'Alexandrie, serré contre son sein. – D'ailleurs, quelle était la vertu que le Nil ne possédât pas aux yeux du pieux Égyptien ? On en parlait partout comme d'une source de guérison et de miracles. – Il y avait des vases où son eau se conservait plusieurs années. « J'ai dans ma cave de l'eau du Nil de quatre ans », disait avec orgueil le marchand égyptien à l'habitant de Byzance ou de Naples qui lui vantait son vieux vin de Falerne ou de Chios. Même après la mort, sous ses bandelettes et dans sa condition de momie, l’Égyptien espérait qu'Osiris lui permettrait encore d'étancher sa soif avec son onde vénérée. – Osiris te donne de l'eau fraîche ! disaient les épitaphes des morts. – C'est pour cela que les momies portaient une coupe peinte sur la poitrine.
Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | | |
Imprimer | | |
Création du monde par la Vierge du jour et le Milouin (Le Kalevala, Chant premier)
Elias Lönnrot, Le Kalevala – Epopée des Finnois, Chant 1 Exorde – Création du monde par la Vierge du jour et le Milouin – Naissance de Väinämöien, fils de la mère des eaux., pp.11-23, Éditions Gallimard, nrf, L'aube des peuples
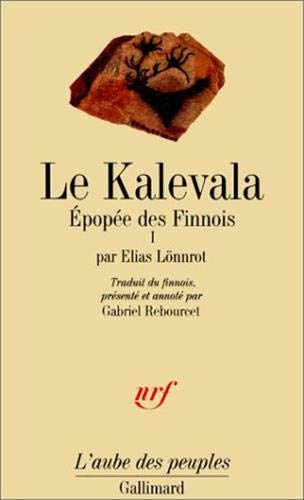
Le désir têtu me démange,
l'envie me trotte la cervelle,
d'aller entonner la chanson,
bouche parée pour le chant mage
égrenant le dit de ma gent,
la rune enchantée de ma race.
Les mots me fondent dans la bouche,
grains de gorge, pluie de paroles,
ils se ruent, torrent sur ma langue,
ils s'embruinent contre mes dents.
Petit frère, mon frérot d'or,
mon beau compagnon de jeunesse !
Fais-moi compagnie pour le chant
viens-t'en me joindre au jeu des runes
car nous sommes ce jour ensemble
après maint jour en d'autres bords !
Rare est le jour qui nous rassemble,
le temps que nos chemins se croisent
en ces confins de pauvres terres,
champs de Norois, terres piteuses.
Topons çà la main dans la main,
doigts glissés par entre les doigts
pour entonner la chanson bonne
et bailler la rune meilleure,
la foule d'or pourra l'entendre
pour savoir, la flopée curieuse,
ceux de la jeunesse levante,
haute pousse, les ouailles belles :
Ce sont les mots de l'héritage,
runes tournée au baudrier,
du vieux Väinämöinen,
sous la forge d'Ilmarinen,
l'épée de Lemminkänen,
l'arc de Joukahainen,
au fin fond des champs de Pohja,
les landes du Kalevala,
Mon père les chantait jadis,
en taillant un fût de ognée,
ma mère les a dévoilés
quand elle torsait la quenouille,
moi le marmot sur le plancher
je tournaillais dans ses jupons,
méchant moutard, barbe de lait,
tout menu, bouche en caillebotte,
Sampo ne fallait point de mots
ni Louhi de sortilèges :
Sampo est mort de mots bavards
et Louhi de ses charaudes,
Vipunen creva dans ses rimes
et Lemminkä dans ses goguettes,
Or je sais tant d'autres paroles,
secrets appris par devinades :
ripés sur le bords des chemins,
cueillis dans la brande aux bruyères,
dans les fourrés, griffe brindille,
racle ramille à la ramée,
tous grattés au ras des fenées,
tous agrippés dans la cavée
quand j'allais la sente en berger,
gamin, aux pasquiers du bétail
dans les touffes coiffées de miel,
par les buttes, les cimes d'or
derrière Muurikki la noire,
avec Kimmo, la panse caille.
Le froid m'a fredonné la rime
et la pluie m'a versé les runes.
Le vent m'a soufflé d'autres chants,
la houle en mer les ad drossés.
Les oiseaux picoraient les mots,
mainte parole en cime d'arbres.
J'en ai roulé mon écheveau,
serrés, noués, belle pelote.
J'ai mis l'écheveau sur ma luge,
la pelote au fond du traîneau.
J'ai tiré la luge au logis,
mon traîneau devant le hâloir ;
j'ai tout mis dans la banne en bronze,
au bout du chafaud du grenier,
Ils ont vu le froid des semaines,
long temps nichés sous le chagrin.
Vais-je tirer mes chants du froid,
puiser mes runes fors le gel,
porter la bannette au logis,
le boissel, dessus l'escabeau
sous la faîtière au grand renom,
belle poutres, le bon abri ?
Je déclos le coffre des mots
clenche lâche, l'arche des runes,
je tire le bout du lisseau,
j'ouvre le nœud de l'écheveau ?
Je peux chanter la rime bonne,
je la chantourne toute belle
pour une miche de mie de seigle
et la bière brassée de l'orge.
Quand on ne baille point de bière
ni la godaille à pleine chope,
je chante de bouche plus maigre,
je dis la rune à gorgée d'eau
pour la joie de notre veillée
je salue ce jour mémorable
et je dis les joies à venir,
l'aube d'une aurore nouvelle.
*
Ainsi jadis j'ai donc ouï directement
telle rune, par bon savoir :
les nuits nous viennent seules, noires,
les jours lèvent seuls, soleils pâles,
tout seul Väinämöinen
un jour est né, barde sans âge
par le ventre de la porteuse,
Ilmatar, la mère du monde.
La vierge vit, fille du ciel,
dame belle de la nature.
Elle vit pure des semaines,
jour et jours en vie de pucelle
dans les plessis larges du ciel,
plessis larges, l'enclos de plaine.
Elle se languit chaque jour,
peine étrange, elle vit d'ennui,
toujours seule à couler ses jours,
elle vit, pucelle sans rire,
dans les plessis larges du ciel,
plessis larges, plaine béante.
Lors elle trotte vers l'aval,
elle descend dessus les vagues
sur la mer à l'échine claire,
le grand largue, la houle ouverte.
Vient le vent par grande rafale,
l'air mauvais levé du levant ;
il dresse la mer en remous,
la chahute en vagues rageuses.
Or donc le vent berce la fille,
la vague drosse la pucelle
sur les reins bleus tout à l'entour,
par les vagues coiffées d'écume :
lui vente feton dans le ventre,
la mer engrosse la pucelle.
Elle porte le feton dur,
peine lourde, son ventre plein,
année sur année, sept centaines,
le temps de vie de neuf gaillards ;
mais point de naissance à venir,
le feton de rien ne choit guère.
La vierge va, mère de l'eau.
Nage au levant, nage au ponant,
nage au norois, jusqu'au midi,
par tous les rivages du ciel,
giron taraudé par le feu,
peine lourde en son ventre plein ;
mais point de naissance à venir,
le feton de rien ne choit guère.
La pucelle roule en sanglots,
parle en sanglots, gémit ces mots :
« Ô misère, jour de mes jours,
quelle menée, fille de guigne !
Me voici mise en male route :
toute ma vie dessous de ciel
balancée par le grain du vent,
drossée par la houle en dérive
sur ces eaux grandes, grosses vagues,
les remous du roulis profond !
« Je saurais des jours bien meilleurs
à vivre en pucelle du ciel,
des jours meilleurs que cette vie,
mère des eaux pour la dérive :
ici ma vie est de froidure,
âpre sente et chemin de peine,
et les vagues sont mon logis,
les trouées d'eau mes routes larges.
« Ô Ukko, Dieu dessus les dieux,
ô toi qui portes tout le ciel !
Viens-t'en pallier à mon besoin,
à grand'hâte quand je t'appelle !
« Tire la fille de ses crampes,
la femme aux tortis de son ventre !
Viens-t'en vite et créans t'en cours,
le besoin me presse et me froisse ! »
Le temps passe, une poudrée d'âge,
un filet de temps s'est sauvé.
Vient le milouin, vol droit, bec bleu,
l'oiseau vole sa haute brasse,
il cherche la place d'un nid,
un coin de terre où se nicher.
Vole au levant, vole au ponant,
vole au norois, jusqu'au midi.
Ne trouve nul coin pour son nid,
nul brin d eterre même pire
pour y brindiller sa nichée,
et prendre gîte après le vol.
Il vole ici, voltige là,
lors le milouinan parle au vent :
« Ferai-je ma cabane au vent,
sur les vagues, mon beau logis ?
Le vent va verser ma cabane
et la vague rouler mon gîte. »
En ce temps la mère des eaux,
dame de l'eau, vierge du ciel,
lève son genou de la mer,
son épaule dessus les vagues
pour la nichée du milouin bleu
le doux logis pour le plongeur.
Le milouin, bec bleu, bel oiseau,
plane par-ci, voltige là.
Il voit le genou de la femme,
à fleur de la mer aux reins bleus,
le prend pour un toupet de foin,
motte de tourbe toute fraîche.
Il lisse son vol, lance l'aile,
se pose à la fleur du genou,
sitôt là brindille son nid,
il pond ses œufs, coquilles d'or :
six œufs, les coquilles sont d'or,
le septième est un œuf de fer.
Il se met à couver ses œufs,
il chauffe la fleur du genou,
Il couve un jour, couve deux jours,
tantôt trois jours il a couvé.
Or déjà la mère des eaux,
dame de l'eau, vierge de l'air,
sent le feu mordre son genou,
la braise en hargne sur sa peau,
cuidant que le genou lui brûle,
et les veines chauffées lui fondent.
Elle chahute son genou,
elle ébroue sa jambe en secousses :
les œufs dégringolent dans l'eau,
versent tous à la vague en mer,
ils sont brisés, gerbes d'écailles,
jonchés d'esquilles fracassées,
Les œufs n'iront point à la vase,
aux remous de l'eau les écailles.
Les débris prennent bonne allure,
les morceaux muent en belle mine :
La coquille basse de l’œuf
sera la terre, coque basse ;
la coquille haute de l’œuf
sera le ciel, la voûte haute ;
la mie haute du feton jaune
sera le soleil, feu du jour ;
la mie haute de l'étui blanc,
ce sera la lune en lueur ;
les points diaprés sur la coquille
seront les étoiles du ciel ;
sur la coque les taches noires
feront les nuages dans l'air.
Le temps passe, le temps s'avance,
les années chassent les années
sous le feu du soleil nouveau,
les lueurs de la lune neuve.
La mère de l'eau nage encore,
dame de l'eau, vierge de l'air,
nage toujours par les eaux calmes,
dans les houles coiffées de brume,
devant elle la vague molle,
et devers elle le ciel clair.
A l'orée de l'année neuvième,
or dés le dixième estivage,
elle lève son front de l'eau,
haute proue par-dessus la mer.
Elle commence les genèses,
elle engendre ses créations,
sur la mer à l'échine claire,
le grand largue en plaine béante.
Elle tourne la main par-ci,
ce sont des caps à sa caresse ;
elle boute son pied par-là,
les fosses pour le frai se creusent ;
elle gauille la vague en bulles
et ce sont les gouffres profonds.
Puis courbe ses reins vers la terre :
ce sont les rives, grèves lisses ;
se retourne pieds contre terre :
ce sont frayères de saumons ;
pose sa tête contre terre :
ce sont les baies, baîllées de terre.
Lors elle nage loin de terre,
elle fait halte vers le large :
ce sont les récifs de la mer,
les brisants cachés sous la vague
pour le naufrage des navires,
la malemort pour les marins.
Ainsi les îles sont brossées,
les récifs piqués sur la mer
et fichés les pilliers du ciel,
terres, contrées sont déparlées,
les traits sont tracés sur les pierres,
lignes marbrées dans la rocaille.
Or mais Väinämöinen
n'est point né, le barde sans âge.
Le vieux Väinämöinen
va dans le ventre de sa mère
depuis tantôt trente estivages,
autant d'hiver qu'il s'en dérive
par les eaux calmes, la bonace,
sur les vagues coiffées de brume.
Lors il pense, le sage, il songe
pourquoi demeurer, comment vivre
dans sa cachette fourrée d'ombre,
dans son gîte voûté d'angoisse
où jamais il n'a vu la lune
ni perçu les grains de soleil.
Il parle de haute parole
ainsi chante les mots qui suivent :
« Lune et soleil, vite, à mon aide,
Grande Ourse, sois-moi bonne guide
que je passe la porte obscure,
loin de la barrière étrangère,
le petit nid de maigre couche,
ma demeure voûtée d'angoisse !
« Tire à terre l'homme de route,
l'enfant de l'homme, sous le ciel,
qu'il regarde la lune au ciel,
le soleil aux rayons de joie,
qu'il vienne apprendre la Grande Ourse
et reguigner vers les étoiles ! »
Or la lune faillit à l'aide,
le soleil faut à délivrer ;
jour après jour il se languit,
vie d'ennui, longs jours de souffrance :
il hoche à hue l'huis du fortin
par le doigt menu, le sans nom,
il huche à dia le loquet d'os
par un orteil de son pied gauche ;
passe le seuil à grippe griffe,
à genouillons par l'huis du porche.
Lors il dévale vers la mer,
tête et bras roulant à la houle ;
bonhomme reste au creux des vagues,
parmi les roulis, le gaillard.
Cinq ans vaque, cinq ans dérive,
cinq années, six années tantôt,
puis l'an septième, et le huitième.
Il se dresse enfin sur l'eau grande,
vers le cap aux rives sans nom,
terre ferme, terre sans arbres.
Il se hisse, genoux en terre,
se cambre à la force des bras :
il est debout pour voir la lune,
pour s'ébahir au pied du jour,
il suit les voies de la Grande Ourse
et ses yeux boivent les étoiles.
Ainsi Väinämöinen
a vu le jour, le barde brave,
par le ventre de la porteuse,
Ilmatar la mère du monde.
Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | | |
Imprimer | | |
05/02/2023
Nerval et la Tradition primordiale : le culte d'Isis (Première partie)
Gérard de Nerval, Les Filles du feu ; Les Chimères, Isis, I., pp. 240-254, Folio Classique

I.
Avant l'établissement du chemin de fer de Naples, à Résina, une course à Pompéi était tout un voyage. Il fallait une journée pour visiter successivement Herculanum, le Vésuve, – et Pompéi, situé à deux milles plus loin ; souvent même on restait sur les lieux jusqu'au lendemain, afin de parcourir Pompéi pendant la nuit, à la clarté de la lune, et de se faire ainsi une illusion complète. Chacun pouvait supposer en effet que, remontant le cours des siècles, il se voyait tout à coup admis à parcourir les rues et les places de la ville endormie ; la lune paisible convenait mieux peut-être que l'éclat du soleil à ces ruines, qui n'excitent tout d'abord ni l'admiration ni la surprise, et où l'antiquité se montre pour ainsi dire dans un déshabillé modeste.
Un des ambassadeurs résidant à Naples donna, il y a quelques années, une fête assez ingénieuse. – Muni de toutes les autorisations nécessaires, il fit costumer à l'antique un grand nombre de personnes ; les invités se conformèrent à cette disposition, et, pendant un jour et une nuit, l'on essaya diverses représentations des usages de l'antique colonie romaine. On comprend que la science avait dirigé la plupart des détails de la fête ; des chars parcouraient les rues, des marchands peuplaient les boutiques ; des collations réunissaient, à certaines heures, dans les principales maisons, les diverses compagnies des invités. Là, c'était l'édile Pansa, là Salluste, là Julia-Felix, l'opulente fille de Scaurus, qui recevaient les convives et les admettaient à leurs foyers. – La maison des Vestales avait ses habitantes voilées ; celle des Danseuses ne mentait pas aux promesses de ses gracieux attributs. Les deux théâtres offrirent des représentations comiques et tragiques, et sous les colonnades du Forum des citoyens oisifs échangeaient les nouvelles du jour, tandis que, dans la basilique ouverte sur la place, on entendait retentir l'aigre voix des avocats ou les imprécations des plaideurs. – Des toiles et des tentures complétaient, dans tous les lieux où de tels spectacles étaient offerts, l'effet de décoration, que le manque général des toitures aurait pu contrarier ; mais on sait qu'à part ce détail, la conservation de la plupart des édifices est assez complète pour que l'on ait pu prendre grand plaisir à cette tentative palingénésique. – Un des spectacles les plus curieux fut a cérémonie qui s'exécuta au coucher du soleil dans cet admirable petit temple d'Isis, qui, par sa parfaite conservation, est peut-être la plus intéressante de toutes ces ruines.
Cette fête donna lieu aux recherches suivantes, touchant les formes qu'affecta le culte égyptien lorsqu'il en vint à lutter directement avec la religion naissante du Christ.
Si puissant et si séduisant que fût ce culte régénéré d'Isis pour les hommes énervés de cette époque, il agissait principalement sur les femmes. – Tout ce que les étranges cérémonies et mystères des Cabires et des dieux d’Éleusis, de la Grèce, tout ce que les bacchanales du Liber Pater et de l'Hébon de la Campanie avait offert séparément à la passion de merveilleux et de la superstition même se trouvait, par un religieux artifice, rassemblé dans le culte secret de la déesse égyptienne, comme en un canal souterrain qui reçoit les eaux d'une foule d'affluents.
Outre les fêtes particulièrement mensuelles et les grandes solennités, il y avait deux fois par jour assemblée et office publics pour les croyants des deux sexes. Dés la première heure du jour, la déesse était sur pied, et celui qui voulait mériter ses grâces particulières devait se présenter à son lever pour la prière du matin. – Le temple était ouvert avec grande pompe. Le grand-prêtre sortait du sanctuaire accompagné de ses ministres. L'encens odorant fumait sur l'autel ; de doux sons de flûte se faisaient entendre. – Cependant la communauté s'était partagée en deux rangs, dans le vestibule, jusqu'au premier degré du temple. – La voix du prêtre invite à la prière, une sorte de litanie est psalmodiée, puis on entend retentir dans les mains de quelques adorateurs les sons éclatants du sistre d'Isis. Souvent une partie de l'histoire de la déesse est représentée au moyen de pantomimes et de danses symboliques. Les éléments de son culte sont présentés avec des invocations du peuple agenouillé, qui chante ou qui murmure toutes sortes d'oraisons.
Mais si l'on avait, au lever du soleil, célébré les matines de la déesse, on ne devait pas négliger de lui offrir ses salutations du soir et de lui souhaiter une nuit heureuse, formule particulière qui consistait une des parties importantes de la liturgie. On commençait par annoncer à la déesse elle-même l'heure du soir.
Les anciens ne possédaient pas, il est vrai, la commodité de l'horloge, sonnante ni même de l'horloge muette ; mis ils suppléaient, autant qu'ils ne le pouvaient, à nos machines d'acier et de cuivre par des machines vivantes, par des esclaves chargés de crier l'heure d'après la clepsydre et le cadran solaire ; – il y avait même des hommes qui, rien qu'à la longueur de leur ombre, qu'ils savaient estimer à vue d’œil, pouvaient dire l'heure exacte du jour ou du soir. – Cet usage de crier les déterminations du temps était également admis dans les temples. Il y avait des gens pieux à Rome qui remplissaient auprès de Jupiter capitolin ce singulier office de lui dire les heures. – Mais cette coutume était principalement observée aux matines et aux vêpres de la grande Isis, et c'est de cela que dépendait l'ordonnance de la liturgie quotidienne.
Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | | |
Imprimer | | |


