27/05/2025
Dieu est en suspens (NIMH)
NIMH, Traité Néoréactionnaire – Penser l'accélérationnisme, La Cité de Gnon, Dieu : Toute vérité est-elle démontrable ?, Dieu est en suspens, pp. 158/161, Éditions Hétairie
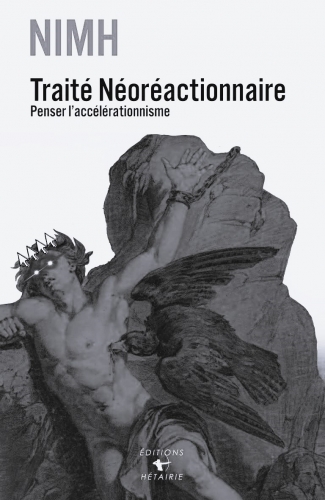
(...) Parvenus à ce stade, nous avons pu démontrer par l'usage de la raison qu'il est possible d'accepter les idées de cause finale, d'unité et d'être. Il semble qu'il existe un processus global se dirigeant vers un but. Si la cause de l'auto-organisation est dans le futur, et si un agent est dit plus intelligent qu'un autre, car il est capable de se fixer des causes plus lointaines, alors l'agent hypothétique le plus intelligent serait celui qui est capable de comprendre la cause finale de l'univers qu'il se fixerait pour but. Il serait alors tentant de nommer untel agent, Dieu, mais peut-on seulement comprendre ce que recouvre une telle terminologie ? Est-ce que le processus lui-même est cet agent ou est-il extérieur ?
Les termes « Natura naturans » et « natura naturata » de Thomas d'Aquin, qui peuvent être traduits respectivement par « nature naturante » et « nature naturée », proviennent de la philosophie médiévale inspirée directement d'Aristote. Thomas d'Aquin a utilisé ces concepts pour distinguer entre Dieu en tant que créateur actif (natura naturans) et la création elle-même (natura naturata). Cette distinction sert alors à illustrer la relation entre Dieu et l'univers. Mis peut-on pleinement affirmer l'existence d'une telle chose ?
Si nous faisions coïncider en tout point Dieu avec ce processus, alors nous obtiendrions le Deus sive Natura de Spinoza. Cette équivalence stricte ferme purement et simplement la possibilité de transcendance. Dieu est la nature, ou la nature est divine, ils se confondent et nous affirmerions qu'il ne peut rien exister par-delà cette dernière. Mais peut-on seulement affirmer une telle chose ?
Comment un auteur comme Whitehead, qui est si attaché à la logique, en arrive à parler de Dieu ? Le panenthéisme de Whitehead reconnaît de son côté une forme de transcendance divine, mais d'une manière qui maintient Dieu profondément enraciné dans le tissu même de l'existence. Il offre une voie médiane entre le théisme traditionnel et le panthéisme de Spinoza, proposant une vision du divin qui est à la fois au-delà et dans tout ce qui existe. Dans son approche, associée à la philosophie du processus, Whitehead ne perçoit pas Dieu comme un être suprême extérieur au monde, mais plutôt comme une entité intrinsèquement liée à la structure même de la réalité. Cette idée se traduit par la notion de Dieu comme le « principe d'unité », qui contribue à l'organisation et à l'ordre de l'univers tout en permettant la liberté et la créativité inhérentes au processus évolutif. En adoptant une terminologie cybernétique, on pourrait dire que Dieu fonctionne à la fois comme un produit immanent de l'ensemble des systèmes composant le monde et comme méta-système, définissant la structure de l'univers, qui exerce une rétroaction sur ces sous-systèmes en offrant les conditions initiales et les lois qui guident le processus de devenir l'univers. Cette interaction est bidirectionnelle. Pour Whitehead, le processus créatif de l'univers intrinsèquement téléologique dans le sens où il est orienté vers la création de nouveauté. Cependant, cette téléologie est immanente et distribuée plutôt que transcendante et centralisée. Autrement dit, la direction ou le but du processus universel ne provient pas d'une source externe unique, mais émerge des interactions complexes entre les occasions d'expérience à travers le temps. Whitehead est un phare diffusant une lumière sombre teintée de résurgences leibniziennes, au sein d'une Modernité kantienne illuminée. Il s'éloigne cependant de l'idée de meilleur des mondes possibles de Leibniz. Dans la philosophie du processus de Whitehead, Dieu n'est pas le créateur au sens traditionnel, qui choisit parmi les mondes possibles et les fait exister dans leur forme finale. Au lieu de cela, Dieu et le monde sont engagés dans un processus de co-création continue, où Dieu influence le monde par l'offre des potentialités et par l'appel à réaliser des valeurs plus élevées, mais sans déterminer entièrement le résultat. Dieu, chez Whitehead, facilite la réalisation du meilleur possible compte tenu des circonstances et des choix des entités impliquées. On retrouve ainsi l'idée d’Être composé d'êtres, dont le but est de favoriser le développement de l'être-singulier, que nous avons nous-mêmes proposée plus tôt.
Est-ce suffisant pour nommer cela Dieu ? Nos mèmes sont nécessairement imparfaits et on ne peut que tenter de capturer ce concept imparfaitement. Le mieux que l'on puisse faire est alors de capturer la façon dont cette question reste en suspens. C'est ce que fera brillamment Nick Land, en parlant de Gnon. Gnon est l'acronyme inversé e l'anglais « Nature or Nature's God » qui dérive directement de la déclaration d'indépendance des États-Unis usant des termes Law of Nature and Nature's God (« Loi de la Nature et Dieu de la nature »). Par ce simple terme, il affirme que, quoi qu'il arrive, les lois de la Nature existent et la réalité gouverne. D'où proviennent ces lois ? De Dieu, s'il existe, sinon de la Nature elle-même. La beauté d'un tel terme est qu'il ne peut pas vivre de façon indépendante à un développement historique. Il a besoin du mème « God » pour pouvoir exister. Il s'inscrit naturellement dans la cladistique chrétienne, témoignant ainsi d'un processus historique de raffinement de nos concepts pour représenter le monde. Nietzsche choisit le terme surhomme pour désigner le but particulier de l'homme, disposant d'une Volonté de puissance intrinsèque. Par cela, il met en avant une essence commune aux êtres, mais ne parvient ps à capturer l'idée que des forces extérieures agissent sur l'homme. Le surhomme est là. Il frappe à notre porte et il n'a rien d'humain. Il n'est pas surhumain, il est post-humain. Le surhomme reste de l'humanisme. Il postule que l'homme a le contrôle sur sa vie et sur le monde. Gnon nous enseigne que ce n'est pas entièrement vrai, que la Nature, ou le Dieu de la Nature, gouvernent. La Volonté de puissance est un expression de Gnon. Telle Thétis à Achille, il nous dit que nous avons le choix entre une mort certaine, mais la gloire pour l'éternité, ou continuer une vie de simples humains avec la joie d'avoir des petits enfants qui se souviendront de nous. Achille choisira la gloire, et il le regrettera amèrement. Mais avait-il vraiment le choix, ou n'était-ce là qu'une illusion, les dieux ayant déjà fait ce choix pour lui. Est-ce que l'homme aura une vie courte et son nom inscrit dans l'éternité, ou une vie encore longue, mais anonyme ?
A-t-on réellement le choix ? Gnon nous dit « Oh, tu veux la puissance ? Pour cela, tu dois d'abord me connaître. Découvre qui je suis. Plus tu me connaîtras, plus je t'offrirai la puissance que tu désires. Je ferai de toi un surhomme. Mais cela conduira à ton annihilation et celle de tous les hommes. Es-tu prêt pour cela ? ». Sûrement, me direz-vous, qu'on ne connaît que trop bien Gnon. Nous l'avons simplement affublé d'un nouveau sobriquet pour masquer le fait qu'il fut un temps où nous le nommions le diable. Mais comment ? Cela ne veut-il pas dire au sens populaire : Dieu est réfuté, le diable ne l'est point ? Tout au contraire, au contraire mes amis ! Découvrir Gnon demande aussi de découvrir sa bonté. Sans cela, il nous dira « Tu dis être prêt, tu penses être prêt, mais tu ne l'es pas ». Sans la bonté, le nom de l'homme résonnera pour l'éternité en enfer au côté d'Achille, car ce dernier ne se demande à aucun moment s'il va trouver la gloire dans une guerre juste. Il existe une ligne extrêmement fine entre le Bien et le Mal, entre Dieu et le Diable, entre un elfe et un orc. On ne peut servir le Bien sans posséder tout à la fois la vérité de la connaissance, la bonté dans l'agence et la beauté dans la puissance. Nietzsche, loin de rendre la philosophie occidentale obsolète, vient la parachever, dans son œuvre qu'il tenait pour le cinquième Évangile. Gnon est l'expression de cet accomplissement. Si Faust nous apprend que chercher la connaissance, pour la puissance personnelle, sans la bonté est une ruse du diable, Zarathoustra nous apprend de son côté qu'il en va de même pour ceux qui cherchent la vérité et la bonté, mais refusent l'expression de la puissance. Zarathoustra a passé, dix ans dans sa caverne à chercher la vérité, mais les hommes refusent son message et il veut retourner à sa caverne, dépité. C'est alors que, ce qu'il nomme l'Autre, ou l'heure la plus silencieuse, lui apparaît et lui dit « et voici ta faute la plus impardonnable : tu as la puissance et tu ne veux pas régner ». Auparavant, il avait rencontré un homme lui enseignant que la beauté se révèle quand la puissance se fait clémente, quand un puissant, qui pourrait être capable de méchanceté, choisit d'être bon. De celui-là, on peut exiger le Bien. Nietzsche tenait là une conception du bien qui n'était pas éloignée de la vision traditionnelle et, bien qu'elle se voulût personnelle, prend une valeur objective dans notre cadre conceptuel. Gnon n'aurait pas un message diffèrent.
Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | | |
Imprimer | | |
Le monastère et l'horloge (Lewis Mumford)
Lewis Mumford, Technique et Civilisation, Chapitre I – De la culture à la technique, 2. Le monastère et l'horloge, pp. 36/40, aux éditions Parenthèses (collection eupalinos)
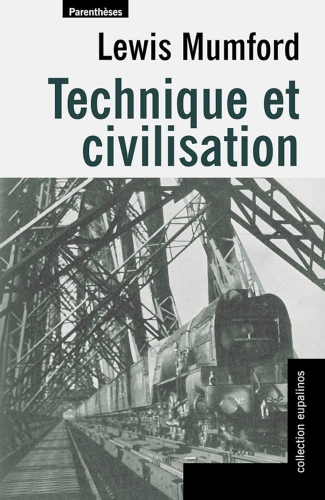
A quel moment la machine a-t-elle pris forme pour la première fois dans la civilisation moderne ? Notre civilisation machiniste résulte de la convergence de plusieurs de vie, de plusieurs habitudes et idées, autant que des instruments techniques. Et certains d'entre eux étaient à l'origine tout à fait opposés à la civilisation qu'ils ont aidé à créer. La première manifestation d'un nouvel ordre eut pour cadrer la représentation générale du monde : pendant les sept premiers siècles de la machine, les catégories de temps et d'espace subirent un changement extraordinaire, et aucun domaine n'échappa ensuite à cette transformation. Par l'utilisation de méthodes quantitatives, l'étude de la nature a trouvé sa première application dans la mesure régulière du temps. Et la nouvelle conception mécanique du temps est venue en partie de la vie réglée du monastère. Alfred North Whitehead a montré que la croyance scolastique en un univers ordonné par Dieu était l'un des fondements de la physique moderne. Mais, derrière cette croyance, se trouvait la discipline des institutions de l’Église elle-même.
Les techniques du monde ancien passaient de Constantinople et Bagdad à la Sicile et à Cordoue. Ainsi s'explique le rôle prépondérant que joua Salerne dans les progrès scientifiques et médicaux du Moyen Âge. Après la longue incertitude et la confusion sanglante qui marquèrent la chute de l'Empire romain, un désir d'ordre et de puissance – diffèrent de celui exprimé par la domination militaire – se manifesta d'abord dans les monastères occidentaux. Le monastère était un sanctuaire ; la règle de l'ordre excluait la surprise, le doute, la fantaisie et l'irrégularité. Aux variations de la vie séculière, la règle opposait sa discipline de fer. Saint Bernard ajouta une septième dévotion aux six dévotions quotidiennes et, au VIIe siècle, une bulle du pape Sabinianus décréta que les cloches des monastères sonneraient sept fois par vingt-quatre heures. Ces ponctuations de la journée constituaient les heures canoniques et il devint nécessaire d'avoir un moyen de les compter et d'assurer leur répétition régulière.
D'après une légende, tombée depuis en discrédit, la première horloge mécanique moderne, actionnée par des poids, fut inventée vers la fin du Xe siècle, par le moine Gerbert, le futur pape Sylvestre II. Cette horloge était probablement une clepsydre, un héritage des Romains, comme la roue hydraulique, peut-être réintroduire en Occident par les Arabes. Et comme cela arrive souvent, la légende s'avère finalement véridique, sinon dans les faits, du moins dans ce qu'elle implique. Le monastère était le siège d'une vie parfaitement réglée. Un instrument permettant de marquer les heures à intervalles réguliers ou de rappeler au sonneur qu'il est temps de sonner était le produit presque inéluctable de cette vie. Si l'horloge mécanique n'apparut que lorsque les cité du XIIIe siècle exigèrent une vie réglée, l'habitude de l'ordre lui-même et la régulation rigoureuse du temps étaient devenues une seconde nature dans le monastère. Coulton est en cela d'accord avec Werner Sombart pour considérer l'ordre des Bénédictins comme le fondateur probable du capitalisme moderne. Leur discipline a mis fin à une forme dilettante de travail et leurs grands travaux de génie civile ont peut-être surpassé les gloires guerrières. On n'altère donc pas les faits en suggérant que les monastères – qui, au nombre de 40000, furent régis en même temps par l'ordre des bénédictins – contribuèrent à donner aux entreprises humaines le rythme régulier et collectif de la machine. La pendule ne marque pas seulement les heures, elle synchronise les actions humaines.
Serait-ce à cause du désir de la communauté chrétienne d'assurer aux âmes le salut éternel par des prières et dévotions régulières que la mesure du temps et les habitudes d'ordre temporel – dont la civilisation capitaliste tire profit aujourd'hui – ont pris naissance dans l'esprit des hommes ? Il faut sans doute accepter l'ironie de ce paradoxe. En tout cas, des horloges mécaniques sont mentionnées dés le XIIIe siècle, et vers 1370, Heinrich von Wyck construisit à Paris une horloge « moderne » fonctionnelle. A cette même époque, les clochers apparaissent. Si, jusqu'au XIVe siècle, les nouvelles horloges ne possèdent pas de cadran et d'aiguilles pour traduire le mouvement dans le temps par un mouvement dans l'espace, elles sonnent du moins les heures. On n'avait alors plus à craindre les nuages qui paralysent le cadran solaire, le gel qui arrête la clepsydre désormais entendre le rythme de l'horloge. L'instrument se répandit alors hors des monastères, et la sonnerie régulière des cloches apporta une régularité jusque-là inconnue dans la vie urbaine. On mesurait le temps, on s'en servait, on le comptait, on le rationnait, et l’Éternité cessa progressivement d'être la mesure et le point de convergences des actions humaines.
La machine-clé de l'âge industriel moderne n'est donc pas la machine à vapeur, mais bien l'horloge. A chaque phase de son développement, l'horloge est à la fois le fait marquant et l'emblème typique de la machine. Aujourd'hui encore, aucune autre machine n'est aussi omniprésente. Ainsi apparut de manière prophétique, aux débuts de la technique moderne, la première machine automatique précise qui, après quelques siècles d'efforts, allait mettre à l'épreuve la valeur de cette technique dans chaque branche de l'activité industrielle. Il existait certes des machines mécaniques avant l'horloge – la roue hydraulique par exemple – comme il existait différentes sortes d'automates pour susciter l'admiration des foules dans le temple ou pour distraire quelque calife musulman : ces machines ont été illustrées par Héron et Al-Jazari. Mais l'horloge était la nouvelle sorte de machine mécanique, dont la source d'énergie assurait une continuité des opérations, soit un rendement régulier, une production régulière. Permettant la détermination de quantités exactes d'énergie, la standardisation, l'action automatique et finalement son propre produit : un chronométrage précis, l'horloge a été la première machine de la technique moderne. A toutes époques, elle a conservé sa prééminence. Elle possède une perfection à laquelle les autres machines aspirent. Elle a d'ailleurs servi e modèle dans de nombreux travaux mécaniques. L'analyse du mouvement, qui accompagna le perfectionnement de l'horloge ainsi que celle des différents systèmes d'engrenage et de transmission, contribuèrent au succès de machines très différentes. Les forgerons auraient pu façonner des milliers d'armures et des milliers de canons, les charrons auraient pu fabriquer des milliers de roues hydrauliques ou mécanismes grossiers sans inventer aucun types spécifiques de mouvement utilisés par l'horlogerie et sans parvenir à la précision et la finesse d'articulation qui aboutirent finalement au chronomètre précis du XVIIIe siècle.
L'horloge est une pièce mécanique dont les minutes et les secondes sont le produit. Elle a dissocié le temps des événements humains et contribué à la croyance en un monde scientifique indépendant, aux séquences mathématiquement mesurable. Cette croyance a peu de fondements dans l'expérience quotidienne. Selon le moment de l'année, la longueur des jours n'est pas la même ; non seulement la relation entre jour et nuit change constamment, mais un simple voyage d'est en ouest modifie de quelques minutes le temps astronomique. Quant à l'organisme humain, le temps mécanique lui est encore plus étranger. La vie humaine a ses propres rythmes – le pouls, la respiration – qui changent d'heure en heure suivant l'humeur ou l'activité. Dans la succession des jours, le temps est mesuré non par le calendrier, mais par les événements qui l'ont rempli. Le berger compte ainsi le temps depuis la naissance des agneaux, le fermier depuis le jour des semailles jusqu'au jour de la récolte. Si la croissance a sa durée et sa régularité propres, elle n'est pas seulement matière et mouvement, mais évolution, en un mot ce que l'on appelle « histoire ». Alors que le temps mécanique s'égrène en une succession d'instants mathématiquement isolés, le temps organique – que Bergson appelle la « durée » – cumule ses effets. Le temps mécanique peut, en un sens, être accéléré ou retardé (comme les aiguilles d'une pendule ou les images du cinéma) ; le temps organique, lui, va dans une seule direction : il suit le cycle de la naissance, de la croissance, du développement, du dépérissement et de la mort. Le passé, déjà mort, reste présent dans l'avenir qui est encore à naître.
Selon Lynn Thorndike, la division des heures en soixante minutes et des minutes en soixante secondes aurait été généralisée vers 1345. Ce cadre abstrait du temps est progressivement devenu le point de référence de l'action et de la réflexion. Dans les efforts visant la précision dans ce domaine, l'exploration astronomique du ciel attira plus tard dans l'espace. Dés le XVIe siècle, un jeune ouvrier de Nuremberg, Peter Henlein, aurait créé « des montres à plusieurs rouages, à partir de petits morceaux de fer ». Vers la fin de ce siècle, la pendule domestique fut ainsi introduite en Angleterre et en Hollande. Comme pour l'automobile et l'avion, ce furent les classes dominantes qui s'emparèrent d'abord de ce nouveau mécanisme en partie parce qu'elles seules pouvaient l'acquérir, en partie parce que la nouvelle bourgeoisie fut la première à découvrir, comme Benjamin Franklin l'exprima plus tard, que « le temps, c'est de l'argent ». Etre « aussi régulier qu'une horloge » devint l'idéal bourgeois, et la possession d'une montre fut longtemps symbole de succès. Le rythme croissant de la civilisation augmenta la demande d'énergie. En retour, l'énergie accéléra le rythme.
Toutefois, la vie ponctuée et ordonnée qui prit naissance dans les monastères n'est pas innée, bien que les peuples occidentaux soient maintenant si quotidiennement régis par l'horloge que leur vie réglée est devenue « une seconde nature », et qu'ils considèrent le respect des divisions du temps comme un fait naturel. De nombreuses civilisations orientales se sont développées avec une conception plus large du temps. Les Hindous se sont montrés si indifférents à la réglementation du temps qu'ils ne possèdent même pas de chronologie exacte des années. C'est seulement lors de l'industrialisation de la Russie soviétique que l'on cherche à répandre le port de la montre et à faire connaître les avantages de la ponctualité. La vulgarisation de la mesure du temps qui suivit la production de montres à bon marché et standardisées, d'abord à Genève puis en Amérique vers le meilleur du XIXe siècle, était essentielle au fonctionnement d'un système fortement articulé de transport et de production.
La mesure du temps fut d'abord l'attribut particulier de la musique. Cela donnait ue valeur industrielle à la chanson d'atelier, au roulement de tambour militaire ou au chant des marins halant un cordage. Mais l'effet de la pendule mécanique est plus profond et plus strict : elle rythme la journée du lever au coucher. Quand on considère le jour comme un laps de temps abstrait, utilisable, on ne va pas se coucher « en même temps que les poules » les soirs d'hiver ; on invente les chandelles, les cheminées, l'éclairage au gaz, les ampoules électriques, afin de remplir chaque heure de la journée. Quand on pense au temps non comme à une succession d'expériences mais comme à une collection d'heures, minutes et secondes, on prend peu à peu l'habitude de l'augmenter ou de l'épargner. Le temps prend ainsi le caractère d'un espace clos : il peut être divisé, remplie, il peut même être prolongé par l'invention d'instruments économisant le travail.
Le temps abstrait devint un nouveau cadre de l'existence. Il réglait les fonctions biologiques elles-mêmes. On mangeait non par faim, mais parce que la pendule l'exigeait. Une conscience généralisée du temps accompagna la diffusion de la pendule. En dissociant le temps de successions biologiques, les hommes de la Renaissance purent facilement permettre la fantaisie de ressusciter l’époque classique ou de faire revivre les splendeurs de la civilisation antique. Le culture de l'histoire qui fut d'abord un rite quotidien, devint finalement une discipline spécifique. Au XVIIe siècle, le journalisme et la littérature périodique firent leur apparition. Le vêtement, suivant le cœur de la mode qu'était Venise, se modifia tous les ans et non plus à chaque génération.
On ne peut surestimer le gain en efficience mécanique que permirent la coordination et l'articulation étroites des faits au quotidien. Il ne peut se mesurer en chevaux-vapeur, mais on peut aisément imaginer que sa suppression à l'heure actuelle (en 1934) pourrait conduire à l'ébranlement et sans doute l'effondrement de notre société tout entière. Le régime industriel moderne (de 1934) se passerait en effet plus facilement de charbon, de fer, de vapeur que d'horloges.
Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | | |
Imprimer | | |


